I L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES I N° 55 I 31 sionné pour les phénomènes de flux
I L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES I N° 55 I 31 sionné pour les phénomènes de flux et de mobilité mi- gratoires. Il reconstitue le passé de ces émigrants, pro- venant pour certains de la Vienne et des Deux-Sèvres. L’Actualité. – Quel est le point de départ de vos recherches? Robert Larin. – Comme bon nombre de Canadiens, je m’interrogeais sur mes ancêtres. Je suis donc venu à la généalogie et, en retraçant l’ascendance de mon ancêtre qui s’appelait Pierre Lorin, je me suis heurté au fait qu’il était d’origine inconnue. Mais la généa- logie ne m’intéressait pas beaucoup et je me suis con- centré sur le personnage. Mon ancêtre, Pierre Lorin, né vers 1628, était origi- naire d’Angliers, petite paroisse au sud de Loudun. Il a émigré au Canada en 1655 avec sa jeune épouse Françoise Hulin. Il venait rejoindre son cousin issu de germain René Fillastreau, émigré depuis deux ou trois ans. Fillastreau provenait du secteur nommé Saint-Antoine, du nom d’une commanderie établie à Angliers. L’expérience de vie au Canada étant posi- tive, deux autres cousins quitteront Angliers en 1657 : les frères Mathurin et Laurent Gouin. Les quatre cou- sins se sont ainsi établis en permanence au Canada. Cela m’avait surpris à l’époque bien qu’il s’agisse d’un phénomène très courant en définitive, celui de la dynamique des chaînes migratoires. Par ailleurs, si Pierre Lorin était d’origine inconnue, c’est parce qu’il était déjà marié lorsqu’il est parti et il n’a donc pas eu l’occasion de déclarer son lieu de provenance dans un acte de mariage. J’ai écrit un premier livre, paru en 1992, qui traite de ces recherches : Quatre cousins Loudunais en Nouvelle-France. Très vite, je me suis posé la question de savoir s’ils étaient venus seuls. Dans La Contribution du Haut-Poitou (1994), vous élargissez votre champ d’investigation. Oui, il m’importait de savoir comment ces gens-là sont arrivés chez nous. J’ai reconstitué le parcours de tous les pionniers qui sont partis des Deux-Sèvres et de la Vienne en les situant individuellement dans leurs pa- roisses respectives. On remarque ainsi des liens de voisinage et de parenté dans ces départs. J’ai trouvé 730 pionniers qui sont partis du Haut-Poi- tou pour le Canada et l’Acadie, dont une trentaine provenant du Loudunais pour venir s’installer dans la vallée du Saint-Laurent. Sur 558 migrants haut-poi- tevins connus, établis le long du Saint-Laurent avant 1760, 23,1 % provenaient de Poitiers et 14,3 % du reste de l’arrondissement actuel de Poitiers, 9,7 % de Niort et 17,7 % du reste du Niortais. Les autres ve- nant du Loudunais (7,8 %), du Châtelleraudais (6,5 %), du Montmorillonnais (5 %), du Civraisien (7,8 %), de la vallée du Thouet (8,2%). Cela suppose un travail énorme de recensement. Nous avons à notre disposition de nombreuses res- sources dont certaines ont été informatisées. C’est ainsi que toutes les familles du «Québec ancien» ont pu être reconstituées, mais la plupart des pionniers qui sont restés célibataires ou qui sont repartis nous échappent encore. Cependant on peut avoir accès à toutes les données généalogiques à l’origine de la po- pulation française, que l’on appelle «l’immigration fondatrice». Cette banque de données est très utile pour ce qui est des données historiques et même gé- nétiques. Ces ressources facilitent considérablement nos recherches. Quelle méthodologie avez-vous adopté ? L’approche strictement généalogique n’est pas suffi- sante. Prenons l’exemple des Deux-Sèvres. Lorsque C De la généalogie à la dynamique migratoire recherche ’est en retraçant l’arbre généalogique fami- lial que Robert Larin, doctorant en histoire à l’Université de Montréal, s’est peu à peu pas- Partant de la recherche sur son ancêtre poitevin, le Québecois Robert Larin a retrouvé la trace de 730 pionniers partis du Haut-Poitou pour le Canada et l’Acadie Entretien Boris Lutanie Photo Marc Deneyer Ci-contre : Le village d’Angliers dans le Loudunais que Pierre Lorin quitta en 1655 avec son épouse Françoise Hulin pour émigrer au Canada. 32 I L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES I N° 55 I en a dénombré 35 dont on peut prouver qu’ils étaient bien issus de familles protestantes. Dans 24 autres cas, on est quasiment sûr, de par leur appartenance fami- liale, qu’ils étaient protestants mais sans en avoir en- core la preuve formelle. Et ainsi de suite, on travaille patiemment à creuser cette dynamique collective. On constate que, la plupart du temps, ou bien une pa- roisse n’envoie personne au Canada, ou bien elle en- voie plus d’une personne. Soit que les migrants par- taient en groupe ou qu’un migrant parti seul écrivait et encourageait ses parents et voisins à venir. Ces ques- tions sont abordées dans mes derniers livres, Brève histoire des protestants en Nouvelle-France (1997) et Brève histoire du peuplement européen de la Nou- velle-France (2000). Quel bilan global est-on aujourd’hui en mesure de tirer concernant l’émigration en Nouvelle-France ? Trente mille Français ont débarqué au Canada du- rant la période de la Nouvelle-France (avant 1760) et y ont hiverné au moins une fois. La moitié sont repartis pour ailleurs ou pour rentrer en France. Sur les 15 000 qui se sont établis à demeure et en per- manence, seulement 9 000 se sont mariés et ont fondé une famille. Parmi ceux-ci, 6 500 ont laissé une des- cendance connue (5 000 hommes et 1 500 femmes) à l’origine de la population francophone actuelle. Ce flux migratoire eut lieu en majorité au cours du XVIIe siècle et des dernières années de la Nouvelle- France. Donc, il y a peu d’immigration entre 1700 et 1750. Les territoires ayant le plus contribué sont dans l’ordre ceux des départements de Charente-Maritime, Seine (Paris) et Seine-Maritime. Quels travaux présentez-vous à Poitiers ? Ma communication porte sur les Canadiens passés en France à la Conquête du Canada dans les années 1760. Nos premiers historiens ont affirmé qu’à la Conquête, toute l’élite sociale était partie et que la population avait été abandonnée à elle-même. Cette version des faits a par la suite été remise en question par l’anna- liste des Ursulines de Québec qui avait découvert qu’ils n’étaient pas tous partis puisqu’ils étaient men- tionnés dans les archives de sa communauté. Le dé- bat s’est alors centré sur le problème suivant : y a-t-il eu un exode ou non ? La thèse de l’exode a été rete- nue et, dans les années 1950, les historiens ont insisté sur ce que l’on appelle la «décapitation sociale». La société, ayant perdu son élite, avait laissé la place li- bre aux conquérants britanniques pour s’emparer du commerce et des leviers politiques. Une autre géné- ration d’historiens soutenaient la position inverse, en affirmant qu’il n’y avait aucun rapport de cause à ef- fet entre les deux faits. Cette controverse occultait l’exode lui-même. J’ai entrepris d’identifier les gens qui sont partis à la Conquête, les lieux où ils sont al- lés en France, les circonstances de ce départ, et ce qu’ils sont devenus par la suite, etc. Qu’entendez-vous par «exode à la Conquête» ? Dans cette recherche, j’exclus les Français qui sont retournés chez eux, donc les militaires, etc. Mes re- cherches se portent sur ceux qui sont nés ou ont fondé une famille au Canada. L’exode a débuté en même temps que la «guerre de sept ans». Ainsi, des prison- niers de guerre, envoyés en Angleterre, sont arrivés en France après leur libération sans la possibilité de revenir au Canada. Le cas des marins est aussi très éclairant. Québec était une fourmilière de marins qui approvisionnaient toute la France en gens de mer. A la Conquête, les bateaux sur lesquels ils travaillaient n’ont pas pu retourner à Québec, devenu une province britannique. Plusieurs soldats sont repassés en France avec des épouses canadiennes et des enfants nés dans la colonie. Ces soldats ont été congédiés à leur arri- vée en France et plusieurs ont tenté de trouver un en- droit où refaire leur vie en passant en Guyane ou dans une autre colonie. En conséquence, on voit très clai- rement qu’il ne s’agissait pas uniquement d’un dé- part de l’élite sociale. I Sébastien Laval Ci-contre, Robert Larin. l’on marque sur une carte les lieux d’origine des pion- niers, on s’aperçoit que la partie catholique du dépar- tement (le centre) et le nord, à l’exception de Thouars (fief protestant), on ne trouve personne qui ait émigré au Canada. La partie sud des Deux-Sèvres contribue beaucoup, de même que les enclaves protestantes dans la partie catholique. Cela suggère une piste de recher- che. Les protestants partaient pour échapper aux per- sécutions mais aussi, tout simplement, pour vivre en paix. J’ai travaillé en collaboration avec une généalo- giste des Deux-Sèvres. Ainsi sur un total de 248 pion- niers originaires de ce département, cette généalogiste I L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES I N° 55 I 33 Sébastien Laval l’interculturalité exempte de toute incli- nation folklorisante. Sa vision de la «berbérité en pays picto-charentais» ne doit rien aux arguments oppositionnels systématiquement assénées par les partisans ou les détracteurs du multiculturalisme. Les schémas d’inclu- sion/exclusion qui formatent les straté- gies adoptées par les émigrés comme des stratégies adaptées pêchent par excès de dualité : ethnocentisme ou assimilation. Face au uploads/Geographie/ nouvelle-france-de-la-genealogie-a-la-dynamique-migratoire.pdf
Documents similaires

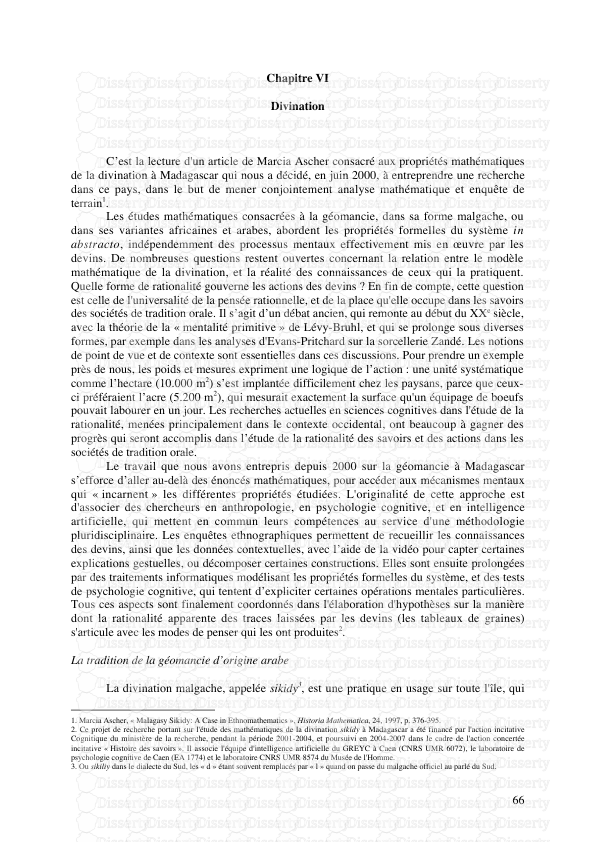








-
61
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 19, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0402MB


