CHAPITRE III : L’INFLATION INTRODUCTION « L’inflation est l’œuvre du diable par
CHAPITRE III : L’INFLATION INTRODUCTION « L’inflation est l’œuvre du diable parce qu’elle respecte les apparences et détruit les réalités » (André Maurois) Il est usuel d’appréhender l’inflation comme un mal absolu : il s’agit d’un phénomène qui affecte négativement les principales variables économiques telles que l’exportation, la consommation et la compétitivité. Pourtant, si l’inflation est un mal, elle ne l’est pas toujours : l’inflation peut opérer une redistribution plus égalitaire des revenus, comme il ne faut pas oublier qu’elle a accompagné des périodes d’essor, telles que les trente glorieuses, tandis que la déflation (≠ inflation) accompagnait la crise de 1929. SECTION I: L’INFLATION : DEFINITION, MESURE ET FORMES A/ Définition L’inflation est la hausse durable du niveau général des prix à l’intérieur d’un pays. Une hausse ponctuelle et localisée des prix, ne peut pas être considérée comme de l’inflation, que si elle se propage à toute l’économie et se poursuit sur la période qui suit : le mouvement de croissance des prix doit être général, concerner les différents secteurs et branches de l’économie et se maintenir dans le temps. L’inflation doit être distinguée d’autres processus, qui affectent aussi le niveau général des prix : • La déflation : elle exprime la diminution du niveau général des prix et désigne généralement une situation de dépression économique. • La stagflation : un concept assez récent qui désigne une accélération de l’inflation conjuguée à une augmentation du taux de chômage. B / Mesure Pour mesurer l’évolution du niveau général des prix, il est nécessaire de disposer d’un indice des prix. Plus particulièrement, lorsqu’on étudie l’évolution de l’inflation, on se rattache généralement à un indice des prix à la consommation, indicateur qui mesure la variation du prix d’un panier de marchandises. Il faut aussi ajouter que la mesure de l’inflation suppose une année de référence. Un calcul en moyenne permet de comparer les moyennes annuelles de l’indice (moyenne arithmétique simple des 12 indices mensuels. Le taux de variation des prix (taux d’inflation) se définit de la manière suivante : (Moyenne de l’année (n) – moyenne de l’année (n-1) ) / moyenne de l’année (n-1). En Tunisie, l’indice des prix à la consommation est établi par l’INS (institut national des statistiques). C / Formes Nous pouvons, tout d’abord, caractériser l’inflation par son niveau, et on distingue : • L’inflation rampante : dont le taux est relativement faible, mais la hausse des prix est installée. • L’inflation galopante : dont le taux est élevé, mais encore maîtrisable. • L’hyperinflation : elle constitue une hausse exacerbée du niveau général des prix. Ensuite, si on caractérise l’inflation par son degré de régularité, on distinguerait : • L’inflation d’équilibre : le taux est constant, l’inflation est installée, mais sans risque d’accélération : tous les agents économiques l’intègrent dans leurs calculs. • L’inflation de déséquilibre : elle est caractérisée par sa volatilité. Enfin, si on caractérise l’inflation par sa valeur relative, c’est à dire le taux d’inflation dans un pays, en comparaison avec ceux des pays étrangers, on peut déterminer le différentiel d’inflation, qui nous informe sur la compétitivité- prix relative du pays en question. SECTION II: LES ORIGINES DE L’INFLATION A/L’inflation par les coûts L’inflation par les coûts regroupe plusieurs cas de figure : 1/ Une augmentation des salaires Le facteur travail est rémunéré à sa productivité marginale, en conséquence, si les hausses de salaires sont supérieures aux gains de productivité, la répartition du revenu se modifie en faveur des salaires et au détriment des profits : ce ci peut inciter les entrepreneurs à réagir en augmentant le prix de leurs produits. Cette forme d’inflation apparaît comme l’expression d’une lutte entre les salariés et les capitalistes pour le partage de la valeur ajoutée. Cette lutte peut déboucher sur une boucle prix/salaires, qui rend l’inflation un problème auto- entretenu : les salariés, par le biais de leurs syndicats, parviennent à obtenir des hausses de salaires, les entrepreneurs réagissent en augmentant le prix de vente de leurs produits, ce qui incite à nouveau les salariés à se mobiliser pour obtenir de nouvelles augmentations de salaires. 2/ L’inflation importée L’inflation importée apparaît comme la conséquence d’une augmentation des prix des produits venant de l’extérieur et qui affecte le pays par le biais de l’importation. Le choc pétrolier de 1973-74 est l’exemple type de cette inflation importée : le prix du baril de pétrole est multiplié par cinq entre septembre 73 et décembre 74, le pétrole constitue une consommation intermédiaire, les entrepreneurs réagissent en augmentant le prix de leurs produits à base de pétrole. L’inflation importée peut également surgir à la suite d’une dévaluation : en dévaluant sa monnaie, un pays se voit confronté au renchérissement du prix de ses importations, ce qui peut inciter les entrepreneurs nationaux à relever le prix de leurs produits. En fait, un paradoxe apparaît à cet égard : la dévaluation résulte généralement d’une inflation élevée par rapport à celle des pays étrangers partenaires, alors qu’elle alimente elle même de nouveau l’inflation, et le pays peut être pris dans un vrai cercle vicieux de la dévaluation. 3/ L’inflation de productivité L’inflation de productivité résulte d’une contradiction entre l’hétérogénéité sectorielle dans les gains de productivité et l’uniformité des hausses des salaires. En effet, dans une économie, il existe des secteurs à forts gains de productivité et d’autres à faibles gains de productivité. Cela ne poserait pas de problèmes si l’évolution des rémunérations était fixée selon les performances de chaque secteur. En réalité, les négociations salariales prennent généralement comme référence, les secteurs à forts gains de productivité (tel que le secteur industriel). Cela signifie que dans les secteurs à faible gains de productivité (tel que le secteur de service), les hausses de salaires risquent d’être supérieures aux gains de productivité, ce qui pousserait les entrepreneurs de tels secteurs à rétablir leurs marges en augmentant leurs prix. B/L’inflation par la demande Dans la théorie Keynésienne, l’inflation par la demande surgit lorsque l’économie se trouve en situation de plein –emploi. En effet, tant que l’économie n’a pas atteint le plein –emploi, c’est à dire qu’il existe encore des facteurs de production inutilisés, l’offre est parfaitement élastique : toute augmentation de la demande entraîne un accroissement de la production. Par ailleurs, dés lors que les facteurs de production sont pleinement utilisés,toute augmentation de la demande, que l’offre ne peut pas suivre, se traduit par une hausse du niveau général des prix , et ce, pour que l’équilibre entre l’offre te la demande se rétablisse. De plus, l’inflation par la demande, pourrait être le résultat d’un accroissement des salaires entraînant une augmentation de la demande de consommation, comme elle pourrait résulter de la facilité des crédits bancaires et aussi coexister avec un déficit budgétaire de l’Etat (lorsque ce dernier augment ses dépenses dans le but de distribuer des salaires, ce qui fait augmenter la demande). C/L’inflation par la monnaie Milton Friedman affirme que « l’inflation est partout et toujours un phénomène monétaire ». En effet, selon les tenants de la théorie quantitativiste et néo- quantitativiste, l’inflation s’explique par une créationexcessive de la monnaie. L’augmentation de la masse monétaire vise généralement la relance de la demande, et ce, par le biais de l’encouragement des investissements directs ou indirects. Lorsque la masse monétaire augmente, la demande augmente aussi, mais que l’augmentation de la production est inférieure à celle de la monnaie, dans ce cas, il y aurait une hausse des prix qui entraînerait l’inflation. Au cours de la période 1973-1988, il était tout a fait observable qu’il y avait une relation positive entre la croissance de la masse monétaire et le taux d’inflation. L’inflation par la monnaie peut aussi résulter d’une monétisation du déficit budgétaire. En effet, pour financer son déficit budgétaire, l’Etat peut recourir à trois solutions : Soit en émettant des titres, soit en augmentant le taux d’imposition fiscal, soit aussi de recourir au financement monétaire de son déficit. D/ L’inflation par les structures économiques et socioculturelles 1/ L’inflation par les structures économiques • L’inflation peut résulter, de nos jours, de la structure oligopolistique des marchés : quelques offreurs et un grand nombre de demandeurs, de telle sorte que, par l’effet de leur taille, les entreprises peuvent influencer les prix de marché à la hausse. • Le pouvoir monétaire des banques pourrait aussi entraîner l’inflation : par le biais de la création monétaire et donc de l’octroi des crédits, les banques encouragent indirectement la consommation. Si la production n’arrive pas à suivre l’augmentation de la demande, il y aurait hausse des prix et donc inflation. • Le nouvel environnement international peut aussi jouer un rôle dans la création de l’inflation : avec l’ouverture sur les marchés extérieurs, la demande envers les produits nationaux pourrait augmenter, entraînant ainsi l’augmentation des prix. De plus, dans une recherche de compétitivité, certains pays recourent à la dévaluation, laquelle dévaluation renchérit les prix à l’importation et entraîne l’augmentation de la demande intérieure et donc l’augmentation des prix nationaux. 2/ L’inflation par les structures socioculturelles L’apparition des tendances à la consommation dans un but de « démonstration sociale » uploads/Industriel/ chapitre-iii-eg2.pdf
Documents similaires


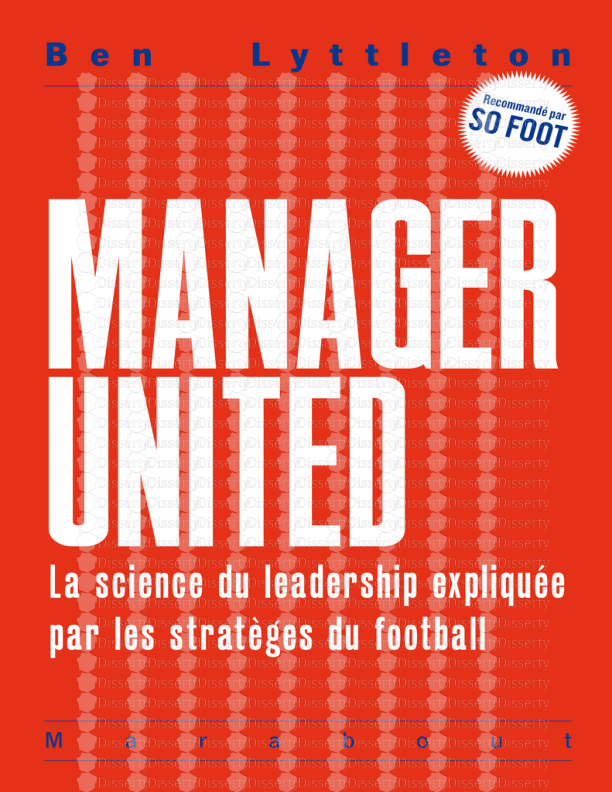







-
85
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 15, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0960MB


