1 Stratégies d’innovation et organisation de la conception dans les entreprises
1 Stratégies d’innovation et organisation de la conception dans les entreprises amont. Enseignements d’une recherche chez Usinor1. S. Lenfle, C. Midler Centre de recherche en Gestion de l’Ecole polytechnique Les années 1990 ont vu le développement d’un important courant de recherche sur la place de l’innovation dans la stratégie et la transformation des processus de conception. La critique du modèle de « l’équilibre ponctué » (Brown Eisenhardt, 1998), la formalisation de dynamique de la firme à partir du concept « d’innovation intensive et répétée » (Chapel 1996 ; Hatchuel & Le Masson, 1999), constituent des contributions significatives au renouvellement d’un domaine de recherche pourtant ancien (Burns & Stalker, 1963 ; Zaltman & al. 1973) : le nœud de la stratégie n’est plus l’innovation ou le projet réussi mais isolé, c’est au contraire la capacité à construire une trajectoire durable d’innovations successives introduisant des ruptures significatives dans l’identité des produits, des marchés, des technologies. L’un des apports de ce courant est de mettre au premier plan l’importance de la notion de création de connaissance dans le processus innovateur (Nonaka & Takeuchi 1995) et, plus précisément, de caractériser l’articulation entre le processus de création de connaissances et le processus de création de produits (en particulier le concept de « lignée de produit » développé par Hatchuel & Weil, 1999). Plusieurs recherches récentes analysent les dynamiques qui en résultent dans les systèmes de conception de différents secteurs (Ben Mahmoud-Jouini et Midler, 1999 ; Benghozi , Charue-Duboc & Midler, 2000). Le cas des entreprises automobiles et de leurs fournisseurs de premier rang est certainement celui qui a été le plus largement étudiée (Clark & Fujimoto, 1991, Midler, 1993 ; Kesseler, 1998 ; Donada, 1998). Il en va différemment pour les entreprises productrices de matières premières intervenant dans les stades amont des filières industrielles, typiquement les entreprises chimiques ou sidérurgiques. Jusqu’à quel point la compétition par l’innovation qui opère sur les marchés de produits finis se répercute-t-elle à ce niveau ? Les nouveaux modèles de conception élaborés dans les entreprises manufacturières sont-ils adaptés à la situation spécifique des entreprises de l’amont ? Sinon, peut-on caractériser les traits d’un modèle spécifique de conception dans les entreprises de l’amont, dont il s’agira d’explorer l’articulation avec les précédents ? 1 Article à paraître dans la Revue française de Gestion. hal-00262578, version 1 - 11 Mar 2008 Manuscrit auteur, publié dans "Revue Française de Gestion 28, 140 (2002) 89-105" 2 C’est à ces questions que nous chercherons à répondre dans cet article à la lumière d’une recherche-intervention (Berry, 1995 ; Lundin & Wirdenius, 1990) menée avec le groupe sidérurgique Usinor. La méthode a consisté, dans un premier temps, en des analyses approfondies “ ex-post ” de plusieurs projets. Ensuite, nous avons participé, en temps réel, à un projet majeur en cours afin d’expérimenter des dispositifs et des instrumentations nouvelles adaptées à ces situations : nouvelle définition du périmètre et de la fonction projet, instrumentation de pilotage et de capitalisation des connaissances sur le projet2. Encart : Présentation de l’hydroformage L’hydroformage est un procédé de mise en forme des tubes d’acier par pression hydraulique interne. Un tube d’acier soudé, la plupart du temps préalablement cintré et/ou préformé, est placé dans un outil composé d’une matrice mâle et d’une matrice femelle ayant la forme finale à atteindre. L’outil est maintenu fermé par une presse hydraulique et des vérins viennent assurer l’étanchéité aux extrémités du tube. Un liquide est alors injecté dans le tube à très haute pression (jusqu’à 4000 bars), alors que les vérins exercent une pression axiale sur les extrémités du tube. Celui-ci vient alors se plaquer contre la matrice pour obtenir la forme souhaitée. La technique offre théoriquement des avantages importants par rapport à d’autres modes de mise en forme comme l’emboutissage : réduction du poids, baisse des coûts, amélioration des performances de la pièce finie… Au milieu des années 90 plusieurs réalisation industrielles font de l’hydroformage un sujet à la mode en conception automobile : berceau moteur de la Ford Mondéo, investissement d’Opel dans une ligne d’hydroformage dédiée à la production du berceau moteur de la nouvelle Corsa, chassis de la Chevrolet Corvette en 1997... Les principaux résultats que nous développerons dans cet article sont les suivants : - La compétition par l’innovation sur les produits finis constitue aussi un enjeu important pour les entreprises de production de matières premières situées en amont des filières industrielles. L’accélération du rythme de (re)conception plus ou moins radicale des produits finis en aval amène les constructeur à rechercher de nouveaux compromis et renforce la concurrence des matériaux de substitution ; - Les stratégies des entreprises amont se déclinent alors en trois axes, qui vont générer un portefeuille de projets d’innovation de nature variée : innovations orientés sur la réduction des coûts, accompagnement des démarches d’innovation des clients par la fourniture de « solution acier », construction proactive de concept innovants capables, par la rupture qu’ils introduisent sur les performances, d’orienter la demande des client vers un choix acier. - La mise en œuvre d’une stratégie de conception d’offres innovantes pose alors des problèmes spécifiques du fait de l’activité et de la position de l’entreprise dans la hal-00262578, version 1 - 11 Mar 2008 3 filière. Nous verrons que les modèles de conception élaborés dans l’industrie manufacturière sont alors, sur bien des plans, inadaptés à ce contexte. Nous proposons alors des principes de management de ce que nous appellerons les projets d’offre innovante dont nous verrons les conséquences organisationnelles. 1. Les enjeux de la compétition par l’innovation pour les industries amont : l’exemple de la sidérurgie. 1.1. Qu’est-ce qu’une industrie amont ? La notion d’industrie amont se fonde sur le concept de filière industrielle, particulièrement développé par les économistes industriels français (Rainelli, 1988 ; Quélin, 1993). Il traduit l’idée qu’un bien ou un service passe par une série d’états intermédiaires avant d’être mis à disposition de l’utilisateur final. On définit ainsi une filière comme une « succession de stades techniques de production et de distribution reliés les uns aux autres par des marchés et concourant tous à la satisfaction d’une composante de la demande finale » (définition du B.I.P.E, 1977 citée dans Arena & al. 1988). Les industries amont correspondent alors à l’ensemble des entreprises situées au début des filières industrielles. Ces industries de process assurent la transformation des matières premières brutes en matières premières élaborées (appelées aussi produits de bases, « commodities » en anglais) qui vont ensuite être utilisées et transformées par les étapes de production situées en aval. La chimie lourde, la pétrochimie, la sidérurgie, la production d’aluminium, la fabrication du verre, de pâte à papier ou certaines industries agro-alimentaires sont autant d’exemples d’industries amont qui, selon cette définition, présentent des caractéristiques qui les différencient des entreprises manufacturières. En particulier, elles sont séparées de l’usager final par plusieurs étapes de transformations, et doivent composer avec un système client complexe. Ainsi pour une pièce hydroformée, il faut tenir compte non seulement des ingénieurs qui conçoivent les structures des véhicules, mais aussi les designers, les méthodes, les soudeurs, la peinture,… Si la pièce est réalisée par un fournisseur (comme c’est généralement le cas pour les composants comme les lignes d’échappement, les roues, …) il faut aussi intégrer sa problématique. La notion de besoin des utilisateurs devient alors très 2 Cette recherche s’est déroulée dans le cadre du programme « enjeux économiques de l’innovation » du CNRS. hal-00262578, version 1 - 11 Mar 2008 4 complexe et sa connaissance délicate alors que l’on connaît son rôle déterminant dans le management de l’innovation. 1.2. L’innovation contre le grignotage d’une position dominante : la situation de « l’entreprise dominante menacée ». « L’impératif d’innovation » des entreprises du type d’Usinor est lié à la conjonction de deux tendances. D’une part, l’effritement des atouts traditionnels des entreprises occidentales (monopole technologique sur les “ grands procédés ”, effet de taille, ...) face au développement des concurrents des nouveaux pays industrialisés. Ceci les amène alors à se concentrer sur des produits à haute valeur ajoutée, stratégie qui repose sur une capacité d’innovation constante. Le cas d’Usinor est particulièrement significatif de cette tendance, le Groupe se séparant peu à peu de toutes ces activités “ standards ” (produits longs notamment) pour se concentrer sur les aciers à haute valeur ajoutée (aciers plats au carbone et aciers inoxydables) qui sont les plus rentables. D’autre part, les entreprises de produits manufacturés explorent de plus en plus largement les ruptures qui leur permettraient de créer des produits plus compétitifs. Ils remettent alors en question les choix matériaux traditionnels. Ainsi, pour poursuivre sur l’exemple d’Usinor, sur le marché phare qu’est l’automobile3, l’acier est depuis les années le matériau de référence par excellence (Abernathy & Utterback, 1985). Or depuis une quinzaine d’années on assiste à un mouvement contradictoire : • D’un coté une augmentation régulière du poids des véhicules liée à l’apparition de nouveaux équipements (ABS, Airbag, climatisation…) et au renforcement des normes de sécurité. • De l’autre une évolution des normes anti-pollution qui pousse, au contraire, à réduire de poids pour limiter uploads/Industriel/ concurrence.pdf
Documents similaires

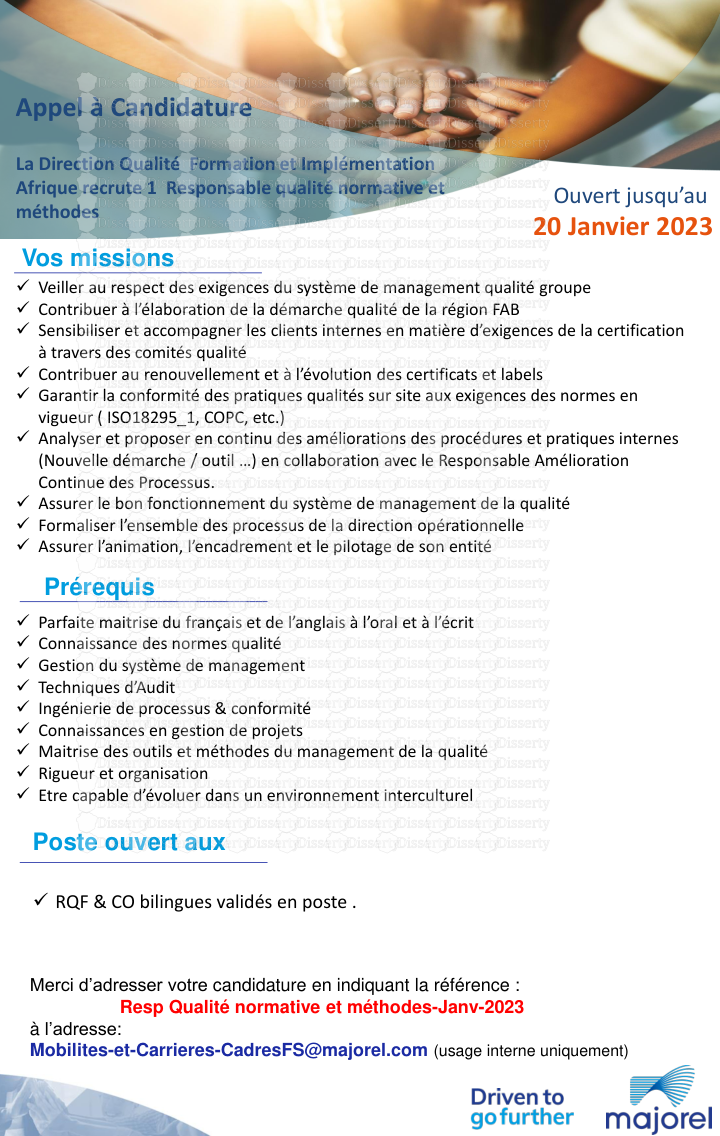








-
119
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 05, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2824MB


