M A I N T E N A N C E 2 E M E P A R T I E Institut Universitaire de Technologie
M A I N T E N A N C E 2 E M E P A R T I E Institut Universitaire de Technologie de Mantes en Yvelines Département G.M.P Organisation et Méthodes de Maintenance. Module F334b Maintenance Partie 1 : le cycle de vie du produit – les coûts de maintenance Partie 2 : les concepts de base de la maintenance Partie 3-1 : la maintenance corrective Partie 3-2 : la maintenance préventive Partie 3-3 : la Totale Productive Maintenance (TPM) Partie 3-4 : la maintenance conditionnelle Partie 4 : choix d’une politique maintenance Partie 5-1 : introduction à la sûreté de fonctionnement Partie 5-2 : travaux dirigés Partie 5-3 : la sûreté de fonctionnement – la fiabilité Partie 6 : organisation et méthodes de maintenance dans le groupe Renault Partie 7 : la gestion de la maintenance par ordinateur (GMAO) PAGE 1 SUR 12 M A I N T E N A N C E 2 E M E P A R T I E CONCEPTS DE BASE DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE 1. INTRODUCTION 1.1. PRÉSENTATION GENERALE La maintenance industrielle, dont la définition littéraire selon l’encyclopédie Hachette est l’« ensemble des opérations qui permettent de maintenir en état de fonctionnement un matériel susceptible de se dégrader », a longtemps été remisée au second plan, pour ne pas dire déconsidérée. Elle a cependant acquis ses lettres de noblesses au cours de ces dernières années, de par son implication de plus en plus forte dans le triangle vertueux du « Qualité-Coût-Délai ». En effet, il est apparu de façon de plus en plus criante que la fonction maintenance était une composante indissociable de la satisfaction du client, puisque une machine défaillante générait une diminution de la cadence de production, mais bien souvent également engendrait des rebuts, et que les coûts induits obligeaient à augmenter le montant du coût de production. De ce fait, les concepts, outils et méthodes de cette discipline transversale doivent-ils être pris en compte tout au long du cycle de vie d’un produit, depuis la phase de conception jusqu’à celle du recyclage. 1.2. ANALOGIE MAINTENANCE-MEDECINE Il est d’usage de comparer la maintenance des équipements de travail à la médecine des êtres humains. En effet, l’objectif général des deux domaines est de maintenir dans le meilleur état une entité, afin qu’elle puisse réaliser les activités pour lesquelles elle est destinée, et ce le plus durablement possible. On peut d’ailleurs établir un parallèle entre les étapes de la vie des deux entités, et des actions d’ « entretien » associées : SANTE DE L’ETRE HUMAIN SANTE DE LA MACHINE Naissance Mise en service Connaissance de l'homme Connaissances technologiques Connaissance des maladies Connaissance des modes de défaillance Carnet de santé Historique Dossier médical Dossier machine Connaissance de traitements Connaissance des remèdes Traitements curatifs Dépannage ou réparation Traitements préventifs Entretien et surveillance Opérations, greffes, … Rénovations, modernisations, échanges standards Longévité Durabilité Bonne santé Fiabilité Mort Rebut MEDECINE MAINTENANCE 2. IMPLICATIONS DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2.1. IMPLICATIONS INTER-SERVICES La Maintenance Industrielle joue de plus en plus un rôle central dans l’organisation de la production, au travers des différentes activités qu’elle regroupe, ainsi que l’exprime le schéma suivant : PAGE 2 SUR 12 M A I N T E N A N C E 2 E M E P A R T I E 2.2. IMPLICATIONS INTER-DISCIPLINAIRES Gestion : Politique générale de l’entreprise, budget, stocks et sous-traitance Fabrication : Disponibilité et amélioration opérationnelles des équipements Ressources Humaines : Compétences et quantité des opérationnels MAINTENANCE INDUSTRIELLE Conception : Disponibilité & amélioration prévisionnelles des produits Environnement : Sécurité des biens & personnes, et traitement des déchets Commercialtion : Achat de matériel et service après-vente De la même façon que la maintenance est amenée aujourd’hui à jouer un rôle central dans la vie des entreprises de production, le fait que les ressources humaines qui la composent interviennent sur des matériels pluritechniques impose des compétences dans de nombreuses disciplines connexes. Ces compétences sont assurées de deux manières différentes, soit par un certain nombre de techniciens spécialisés, soit par quelques intervenants parfaitement polyvalents et transversaux. Les disciplines auxquelles est confronté le service maintenance quasi continuellement sont : ) Mécanique : intervention sur des organes associés à la transmission de puissance (pignons, engrenages, crémaillères…), au guidage (roulements, paliers…), à l’étanchéité (joints…), à la lubrification (graisse, huile…), etc… ) Electricité : intervention sur des systèmes de génération de puissance (centrales…), ou de transformation d’énergie. ) Electrotechnique : entretien des organes associés à la conversion d’énergie (moteurs, variateurs…), à la distribution (câblage), à la protection (fusibles, interrupteurs, disjoncteurs…), etc… ) Electronique : maintenance de l’ensemble des composants associés aux cartes électroniques (circuits imprimés, amplificateurs opérationnels, diodes, résistances, diodes, microprocesseurs,…) ) Informatique : intervention sur des organes physiques (connecteurs, supports de stockage…), et logiciels (programmation,…), etc… ) Automatisme : vérification du fonctionnement des organes de détection (capteurs…), ou du traitement des tâches (logique câblée ou programmée…). ) Thermodynamique : intervention sur des organes associés à la conversion d’énergie thermique (pompes à chaleurs…) ) Fluidique : maintenance des systèmes de conversion d’énergie hydraulique ou pneumatique (centrales, pompes, régulateurs…). PAGE 3 SUR 12 M A I N T E N A N C E 2 E M E P A R T I E ) Métallurgie : intervention sur des structures métalliques ou composites, que ce soit afin d’en entretenir la résistance ou d’en détecter les risques de rupture. ) Manutention : gestion des matériels de levage et respect des conditions de sécurité. Cette liste, bien que très loin d’être exhaustive, montre déjà l’étendue des savoirs et savoir-faire que doit détenir un service maintenance pour être efficace. De plus, étant donné l’évolution permanente des technologies, en particulier dans le domaine de la commande électronique (systèmes microprogrammés), on s’oriente de plus en plus vers des structures d’équipes pluridisciplinaires, au détriment des « hommes à tout faire » de l’ancien temps… 3. TYPOLOGIES DE MAINTENANCES Il n’existe pas qu’un seul type de maintenance dans les faits, car là où la définition précédente de l’encyclopédie Hachette ne laisse entrevoir curieusement que la notion d’ « entretien », vient se greffer bien évidemment des actions curatives, préventives, et bien d’autres encore ainsi que le présente le schéma suivant. Chacun de ces types de maintenance est défini de façon normalisée selon l’AFNOR, dans le document repéré NF-X60-010. Il faut cependant avant toute chose garder à l’esprit que les actions de maintenance sont scindées en deux grandes familles, en l’occurrence le « Correctif » et le « Préventif », et que la part de ces deux familles dans l’entreprise témoigne de sa prise de conscience des impacts de la maintenance dans son efficacité industrielle. Malgré tout, il manque toujours dans l’ensemble des définitions l’aspect économique, c'est-à-dire celui du coût ! Cette lacune est en fait comblée dans le document d’introduction normatif X 60-000, qui spécifie que « Bien maintenir, c’est assurer ces opérations au coût global optimal ». 3.1. STRUCTURE & DEFINITIONS DES DIFFERENTS TYPES DE MAINTENANCE Curative Intervention définitive et limitée de maintenance après défaillance Palliative Action sur un bien en vue de le remettre provisoirement en état de fonctionnement Systématique Maintenance effectuée selon un échéancier établi dans le temps ou le nombre d’unités d’usage Conditionnelle Maintenance subordonnée à un type d’événement prédéterminé (mesure, diagnostic…) Prévisionnelle Maintenance préventive subordonnée à l’analyse de l’évolution surveillée de paramètres significatifs de l’état de dégradation du bien, permettant de retarder et de planifier les interventions Corrective Maintenance effectuée après défaillance Préventive Maintenance effectuée dans l’intention de réduire la probabilité de défaillance MAINTENANCE Ensemble des actions permettant de maintenir ou rétablir un bien dans un état spécifique ou en mesure d’assurer un service déterminé au moindre coût PAGE 4 SUR 12 M A I N T E N A N C E 2 E M E P A R T I E Quelques remarques : ) La Maintenance Prévisionnelle est parfois appelée de façon impropre « Maintenance Prédictive » ) Toutes les formes de maintenance présentées peuvent amener les équipements à avoir une efficacité accrue. On parlera alors de « Maintenance améliorative » ) Dans ce type de schéma n’apparaît pas une certaine forme de maintenance dite « de ronde », à la limite du systématique, et qui n’a pas vraiment de définition normalisée. Elle consiste en de petites visites relativement fréquentes, assez courte, et engendrant si nécessaire des actions préventives très limitées 4. LES MISSIONS DE LA MAINTENANCE Afin de garantir la gestion optimisée du système de production, on peut entrevoir de façon générale les missions que doit assurer un service maintenance au travers de trois facteurs primordiaux, en l’occurrence ) Facteur Technique : Assurer la Fiabilité et la Maintenabilité, c'est-à-dire la disponibilité en général, par l’étude du comportement du matériel ) Facteur Economique : Analyser précisément les coûts, directs et indirects, engendrés par les actions de maintenance, en vue d’établir des indicateurs permettant de choisir une politique adaptée ) Facteur Humain : Garantir la sécurité des biens et des personnes, au travers des normes et des règlements, afin d’optimiser les conditions uploads/Industriel/ 2-concepts-de-base-de-la-maintenance-industrielle.pdf
Documents similaires







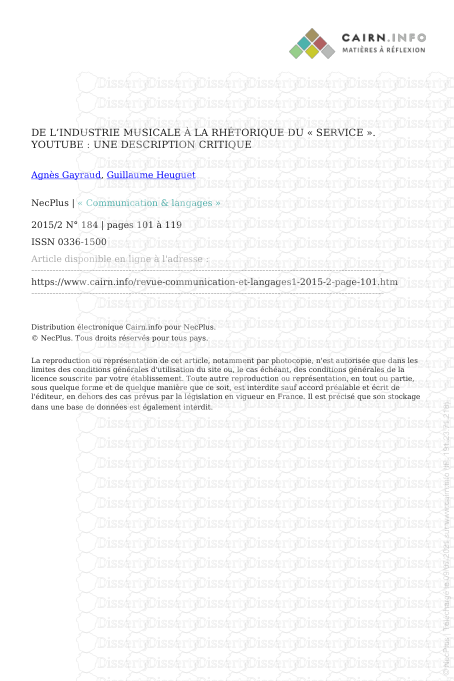


-
86
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 06, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8351MB


