18 Résumé La production des déchets urbains est une source majeure de pollution
18 Résumé La production des déchets urbains est une source majeure de pollution qui pose des problèmes au niveau environnemental et sanitaire. Les ordures ménagères peuvent être traitées par compos- tage et le refus éliminé, soit par incinération soit par recyclage des co-produits. La fermentation aérobie des ordures ména- gères entraîne l’obtention d’un amendement organique indis- pensable à l’amélioration de la qualité des sols. L’objectif de cette étude est de suivre la qualité du compost produit. Le suivi des paramètres de fonctionnement au cours des étapes de fermentation et de la maturation permet une estimation de sa valeur agronomique et de la contamination éventuelle des plantes par les métaux lourds. L’évaluation de l’impact du compost en agriculture a été effectuée sur deux variétés de cultures et avec deux types de sols agricoles qui ont été mélangés à des proportions varia- bles du compost. Le produit obtenu est classé comme un compost « moyen ». De même, le taux de 25 % du compost urbain est le plus bénéfique et n’engendre pas d’effets néfastes et toxiques pour la culture. L’utilisation d’une dose dépassant cette valeur peut ralentir le développement des végétaux et augmenter la teneur en métaux lourds dans les feuilles et les fruits. Mots clés : déchets urbains, compostage, amendement orga- nique, fermentation aérobie, maturation, valeur agronomique. Introduction Les déchets sont à la fois une source de nuisances pour l’en- vironnement et un gisement important pour la récupération des matières premières. La valorisation des déchets reste le moyen le plus intéressant pour préserver la qualité de l’envi- ronnement. Les filières de récupération et de valorisation sont multiples pour une meilleure gestion des déchets. Les procédés de traitement des déchets ménagers contri- buent largement à la réduction des nuisances et de leur impact sur l’environnement (Debray, 2002). Le compostage des ordures ménagères est le plus répandu car il conduit à leur valorisation et à la gestion de la matière organique. Le compostage présente un double objectif : — produire un amendement organique sans impact négatif sur l’environnement ; — réduire les nuisances des déchets en contribuant au main- tien de la qualité de l’environnement. L’utilisation du compost des déchets ménagers comme amendement organique est devenue courante. Les études effectuées ont montré que la valeur fertilisante et agronomi- que du compost est caractérisée par la teneur en matière organique, en métaux lourds, en éléments minéraux majeurs et en oligo-éléments (Feix, 2007). Ces éléments sont phyto- toxiques et indispensables aux sols et ils sont aussi considé- rés comme polluants potentiels des sols et des nappes phréa- tiques. Plusieurs études ont été effectuées faisant apparaître les ori- gines, les teneurs et les formes chimiques des différentes composantes des déchets ménagers (Gourdon, 2001). Les fractions compostables et fermentescibles telles que les papiers et les cartons, les matières indésirables et inertes ont fait l’objet de nombreuses études de valorisation, de recy- clage et de réutilisation des produits finis (Hafid, 2002). Le compost présente un intérêt qui se traduit par une amé- lioration de la structure du sol, de sa perméabilité et de son pouvoir de rétention d’eau (Gourdon, 2001). La faible teneur en oligo-éléments tels que le zinc et le cuivre est bénéfique pour un meilleur développement végétal. Ainsi, la valeur agronomique du compost est indéniable du point de vue matière organique et des éléments nutritifs qui sont libérés au fur et à mesure de la dégradation de la matière organique (Mamo et al ,1999 ; Mays, 2002). Cet article met l’accent sur l’étude de la qualité du compost des ordures ménagères, son évolution au cours du compos- tage et son utilisation dans le domaine agricole. Le compos- tage est l’une des solutions attribuées à l’élimination des ordures ménagères. Le compost produit présente souvent des problèmes de maturité et d’existence de matières indé- sirables déconseillées pour l’agriculture. Cependant, l’évalua- tion de la qualité agronomique du compost a été effectuée sur un certain nombre de cultures, plantées à différentes doses du compost (0 %, 25 %, 50 %, 75 %). DÉCHETS - REVUE FRANCOPHONE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE - N° 50 - 2e TRIMESTRE 2008 - REPRODUCTION INTERDITE Etude des caractéristiques physico-chimiques et contribution à la valorisation agronomique du compost des ordures ménagères Jawad AOUN, Dunia BOUAOUN Université Libanaise - Faculté des Sciences (II) - Département de chimie - BP 90656 - Jedeidet-el-Metn - FANAR - Liban Pour toute correspondance : aounjawad@hotmail.com 19 DÉCHETS - REVUE FRANCOPHONE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE - N° 50 - 2e TRIMESTRE 2008 - REPRODUCTION INTERDITE Etude des caractéristiques physico-chimiques et contribution à la valorisation agronomique du compost des ordures ménagères Au cours de la phase de croissance des cultures, des échan- tillons ont été prélevés et analysés afin de suivre l’impact de chaque amendement sur la plante. Les résultats obtenus ont montré que la dose de 25 % semble la plus apte à améliorer la qualité des cultures. Matériel et méthodes Origine des échantillons Le compost étudié est produit par une usine mixte (incinéra- tion - compostage) de traitement des déchets urbains située dans la ville de Beyrouth (LIBAN). Le système de traitement utilisé est celui d’une fermentation aérobie accélérée (Procédé SILODA - OTV). Après le traitement d’affinage, la maturation s’effectue en andains. La chaîne de traitement classique est représentée par la figure 1. Figure 1: Chaîne de traitement classique des déchets urbains de l’usine. Cette usine a une capacité de traitement 500 tonnes/jour de déchets et son fonctionnement consiste à composter les ordures et incinérer les refus. Le compost affiné est de granulométrie moyenne de diamè- tre douze millimètres, généralement bien humidifié et dont la qualité est souvent contestée, d’où l’objet de notre étude. Les échantillons ont été prélevés à différents niveaux et après retournement des tas, de manière à obtenir un échantillon aussi représentatif que possible (20 à 30 kg) et ceci au cours de la phase de maturation. Nous avons utilisé pour tous nos essais un compost âgé de 35 jours. Méthodes analytiques du contrôle de qualité La norme française AFNOR NFU 44051 - Amendements organiques (Afnor, 1981) définit la qualité des composts utili- sés en agriculture, en particulier les composts urbains. Certains paramètres physiques déterminent l’aspect qualitatif du compost tels que la granulométrie, la teneur en corps étrangers ou indésirables (verre, plastique, métal). Les paramètres physico-chimiques permettant de contrôler la qualité du compost et sa valeur fertilisante sont les suivants : — pH, température et conductivité (μScm-1) ; — humidité (%) et matières sèches (MS) exprimées en % ; — matières organiques (MO) exprimées en % de MS ; — phosphore (P), potassium (K+), chlorures (Cl-), sodium (Na+) et magnésie (MgO) exprimés en % de MS ; — carbone organique (CO) exprimé en g.L-1 déterminé par la méthode Anne ; — azote total Kjeldahl (NTK) exprimé en g.L-1 (Méthode Kjeldahl, Afnor, 1981) ; — teneur en métaux lourds : plomb (Pb), cadmium (Cd), zinc (Zn), cuivre (Cu) et mercure (Hg). La teneur a été déter- minée par spectrophotométrie d’absorption atomique et exprimée en ppm (Afnor, 1981) ; — teneur en germes pathogènes : le contrôle de la présence des germes a été effectué sur des milieux de culture spé- cifiques en vue d’isoler et d’identifier les germes aérobies et anaérobies (Afnor, 1981) ; — maturité du compost : elle a été déterminée par mesure de la respirométrie à l’aide du respiromètre « GONAN ». Nous avons utilisé dans cette partie de l’étude le respiro- mètre de GANONG (Ganong’s respirometer) caractérisé par les points suivants : • La première cellule du respiromètre (A) contient de l’hydroxyde de potassium KOH (1N) permettant d’absorber le volume du gaz carbonique (CO2) dégagé. La variation du déplacement de la solution dans le manomètre nous conduit à la détermination du volume de l’O2 consommé en fonction du temps (par heure ou par jour). La masse de l’O2 consommé est calculée selon la relation suivante : mO2 = 1,428.VO2 avec : VO2 exprimé en ml ou en cm3 du liquide déplacé mO2 exprimée en mg d’O2 consommé par gramme du compost. La masse du CO2 produite est calculée selon la relation suivante : mCO2 =1,977.VCO2 avec : VCO2 exprimé en ml ou en cm3 du liquide déplacé mCO2 exprimée en mg de CO2 produit par gramme du compost. • La deuxième cellule du respiromètre (B) contenant de l’eau (H2O) permet, suivant le déplacement du liquide dans le manomètre, de déterminer le volume de l’O2 consommé. Le volume du CO2 dégagé est minimisé par sa faible dissolution dans l’eau. 20 DÉCHETS - REVUE FRANCOPHONE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE - N° 50 - 2e TRIMESTRE 2008 - REPRODUCTION INTERDITE Etude des caractéristiques physico-chimiques et contribution à la valorisation agronomique du compost des ordures ménagères Ainsi, la respirométrie consiste à mesurer soit le volume de CO2 dégagé ou produit, soit le volume de l’O2 consommé. Ce volume produit ou consommé peut être suivi soit par tranche horaire, soit quotidiennement. La technique respiro- métrique est une méthode quantitative d’évaluation de la maturité du compost. Plusieurs essais ont été effectués afin d’évaluer la durée nécessaire pour avoir un compost mûr. La détermination de la respiration uploads/Industriel/ 4-aoun.pdf
Documents similaires
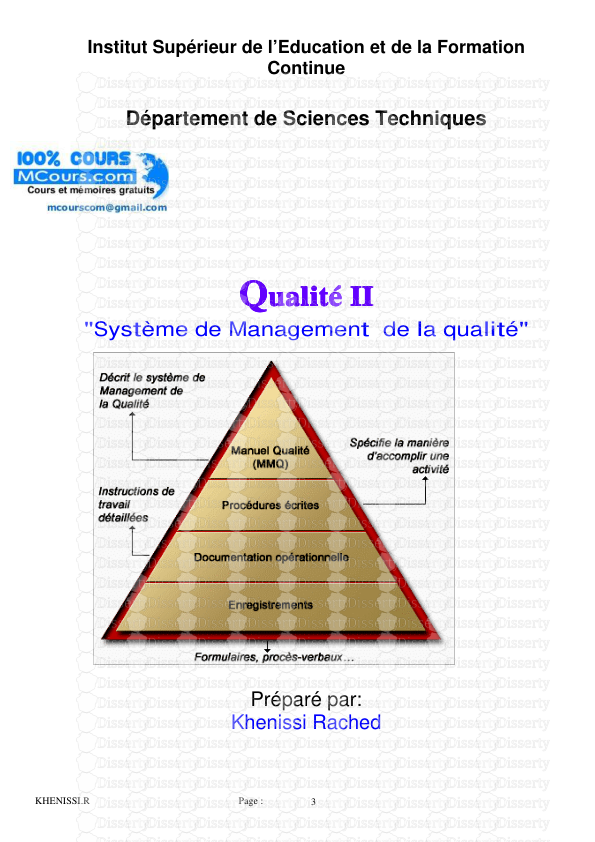









-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 08, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3339MB


