a Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts po
a Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels sur l’environnement et recommandations Rapport final BRGM/RP-61968-FR Février 2013 Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels sur l’environnement et recommandations Rapport final BRGM/RP-61968-FR Février 2013 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2012 PSP12GUY30 Moisan M., Blanchard F. Vérificateur : Nom : F. BLANCHARD Date : 08/03/13 Signature : Approbateur : Nom : A. BLUM Date : 08/03/13 Signature : En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique, l’original signé est disponible aux Archives du BRGM. Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2008. I M 003 - AVRIL 05 Mots clés : Cyanure, mine, or, environnement, Guyane. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : MOISAN M. et BLANCHARD F., 2012. Utilisation de la cyanuration dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels sur l’environnement et recommandations. Rapport final BRGM/RP- 61968-FR, 120 pages. © BRGM, 2013, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Utilisation des cyanures dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels et recommandations BRGM/RP-61968-FR – Rapport final 3 Synthèse La technique de cyanuration dans l’industrie aurifère est la plus utilisée à travers le monde, il n’existe à l’heure actuelle aucune alternative adéquate à l'utilisation du cyanure pour l'extraction de l’or. La technologie de cyanuration n’est pas encore employée pour la récupération de l’or en Guyane, même si des projets pilotes ont été menés par le passé (Changement) ou envisagés (Camp Caïman, Cambior) avec des résultats probants. A terme les compagnies minières auront peut-être recours à cette technologie dans le cadre de projets, à l’échelle industrielle, comme dans d’autres parties du monde. L’objet de cette étude, cofinancé par la DEAL Guyane et l’Office de l’Eau Guyane, est de présenter cette technologie et les impacts potentiels que pourraient avoir son utilisation en Guyane du point de vue de ses caractéristiques géographiques, écologiques et climatiques particulières. La chimie du cyanure est complexe et ses propriétés nécessitent d’être comprises afin de pouvoir gérer ses applications industrielles et ses effets potentiels sur le milieu naturel. Le rapport décrit les différentes formes de cyanures, leurs propriétés (solubilité et stabilité variables) et leur toxicité qui varie suivant les molécules. Le cyanure faiblement dissociable (WAD) est la forme la plus toxique mais les produits de dégradation naturelle ou liés à un traitement, bien que moins toxiques peuvent présenter un risque pour l’environnement aquatique. En effet les écosystèmes aquatiques sont plus sensibles aux cyanures que les écosystèmes terrestres. Le cyanure est utilisé pour les gîtes d’or primaires. Le principe de cette technique repose sur la propriété du cyanure de se complexer et de rendre soluble l’or. Cette procédé chimique est appelé lixiviation. Les différentes techniques mises en œuvre dépendent de la granulométrie, minéralogie et teneurs des minerais, elles sont décrites dans le rapport (lixiviation en cuves, lixiviation en tas). On considère qu’il faut environ 300 à 2000 grammes de cyanure de sodium par tonne de minerai pour obtenir une extraction efficace. Les résidus issus du traitement du minerai sont composés de matériaux très fins avec des fortes teneurs en eau, ils sont gérés conventionnellement comme des liquides et stockés dans des parcs à résidus derrière des digues. Les résidus de la cyanuration produisent des boues très alcalines, riches en ions cyanures, en complexes de cyanures métalliques stables et en produits de transformation des cyanures. La concentration en métaux et métalloïdes dans les boues est fonction de la composition chimique du minerai. La présence de larges quantités de boues liquides chargées en produits dangereux stockées derrière des digues peut avoir des effets désastreux sur l’environnement en cas de fuite ou de rupture de ces digues. Le rapport examine les différentes causes de défaillance des digues avec en particulier les problématiques de management ou d’événements climatiques exceptionnels. Cette dernière cause, a l’origine de l’accident de Baia Mare en Roumanie, a cristallisé une opposition à l’utilisation du cyanure. Utilisation des cyanures dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels et recommandations 4 BRGM/RP-61698-FR – Rapport final Ces graves accidents ont amené les autorités à faire évoluer les pratiques et la réglementation quant à l’utilisation du cyanure dans l’industrie aurifère. Les dernières évolutions en termes de norme de rejets (de plus en plus strictes) dans les parcs à résidus ou dans le milieu naturel au niveau européen, français et international sont présentées dans le rapport. Les Directives Européennes sur les déchets miniers et les émissions des installations industrielles précisent les conditions d’utilisation du cyanure et l’application des « Meilleures Techniques Disponibles » (MTD) dans la gestion des sites miniers dont la destruction du cyanure avant rejet dans les parcs à résidus. Par ailleurs, la profession a mis en place « Le code international de gestion du cyanure » qui est une initiative à adhésion volontaire constituée par les sociétés minières, les producteurs et les transporteurs du cyanure. Il vise à compléter les réglementations existantes et il a pour objectif la gestion en toute sécurité de l’usage du cyanure. Un extrait du code est annexé au présent rapport. Aujourd’hui, l’évolution des bonnes pratiques se focalisent sur la réduction de la consommation de cyanure et l’optimisation du recyclage et de leur destruction avant stockage dans les parcs à résidus. Une autre possibilité qui se développe, et permet de limiter les risques de rejets accidentels des résidus dans l’environnement (en particulier en climat équatorial), est la prise en considération des nouvelles techniques de stockage (par épaississement) qui permet de stocker les résidus sous forme solide et non sous forme de boues liquides. La fermeture et la réhabilitation de ces parcs résidus sont aussi très importantes sous climat équatorial, en seront facilités car il faut garantir la pérennité des solutions de confinement de ces résidus sur le long terme. La qualité des infrastructures et en particulier de l’accessibilité aux sites miniers est importante dans ce type d’opération industrielle car la mine a besoin d’un ravitaillement régulier, qui se fait normalement par camion, en cyanure (caisse d’une tonne ou fûts) et d’autres produits chimiques tels que les acides, carburants, etc. Enfin, la Guyane possède des teneurs naturelles en mercure dans les sols et les roches, les procédés de traitement pour récupérer l’or vont faciliter la concentration du mercure dans les jus cyanurés. Ce mercure est susceptible d’être libéré dans l’atmosphère aux différentes étapes du procédé et des mesures de prévention d’émissions et de récupération du mercure devront être mises en place ; elles seront fonction des concentrations initiales en mercure dans le minerai. D’une manière générale les règles de gestion du cyanure et l’application de bonnes pratiques s’appliquent au contexte guyanais, une grande partie des nouveaux projets miniers se situent en effet en zone équatoriale et tropicale. Toutes ces pratiques, comme celles listées dans le Code international de gestion du cyanure, doivent faire partie d’un Système de Management Environnemental global mis en place au niveau de la mine avec des audits indépendants effectués à intervalle régulier. La qualité du management est importante, comme dans toute opération industrielle, de même que l’existence de contrôles réguliers des opérations minières par des experts indépendants et par les autorités. Utilisation des cyanures dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels et recommandations BRGM/RP-61968-FR – Rapport final 5 Sommaire 1. Contexte et problématique ...................................................................................... 9 1.1. CONTEXTE ......................................................................................................... 9 1.2. OBJECTIF ........................................................................................................... 9 1.3. PRINCIPALES UTILISATIONS DU CYANURES .............................................. 10 2. Généralités sur les cyanures ................................................................................. 11 2.1. CHIMIE DES CYANURES ................................................................................. 11 2.1.1. Le cyanure libre (CN-) ............................................................................... 11 2.1.2. Les cyanures simples ............................................................................... 12 2.1.3. Les cyanures de complexes métalliques .................................................. 12 2.1.4. Produit de décomposition ......................................................................... 12 2.1.5. Problèmes analytiques ............................................................................. 13 2.2. INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT .................................................. 13 2.2.1. Interactions avec le milieu ........................................................................ 14 2.2.2. Persistance ............................................................................................... 15 2.3. VALEURS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES DE REFERENCES ..... 18 2.3.1. Dans le milieu du travail (air) .................................................................... 18 2.3.2. Valeurs de la qualité des eaux de consommation .................................... 18 2.3.3. Concentrations sans effets prévisible pour le milieu aquatique (PNEC) .. 19 3. La cyanuration dans l’industrie aurifère .............................................................. 21 3.1. PROCEDES DE CYANURATION ...................................................................... 22 3.1.1. Lixiviation en tas – Principes et généralités .............................................. 23 3.1.2. Lixiviation en tas - Pratiques et contraintes .............................................. 24 3.1.3. Lixiviation en tas – Essais réalisés en Guyane ........................................ 26 3.1.4. Lixiviation en tas – Conclusions et recommandations pour la Guyane .... 29 3.1.5. Lixiviation en cuve – Principes et généralités ........................................... 31 3.1.6. Lixiviation en cuve – Conclusions et recommandations pour la Guyane.. 36 3.2. TRAITEMENT DES RESIDUS ........................................................................... 38 3.2.1. Les processus chimiques ......................................................................... 38 3.2.2. Les processus biologiques ....................................................................... 41 Utilisation des cyanures dans l’industrie aurifère en Guyane. Impacts potentiels et recommandations 6 BRGM/RP-61698-FR – Rapport final 3.3. MERCURE ET CYANURATION ....................................................................... 42 3.4. GESTION DES CYANURES DANS L’INDUSTRIE AURIFERE ........................ 43 3.4.1. Accidents environnementaux ................................................................... 43 3.4.2. Conséquences sur l’utilisation du cyanure dans l’industrie minière: réponse de la profession et des institutions ............................................. 44 4. Les bonnes pratiques uploads/Industriel/ cyanuration-aurifere.pdf
Documents similaires






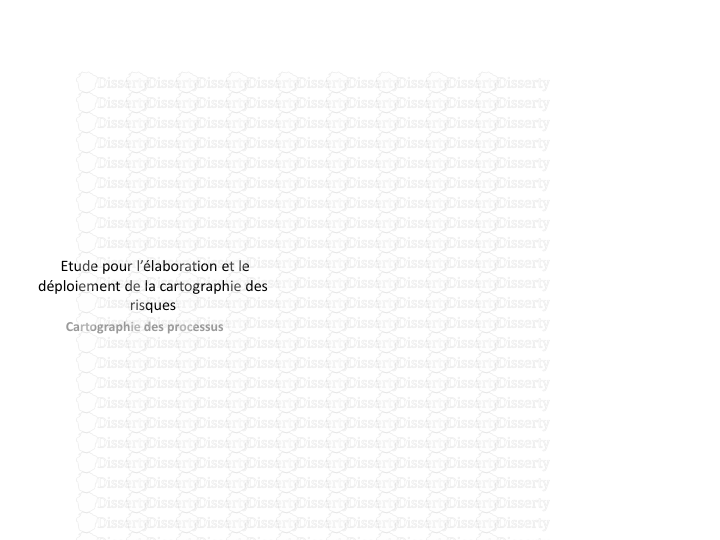



-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.7281MB


