Avant-propos En publiant ce traité minuscule, nous nous sommes proposés de prou
Avant-propos En publiant ce traité minuscule, nous nous sommes proposés de prouver à l’amateur, au photographe de profession et à l’imprimeur, que l’impression photographique aux encres grasses est un procédé simple et pratique. D’autres avant nous ont publié de belles études sur ce sujet, mais ces auteurs étaient ou des théoriciens, à qui échappaient certains petits détails de pratique, ou d’habiles praticiens qui n’ont pas eu le courage de faire connaître les petits tours de main, les ficelles d’atelier. Il nous a semblé que cet ouvrage ne pourrait que nous aider dans la campagne que nous avons entreprise pour propager en France ce merveilleux procédé qui est français d’origine, il faut hautement le proclamer. Il y a quatre ou cinq ans encore, c’est-à-dire trente ans après la découverte de Poitevin, les quelques maisons françaises qui exploitaient industriellement l’impression phototypique, n’employait que des machines allemandes, des ouvriers allemands et des encres allemandes. A l’heure actuelle, il n’en est plus ainsi, l’essor est donné (I) en France, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à faire avant que l’emploi si avantageux de la phototypie se soit généralisé et qu’elle rende dans toutes les branches de l’art et de l’industrie les services qu’on a le droit d’en attendre. I - NOTE DE L’EDITEUR — il est juste de dire que M. Voirin, en installant un laboratoire modèle, en y donnant des leçons pratiques, en centralisant tous les produits, tous les appareils nécessaires à ce genre d’impression, a puissamment contribué à vulgariser son emploi. AVENIR DE LA PHOTOTYPIE A l’heure actuelle, la Photographie a conquis ses lettres de grande naturalisation sur le terrain scientifique. Toutes les branches d’histoire naturelle et en particulier la minéralogie, les sciences médicales, la physiologie, la micrographie, ont recours communément, à l’objectif pour enregistrer leurs constatations, les phénomènes au milieu desquels nous vivons. L’astronomie, l’archéologie, les beaux-arts ont également besoin de reproduire fidèlement les sujets quels qu’ils soient qu’ils ont à étudier. Or, les documents que la photographie va désormais fournir, la diffusion des études scientifiques et artistiques exigera que l’on puisse les multiplier, les reproduire rapidement et avec économie. Il est notoire que le tirage au châssis positif devient insuffisant et c’est là que la phototypie sera partout l’auxiliaire indispensable aussi bien du savant que de l’artiste, aussi bien du maître que de l’élève. Dans l’ordre industriel, dans les métiers d’art, où il est d’usage de faire de grands sacrifices pour mettre sous les yeux d’une clientèle de choix des travaux d’impression soignée et luxueuse, la phototypie viendra prendre place à côté de la lithographie, et de la gravtirç, sur lesquelles elle aura, outre son cachet d’authenticité, les avantages appréciables de la douceur des demi-teintes et d’un modelé très artistique. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Définition. — La phototypie ou plus exactement la photocollographie (comme le congrès photographique de 1889 a décidé de l’appeler désormais) est un procédé d’impression photographique aux encres grasses dû au génie fécond de Poitevin. Il ne faut pas le confondre avec la photolithographie dont le principe a été également découvert par Poitevin et qui comprend un ensemble de procédés où l’action de la lumière sur certaines substances est utilisée en même temps que les propriétés classiques de la pierre lithographique. Quant à l’albertypie, l’héliotypie, la photochromie, l’héliochromie, la glyptographie, etc., ce sont des termes différents mais qui désignent le procédé photocollographique. Nous lui conserverons le nom de Phototypie qui lui a été consacré par l’usage. Avantages. — Le procédé phototypique permet d’obtenir rapidement et directement sur papier ou étoffe quelconque, ou par report, sur bois, métal, porcelaine, etc., etc., des épreuves inaltérables, à un prix bien inférieur à celui de n’importe quel procédé photographique. On peut en outre affirmer que les épreuves phototypiques ont une finesse au moins aussi grande que celles qu’on obtiendrait d’un même négatif sur papier aux sels d’argent ou de platine. - 9 - Ses quatre principaux avantages sont donc la rapidité d’exécution, l’inaltérabilité de la gravure, l’exactitude de la photographie et le bon marché des épreuves. Principes fondamentaux. — La phototypie est basée sur deux principes généraux: Premier principe. — La gélatine bichromatée qui a été exposée à la lumière devient imperméable à l’eau, c’est-à- dire qu’elle a pour l’eau une affinité d’autant moins grande qu’elle a été plus exposée à la lumière. Deuxième principe : - Les corps gras et en particulier les encres d’imprimerie se déposent sur les corps secs et sont repoussés par les corps humides. Faisons l’expérience suivante: Exposons à la lumière, sous un négatif ordinaire, une couche sèche de gélatine bichromatée ; les parties transparentes du cliché laisseront passer les rayons lumineux qui modifieront la nature de la gélatine (en vertu du premier principe), la durciront et la rendront impénétrable à l’humidité. Au contraire les régions de la gélatine protégées de l’action lumineuse par les noirs du cliché conserveront leur affinité pour l’eau. Laissons ensuite séjourner dans l’eau la gélatine insolée pour en éliminer le bichromate, faisons sécher la couche puis mettons-la sous un bain d’eau glycérinée. Une fois qu’elle est gonflée, tamponnons-la pour enlever l’excès d’eau. Passons maintenant sur sa surface un rouleau chargé d’encre grasse; en vertu du deuxième principe, les parties humides de la gélatine, c’est-à-dire celles qui se trouvaient sous les noirs du cliché, repousseront l’encre ; - 10 - au contraire, les autres parties, celles qui ont été insolées en prendront une quantité proportionnelle à leur degré de siccité. Si enfin nous mettons une feuille de papier en contact avec la surface de la gélatine et si nous donnons de la pression, le papier recevra une image positive donnant avec une exactitude minutieuse les moindres détails, les demi-teintes les plus délicates de l’objet photographié, Il est facile de voir par ce qui précède quelle analogie l’impression photographique présente avec la lithographie. Après les deux opérations de l’insolation et du mouillage, la couche de gélatine se comporte absolument comme la pierre lithographique après qu’elle a reçu le dessin et qu’elle a été lavée à l’eau acidulée, sauf cette différence que la pierre très poreuse doit être entretenue humide par des rouleaux mouilleurs, tout le temps du tirage, tandis que la couche de gélatine donne 50, 100 ou 200 images successives avant que l’on ait besoin de recourir à un nouveau mouillage. PREMIERE PARTIE ______ DU CLICHÉ NÉGATIF ______ Avant d’entrer dans la description détaillée des opérations nécessaires pour reproduire une image en phototypie, nous nous occuperons du négatif ou cliché photographique Nous supposerons que nos lecteurs sont familiarisés avec les manipulations photographiques élémentaires et nous les renvoyons aux nombreux ouvrages traitant de la photographie. Avant tout, pour faire une bonne phototypie, il faut un bon négatif, qu’il soit au collodion ou au gélatino-bromure d’argent. Comme c’est en partie de lui que dépendra la qualité de l’épreuve phototypique on ne saurait trop insister sur sa parfaite exécution. Les clichés durs doivent être rejetés sans pitié et l’on ne doit se servir que de négatifs harmonieux, sans grandes duretés dans les noirs et surtout fouillés dans les ombres (parties claires du négatif). La retouche pourrait, dans une certaine mesure, corriger ces duretés, mais on n’est pas toujours sûr d’y réussir. Un cliché bien mode1é, riche en demi-teintes, donnera toujours une excellente planche phototypique; s’il est quelque peu doux, on pourra donner à la planche de l’opposition de l’effet, en se servant d’encres plus dures, plus compactes. - 12 - REMARQUE IMPORTANTE ______ Logiquement il était nécessaire que nous nous occupions du négatif un premier lieu cependant nous engageons les lecteurs qui veulent bien nous suivre à ne pas s’arrêter lonptemps à la première lecture sur toute cette première partie. Qu’ils lisent les considérations qui expliquent la nécessité du retournement du négatif, qu’ils notent comme conséquence l’utilité des plaques pelliculaires et la méthode si simple de leur emploi et qu’ils s’attachent de suite à la lecture attentive de la Deuxième Partie. Lors qu’ils auront saisi l’ensemble des opérations de la préparation d’une glace phototypique, qu’ils prennent un négatif doux et harmonieux dans les clichés qu’ils possèdent et qu’ils s’en servent tel quel pour insoler une glace phototypique. En examinant les premières épreuves encrées, ils constateront eux-mêmes qu’un retournement préalable du négatif était nécessaire. Plus tard quand ils seront familiarisés avec les manipulations phototypiques proprement dites, ils devront se reporter à la première partie dont la lecture sera pour eux pleine de fruits. Ils pourront alors se placer dans chacune des hypothèses qui y sont admises et employer successivement des plaques pelliculaires, des pellicules libres, des clichés au collodion - faire des contretypes - essayer le procédé au bichromate de potasse, pratiquer des décollements de clichés au gélatino, et enfin s’exercer à l’accouplement de plusieurs négatifs sur une même planche. - 13 - De la nécessité du retournement du cliché. Pour avoir une épreuve phototypique donnant l’image de l’objet tel qu’on le voit, il est nécessaire de retourner le cliché - En effet, si l’insolation, de la gélatine bichromatée était faite sans retourner le cliché, on obtiendrait sur la glace phototypique une image positive représentant exactement uploads/Industriel/ manuel-pratique-de-phototypie-j-voirin-1892.pdf
Documents similaires


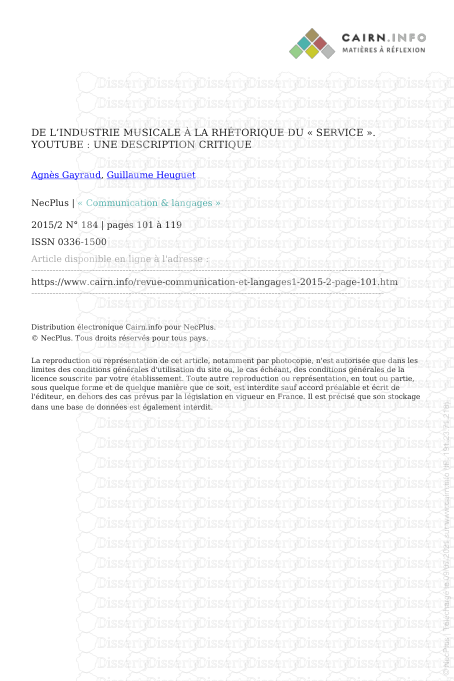







-
72
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 25, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 3.6853MB


