Georg Lukács La spécificité de la sphère esthétique. Neuvième Chapitre : Problè
Georg Lukács La spécificité de la sphère esthétique. Neuvième Chapitre : Problèmes de la mimésis V, la mission défétichisante de l’art. Traduction de JeanPierre Morbois 2 GEORG LUKÁCS : PROBLÈMES DE LA MIMÉSIS V LA MISSION DÉFÉTICHISANTE DE L’ART. 3 4 Ce texte est le neuvième chapitre de l’ouvrage de Georg Lukács : Die Eigenart des Ästhetischen. Il occupe les pages 696 à 777 du tome I, 11ème volume des Georg Lukács Werke, Luchterhand, Neuwied & Berlin, 1963, ainsi que les pages 660 à 739 du tome I de l’édition Aufbau Verlag, Berlin & Weimar, DDR, 1981. Les citations sont, autant que possible, données et référencées selon les éditions françaises existantes. À défaut d’édition française, les traductions des textes allemands sont du traducteur. De même, lorsque le texte original des citations est en anglais ou en italien, c’est à celuici que l’on s’est référé pour en donner une traduction en français. Le traducteur a enrichi le texte de nombreuses notes de bas de page, pour expliciter certains termes, ou signaler des problèmes de traduction. Chaque nouveau nom propre rencontré fait l’objet d’une note situant le personnage, ne seraitce que par ses dates de naissance et de décès. Ces notes pourront paraître superflues à nombre de nos lecteurs, notamment lorsqu’elles concernent des personnes bien connues, mais elles peuvent constituer pour d’autres un rappel utile. Les expressions en français dans le texte sont en italique et marquées d’une *. GEORG LUKÁCS : PROBLÈMES DE LA MIMÉSIS V LA MISSION DÉFÉTICHISANTE DE L’ART. 5 Neuvième chapitre. Problèmes de la mimésis V. La mission défétichisante de l’art. Dans Le Capital, Marx a décrit de manière exacte le processus du fétichisme de la marchandise, issu des tendances d’évolution sociales nécessaires et des structures sociales qu’elles produisent : « Ce qu'il y a de mystérieux dans la formemarchandise consiste donc simplement en ceci qu'elle renvoie aux hommes l'image des caractères sociaux de leur propre travail comme des caractères objectifs des produits du travail euxmêmes, comme des qualités sociales que ces choses posséderaient par nature : elle leur renvoie ainsi l'image du rapport social des producteurs au travail global, comme un rapport social existant en dehors d'eux, entre des objets. C'est ce quiproquo qui fait que les produits du travail deviennent des marchandises, des choses sensibles suprasensibles, des choses sociales… C'est seulement le rapport social déterminé des hommes euxmêmes qui prend ici pour eux la forme phantasmagorique d'un rapport entre choses. » 1 Ce qui en l’occurrence est décisif pour notre propos, c’est que la connaissance défétichisante reconvertit ce qui se présente en apparence comme une chose en ce qu’il est en soi : en une relation entre les hommes. Le mouvement qui est réalisé là, et qui rétablit dans ses droits le véritable état de fait est donc double : d’un côté, il démasque une apparence trompeuse qui, bien qu’elle soit nécessairement issue de causes sociales, ‒ ici en raison d’une économie hautement 1 Karl Marx, Le Capital, Livre I, édition JeanPierre Lefebvre, Paris, Quadrige PUF, 2009, pp. 8283. 6 développée, dans d’autres cas en raison de son arriération ‒ déforme cependant la vraie nature de la réalité. Deuxièmement, cette rectification permet en même temps de sauver le rôle de l’homme dans l’histoire. L’apparence a rabaissé l’importance de l’homme : « Leur mouvement social propre a pour les échangistes la forme d'un mouvement de choses qu'ils ne contrôlent pas, mais dont ils subissent au contraire le contrôle. » 2 La vérité transforme les choses apparemment existantes et dominantes en relations des hommes entre eux, qui ‒ dans certains cas ‒ peuvent être en mesure de les contrôler et de les dominer ; pourtant, même si ce n’est pas possible, un « destin » qui semble résulter de la nature des choses apparaît comme un produit de l’évolution de l’humanité, et donc, de ce point de vue, comme un destin produit par les hommes euxmêmes. Pour la connaissance scientifique, les deux moments de ce mouvement de pensée dans le reflet de la réalité sont pareillement importants ; si l’un des deux pouvait, en tant qu’universel et fondamental, revendiquer une suprématie, ce serait le premier. Pour l’art, la situation qui se crée est quelque peu différente. Le premier moment conserve certes son caractère fondamental, car sans une certaine compréhension de cet état de fait fondamental, toutes les conséquences reposeraient sur du vent. L’importance décisive, dans le reflet esthétique, c’est pourtant au deuxième moment qu’elle revient. Car le cœur de son mouvement de reproduction dans la réflexion de la réalité et toujours constitué par la compréhension de l’homme, de l’universel de l’humanité, 3 par la revendication des droits de 2 Ibidem p. 86. 3 Lukács évoque ici l’universel de l’humanité [Menschheitlich], qui se construit historiquement et fait progressivement l’objet d’une prise de conscience, en opposition à la conception idéaliste d’un « éternel humain » [allgemein Menschlich]. NdT. GEORG LUKÁCS : PROBLÈMES DE LA MIMÉSIS V LA MISSION DÉFÉTICHISANTE DE L’ART. 7 l’homme dans la société comme dans la nature. Ce mouvement peut se limiter à la simple reproduction de la réalité ; mais même dans ce cas, le quoi et le comment de la reproduction représentent une prise de position dans cette direction ; cette prise de position peut naturellement se transformer ouvertement en une prise de parti, et elle le fait très souvent, justement dans les œuvres d’art les plus éminentes. M. Arnold a donc tout à fait raison quand il dit que la poésie est au fond une « critique de la vie ». 4 Selon le type d’art, la période, la nation et la classe sociale, cette critique a différents contenus et différents modes d’expression. Mais si l’on veut résumer ce qu’il y a là de plus général, on en arrive alors à cette revendication des droits de l’homme que nous venons de citer. De ce point de vue, la découverte de Marx a une énorme importance pour la théorie de l’art. Presque tous les artistes importants de 19ème et du 20ème siècle se sont confrontés à ce problème ; assurément ‒ ce qui est une fois encore significatif du rapport de la théorie et de l’art ‒ presque toujours sans connaître le moins du monde la première tendance de Marx, celle du dévoilement, et en prenant la deuxième principalement de manière spontanée dans ses conséquences humaines. Il n’y a rien de surprenant à cela ; l’art suit ici simplement le cours normal de la vie. Marx dit même de la connaissance scientifique de ce phénomène : « La réflexion sur les formes de l'existence humaine, et donc aussi l'analyse scientifique de ces formes, emprunte de toute façon une voie opposée à celle du développement réel. Elle commence post festum et, du coup, part des résultats achevés du processus de développement. » 5 4 Matthew Arnold (18221888), poète et critique anglais. Essays in Criticism, second series, Londres, MacMillan & Co, 1913, p. 143. 5 Karl Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 86. 8 Balzac et (en ce qui concerne certains domaines de vie) Tolstoï, font partie de ceux, peu nombreux, chez qui cette tendance imprègne toute leur œuvre. La lutte pour l’intégrité de l’homme, contre tout semblant ou toute manifestation de sa déformation constitue ‒ comme bien sûr aussi chez d’autres artistes importants ‒ le contenu essentiel de leurs œuvres. Ce n’est que lorsque, comme pour des parties non négligeables de l’art bourgeois tardif de la période impérialiste, se produit une capitulation devant le fétichisme, que l’art doit renoncer à son contenu principal, à ce combat pour l’intégrité de l’homme, à la critique de la vie de ce point de vue. La prise de position à l’égard du fétichisme, ‒ peu importe si celuici est reconnu comme tel ‒ va être la ligne de partage entre pratique progressiste de l’art et pratique réactionnaire. Il est caractéristique que T. S. Eliot, au sujet de la définition de la poésie par Arnold citée à l’instant, dise la chose suivante : « Si nous pensons la vie comme un tout… du haut en bas, est ce que ce que nous pouvons en dire, en fin de compte, de cet affreux mystère, peut encore être appelé critique. » 6 Le problème crucial de cette capitulation consiste en ce qu’elle en reste à l’immédiateté des formes de vie fétichisées et, même si leur inhumanité est pleinement évidente, qu’elle ne se tourne pas suffisamment vers l’essence pour mettre en lumière les véritables corrélations, mais accepte au contraire sans résister, comme vérité ultime, l’aspect superficiel fétichisé. Ce comportement peut s’exprimer sous les formes subjectives de réaction les plus diverses ; pourtant, que s’y expriment du nihilisme, du cynisme, du désespoir, de la peur, de la mystification, de l’autosatisfaction etc. n’a qu’une importance secondaire pour la question qui est ici décisive : 6 Thomas Stearns Eliot (18881965), poète, dramaturge américain naturalisé britannique. Prix Nobel de littérature 1948. The Use of Poetry [l’utilité de la poésie] Londres, Faber & Faber LTD, 1934, p. 111. GEORG LUKÁCS : PROBLÈMES DE LA MIMÉSIS V LA uploads/Industriel/georg-lukacs-esthetique-neuvieme-chapitre-problemes-de-la-mimesis-v.pdf
Documents similaires



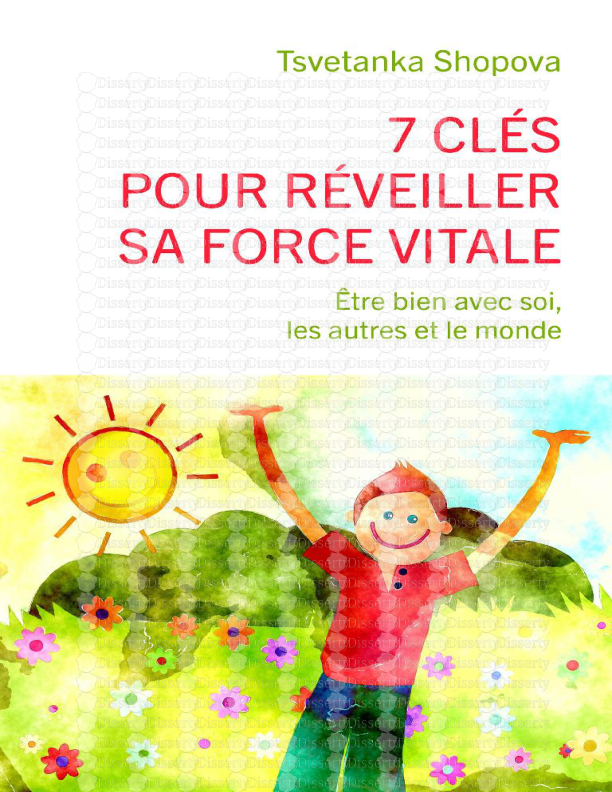






-
102
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 13, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0460MB


