Appareil Articles L’art, la technique – ou du pareil au même. Douze proposition
Appareil Articles L’art, la technique – ou du pareil au même. Douze propositions sur la reproduction Intervention au Collège International de Philosophie (« Samedi du livre » consacré à Jean-Louis Déotte) Jean Lauxerois Electronic version URL: http://appareil.revues.org/120 ISSN: 2101-0714 Publisher MSH Paris Nord Electronic reference Jean Lauxerois, « L’art, la technique – ou du pareil au même. Douze propositions sur la reproduction », Appareil [Online], Articles, Online since 10 February 2008, connection on 02 October 2016. URL : http:// appareil.revues.org/120 This text was automatically generated on 2 octobre 2016. contrat creative commons L’art, la technique – ou du pareil au même. Douze propositions sur la reproduction Intervention au Collège International de Philosophie (« Samedi du livre » consacré à Jean-Louis Déotte) Jean Lauxerois 1 Ton travail, donc, cher Jean-Louis, que j’ai suivi et souvent accompagné en amitié depuis ses débuts, s’est d’emblée déployé autour de l’idée d’appareillage : appareillage perspectiviste, appareillage muséal, appareillage multiple de la mémoire et du temps… Ta lecture toujours plus aiguë de Benjamin, tes analyses de la photographie et du cinéma, t’ont alors permis de centrer ta recherche sur la notion même d’appareil, et de faire valoir l’importance décisive, c’est-à-dire non instrumentale, de la technique dans la constitution de la culture et de ses époques. C’est là l’horizon de tes deux derniers livres, L’Époque des appareils et Qu’est-ce qu’un appareil ? 2 Précisément, reprenons cette question : qu’est-ce qu’un appareil ? Je retiendrai aujourd’hui, et rapidement, quatre éléments clefs de la réponse que donne Jean-Louis Déotte : 3 1/ Dans Qu’est-ce qu’un appareil ? (p. 18) : l’appareil rend pareil. L’appareil apparie l’hétérogène et le semblable. 4 2/ (P. 19) L’appareil est aussi apparat, ou parure. En ce sens, l’appareil appareille le phénomène, pour le rendre digne de paraître. Cette proposition repose sur une autre, énoncée beaucoup plus loin (p. 114-115) : « L’apparaître est appareillé. » 5 3/ (p. 49) Au vif de l’appareil, il y a le temps : « Les appareils relancent le temps ». En ce sens, ils sont au cœur de la répétition (p. 61), elle-même au cœur de la reproduction. 6 4/ Enfin cette reproduction technique doit s’entendre en relation avec ce qui se nomme « mimesis originaire » (la formule apparaît p. 20 de Qu’est-ce qu’un appareil ? et p. 222 de L’art, la technique – ou du pareil au même. Douze propositions sur la reprodu... Appareil , Articles | 2008 1 L’Époque des appareils) – cette notion faisant écho à la notion benjaminienne d’« image originaire » (p. 209). 7 C’est sur ces quelques données, rapidement évoquées, que j’aimerais revenir. Car si je partage pleinement avec toi, cher Jean-Louis, cet impératif d’une technè radicale et primordiale, au cœur de la mimésis et de la production du temps, je m’interroge néanmoins, s’agissant de la technique, sur ce qu’on pourrait nommer son équivoque ontologique. 8 On peut redouter en effet que cette nécessaire réhabilitation dissimule à son tour la question de la technique comme telle, c’est-à-dire qu’on fasse litière de quelques différences majeures. Pour le dire, par commodité, en termes platoniciens, ne faut-il pas encore et toujours distinguer la technè sophistique et la technè philosophique, mais, au- delà encore, chez Platon lui-même, une technè eidétique et une technè qu’on pourrait qualifier de « phasmatique » ? En d’autres termes, on peut redouter aujourd’hui, comme ce fut le cas pour la science, de voir la technique devenir le vecteur et l’enjeu d’un nouveau positivisme, qui serait aussi funeste que le fut le premier. Il ne s’agirait donc pas seulement de réhabiliter la dimension de la technique, mais de distinguer fortement entre plusieurs de ses sens possibles. Ce qui conduirait à reconsidérer du même coup les problématiques de la reproduction de l’image et de l’apparaître lui-même. 9 Je développerai mon propos en trois points et en douze propositions, que je te soumets pour une même question que je t’adresse sur l’art et la technique, sous le signe du « pareil au même ». I Comment penser la reproduction originaire ? 10 Les techniques contemporaines de reproduction, si décisives soient-elles, n’ont pas inventé la reproduction comme telle. Il faut même soutenir que la reproduction est originaire et qu’elle est au cœur de l’œuvre d’art. Mais il faut aussi lever la confusion qui entoure continûment le terme de « reproduction ». Mimesis, imitation, analogie, ressemblance, répétition, copie, double, duplicata, simulacre, faux, remake… Comment faire la différence ? 11 Il faut distinguer avant tout entre deux sens et deux usages du mot « reproduction », qui sont constamment en concurrence voire en opposition quand il est question d’art et d’œuvre d’art. Il faut distinguer entre reproduction productive et reproduction reproductive. Pour mieux poser la différence entre semblable et identique, entre image et signe. 12 Première proposition : Si, dans sa première définition philosophique, l’art a été conçu comme mimesis, il faut l’entendre au sens d’une reproduction productive. 13 Cette proposition reprend l’idée de la mimesis d’Aristote, mais en soulignant que mimesis ne doit pas être prise au sens d’« imitation », comme on l’a fait pendant des siècles. « L’art imite la nature » a-t-on traduit. Or, si l’on veut entendre au juste comment la technè mime la phusis, il faut d’abord restituer la phrase intégrale, ce qui modifie profondément le sens, et s’interroger ensuite sur la phusis pour fixer le sens de ce qu’on « imite ». La technè (disons, pour l’instant, à la fois technique, art, invention, création) n’imite pas seulement, mais, dit Aristote, elle ajoute à la phusis. La mimesis est donc cette reproduction paradoxale qui ajoute un supplément. Pourquoi ? Parce que la phusis est moins ici ce que L’art, la technique – ou du pareil au même. Douze propositions sur la reprodu... Appareil , Articles | 2008 2 dit, bien vaguement, sa traduction courante par le mot « nature » que la genèse vivante des choses : par exemple, dans le cas de la fleur, le processus de floraison déploie jusqu’à son épanouissement ce qui demeurait potentiel en réserve. L’art comme technè est à l’image (mimesis) de ce processus de la genèse du réel, selon lequel une chose ou un être n’est ce qu’il est que s’il advient à sa pleine présence. En suivant un tel processus, l’œuvre d’art ajoute le supplément de ce qui n’est pas donné : par exemple, il pourra déployer la ressource d’un bloc de marbre qu’il porte à la plénitude de son potentiel, pour l’accomplir en une figure : ainsi, telle sculpture d’Athéna. 14 Ce processus à l’œuvre, Aristote le nomme la poïesis, c’est-à-dire la « pro-duction », la mise en œuvre, la mise au jour de ce qui n’apparaît qu’en supplément à partir d’un donné. Sans oublier que la poïesis peut être aussi bien celle de la phusis que celle de la technè. Ainsi le marbre peut faire éclater sa blancheur (energeia) comme rocher ou falaise, sous la puissance de la lumière du soleil (poïesis). Le marbre est ainsi à sa plénitude « physique », autant qu’il l’est « techniquement » comme statue ou comme escalier. Toute production est donc poétique, et elle est techniquement mimétique, en ce qu’elle est « à l’image » de la phusis. La mimesis est ainsi originairement reproduction productive. 15 Deuxième proposition : Si la technè est un tel mode productif de reproduction, c’est qu’elle est en prise sur la temporalité comme répétition. La source de toute reproduction possible, c’est donc le temps, lequel requiert précisément la technè. 16 Le temps de la répétition, c’est ce qu’Aristote définit comme le temps du mythe et de la mémoire. La mimesis suppose la technè mémorielle, parce qu’elle accorde productivement le passé, le présent et l’avenir dans le « maintenant » de l’Image. Elle peut être une co- production productive, comme au théâtre, où la mimésis du poète, anticipation et conversion, collabore avec celle du spectateur, qui reconnaît après-coup une image oubliée du passé. Chez Freud, de même, le retour du passé, s’il est bien différencié de la mauvaise répétition (retour du refoulé), permet, comme dans le rêve, l’apparition de la trace à partir de laquelle s’élabore la possibilité d’une répétition constructive. 17 Une telle répétition reproductivement productive, nommons-la, d’un terme emprunté à Baudelaire, la « récurrence ». Baudelaire emploie ce mot à propos d’un acteur (Rouvière), dont il vante la capacité d’assumer « le magnétisme de récurrence ». Récurrence, parce que la répétition ne relève pas seulement de l’identique ni de la succession de l’identique. La récurrence, c’est, par exemple, tout ce qui fait le sens de cette œuvre si bien nommée À la Recherche du temps perdu. À l’inverse de ce qui se dit souvent sur l’épisode de la Madeleine, c’est moins le passé que l’avenir qui s’ouvre à partir de l’expérience que fait le narrateur. Répéter l’expérience de l’ingestion de la madeleine dans le thé n’aboutit à rien. La chose est devant moi, dit Proust. À créer. À venir. Dans l’invention technique de sa récurrence. De même encore, à travers l’expérience récurrente que Swann, puis le narrateur, font de uploads/Industriel/jean-lauxerois-l-x27-art-la-technique-ou-du-pareil-au-meme.pdf
Documents similaires









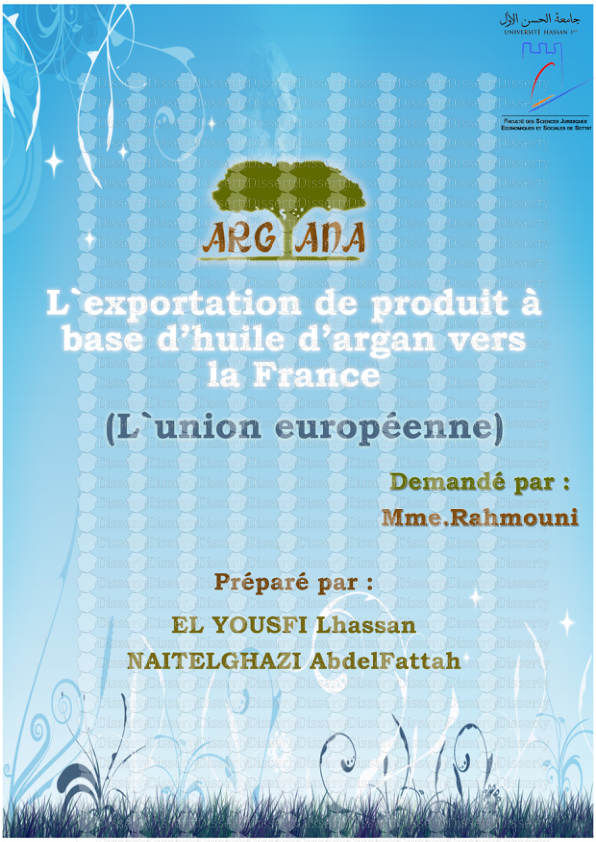
-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 16, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2421MB


