Bulletin d’analyse phénoménologique VI 2, 2010 (Actes 2), p. 164-179 ISSN 1782-
Bulletin d’analyse phénoménologique VI 2, 2010 (Actes 2), p. 164-179 ISSN 1782-2041 http://popups.ulg.ac.be/bap.htm « L’homme ne peut jamais être un animal » Par ÉTIENNE BIMBENET Université Jean Moulin – Lyon III Résumé « L’homme ne peut jamais être un animal » : aussi surprenant que cela puisse paraître, la formule est de Merleau-Ponty lui-même, dans La Structure du comportement. Nous montrons ici qu’une telle formule non seulement est viable, mais qu’elle illustre un dispositif anthropologique parfaitement cohérent, mis en place dans le premier ouvrage de Merleau- Ponty et opératoire jusqu’à la fin de son œuvre. La phénoménologie merleau- pontienne de la perception, comme son ontologie du sensible, explicitent un acte (la perception) ou un mode d’être (le sensible) qui, jusque dans leur dimension la plus « sauvage » (la plus désintellectualisée), ne peuvent appartenir qu’à l’homme, c’est-à-dire à un être symbolique ou parlant. « L’homme ne peut jamais être un animal ». On retrouve au moins deux fois cette phrase dans l’œuvre de Merleau-Ponty. Elle est d’abord donnée littéralement dans La Structure du comportement, et plus exactement dans le passage consacré à « l’ordre humain »1. Elle réapparaît d’autre part à la toute fin de l’œuvre, dans le cours du Collège de France consacré à la Nature, plus précisément dans le cours de 1959-1960 consacré au « corps humain » : « L’homme n’est pas animalité (au sens de mécanisme) + raison. Et c’est pourquoi on s’occupe de son corps : avant d’être raison l’homme est une autre corporéité »2. Nous voudrions montrer qu’on peut considérer cette phrase comme la formule d’une anthropologie philosophique cohérente, à 1 M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, Paris, PUF, 1942, p. 196 ; noté dorénavant SC. 2 M. Merleau-Ponty, La Nature. Notes. Cours du Collège de France, éd. D. Séglard, Paris, Le Seuil (« Traces écrites »), 1995, p. 269 ; noté dorénavant N. 164 laquelle Merleau-Ponty est resté jusqu’à la fin fidèle. Il y a pourtant deux choses qui sont loin d’aller de soi dans une telle hypothèse. Cette formule est premièrement extrême. Nous aurions du reste pu choisir une formule en apparence moins radicale, notamment celle qui l’ac- compagne : « L’homme n’est pas un animal raisonnable »1. Et il faut bien avouer que la phrase de Merleau-Ponty (« L’homme ne peut jamais être un animal ») heurte une certaine compréhension de première vue que l’on peut avoir de cette pensée : il y a bien quelque chose comme une « pente naturelle » dans cette œuvre, une pente qu’on pourrait dire archéologique en ce qu’elle consiste à enraciner la pensée objective (sous ses deux formes : l’intellectualisme philosophique et l’empirisme scientifique) dans le sol originaire de la vie corporelle et perceptive — à montrer que la pensée objective ou rationnelle n’est jamais qu’une pensée tardive et dérivée au regard de la corporéité vivante. L’homme est fondamentalement un vivant ou un corps, chez Merleau-Ponty ; il est étrange de s’entendre dire qu’il ne peut pas être un animal. Il est clair par ailleurs que le projet philosophique de Merleau-Ponty ne fut pas d’élaborer une anthropologie philosophique. Les différents textes programmatiques ou récapitulatifs que Merleau-Ponty nous a laissés témoignent d’une seule et même ambition : construire une phénoménologie de la perception et finalement une ontologie du sensible, bref la philosophie d’un acte (la perception) ou d’un mode d’être (le sensible) dont l’homme n’est à chaque fois que le présupposé ou l’arrière-plan, et non la figure centrale. Comme dit Merleau-Ponty dans l’une des dernières notes de travail du Visible et l’invisible, « il faut décrire le visible comme ce qui se réalise à travers l’homme, mais qui n’est nullement anthropologie »2. Ainsi l’homme est présent du début à la fin de l’œuvre, mais jamais explicitement, ou comme le fond sous la figure de premier plan. C’est pourquoi la formule de cette anthropologie — « l’homme ne peut pas être un animal » ou bien encore « l’homme n’est pas un animal raisonnable » — demande à être explicitée ou développée ; ce que nous ferons à travers les six propositions suivantes. 1. Première proposition. La définition aristotélicienne de l’homme comme zōon logikon consistait essentiellement à séparer, en l’homme, la vie et la raison, la zōē et le logos : l’homme était d’un côté un corps vivant, de l’autre un esprit raisonnable ; d’un côté il appartenait au genre animal, dans 1 SC, p. 196. 2 M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 328. Bulletin d’analyse phénoménologique VI 2 (2010) http://popups.ulg.ac.be/bap.htm © 2010 ULg BAP 165 l’accomplissement des fonctions végétatives et sensitives, de l’autre il échappait à la vie animale, par le privilège métaphysique ou métabiologique de la raison. La genèse du corps humain confirmait ce point : l’embryon humain s’humanisait en recevant l’intellect agent « du dehors » (thurathen, qui signifie en grec, littéralement, « par la porte ») ; seule une faculté supra- vitale ou transcendante pouvait faire advenir un animal raisonnable1. C’est exactement cette métaphysique du « méta » ou de la séparation que Merleau-Ponty conteste. Il n’y a pas d’un côté un corps animal, ou « une sphère des instincts fermée sur soi »2, et de l’autre une raison souveraine ou autonome ; devenir raisonnable c’est devenir un nouveau corps vivant ; la raison se définit comme « une nouvelle manière d’être corps »3. Comme le dit Merleau-Ponty dans La Structure du comportement : « L’esprit n’est pas une différence spécifique qui viendrait s’ajouter à l’être vital pour en faire un homme. L’homme n’est pas un animal raisonnable. L’apparition de la raison ou de l’esprit ne laisse pas intacte en lui une sphère des instincts fermée sur soi »4. Ainsi l’homme n’est pas animal par le corps, et humain par l’esprit ; il est un esprit incarné dans une corporéité originale, ou un corps tout entier spiritualisé. Il est une unité fonctionnelle, et non pas la réunion de deux substances hétérogènes. Le passage de La Structure du comportement qui développe cette idée est assez court, presque lapidaire5 ; il mobilise en réalité quelques références majeures qui lui fournissent une manière de caution implicite. Bergson tout d’abord n’est pas loin, et plus exactement un certain débat avec Bergson, initié quelques pages plus haut, à deux reprises6. La position de Merleau-Ponty consiste en l’occurrence à dire que la vie n’a jamais qu’un seul sens chez Bergson. Même si L’Évolution créatrice repère certaines bifurcations fondamentales dans l’histoire de la vie, cela ne fait pas, au fond, de différence fondamentale. Être en vie pour un animal est équivalent à être en vie pour un homme ; ce qui change de l’un à l’autre ce sont les « moyens » mis au service de cette vie : instinct d’un côté, intel- ligence de l’autre. « Mais l’action à laquelle pense Bergson est toujours l’action vitale, celle par laquelle l’organisme se maintient dans l’existence. 1 Cf. G. Canguilhem, « Le concept et la vie » (1966), in Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, Vrin, 1994, p. 337. 2 SC, p. 196. 3 N, p. 269. 4 SC, p. 196. 5 Ibid., p. 195-196. 6 Ibid., p. 176 et 188. Bulletin d’analyse phénoménologique VI 2 (2010) http://popups.ulg.ac.be/bap.htm © 2010 ULg BAP 166 Dans l’acte du travail humain, dans la construction intelligente des instru- ments, il ne voit qu’une autre manière d’atteindre les fins que l’instinct poursuit de son côté »1. Merleau-Ponty reproche à Bergson de ne pas avoir vu que les actes humains étaient essentiellement différents des actes animaux ou simplement vitaux, qu’un homme était, en son agir ou en sa vie mêmes, différent de l’animal : De ce nouveau point de vue, on s’aperçoit que, si toutes les actions permettent une adaptation à la vie, le mot de vie n’a pas le même sens dans l’animalité et dans l’humanité, et les conditions de la vie sont définies par l’essence propre de l’espèce. Sans doute le vêtement, la maison, servent à nous protéger du froid, le langage aide au travail collectif et à l’analyse du « solide inorga- nisé ». Mais l’acte de se vêtir devient l’acte de la parure ou encore celui de la pudeur et révèle ainsi une nouvelle attitude envers soi-même et envers autrui. Seuls les hommes voient qu’ils sont nus2. Merleau-Ponty se réfère par ailleurs à Cassirer, et à sa fameuse distinction entre oppositions « substantielle » et « fonctionnelle ». L’esprit et la vie, dit Merleau-Ponty, s’opposent non pas « substantiellement » mais « fonction- nellement » : nous n’avons pas affaire à deux choses ou deux réalités, mais bien à deux types de comportements. On sait par exemple que dans La Situation de l’homme dans le monde, Scheler concevait la vie comme une grande « poussée originairement démoniaque, c’est-à-dire aveugle à toutes les idées et valeurs spirituelles »3. Une vie ainsi définie ne pouvait dès lors s’humaniser qu’à la surface d’elle-même, en se coiffant d’un esprit qui fondamentalement lui restait étranger. Dans l’histoire de la vie ce n’était jamais la vie uploads/Ingenierie_Lourd/ bimbenet-l-x27-homme-ne-peut-jamais-etre-un-animal.pdf
Documents similaires






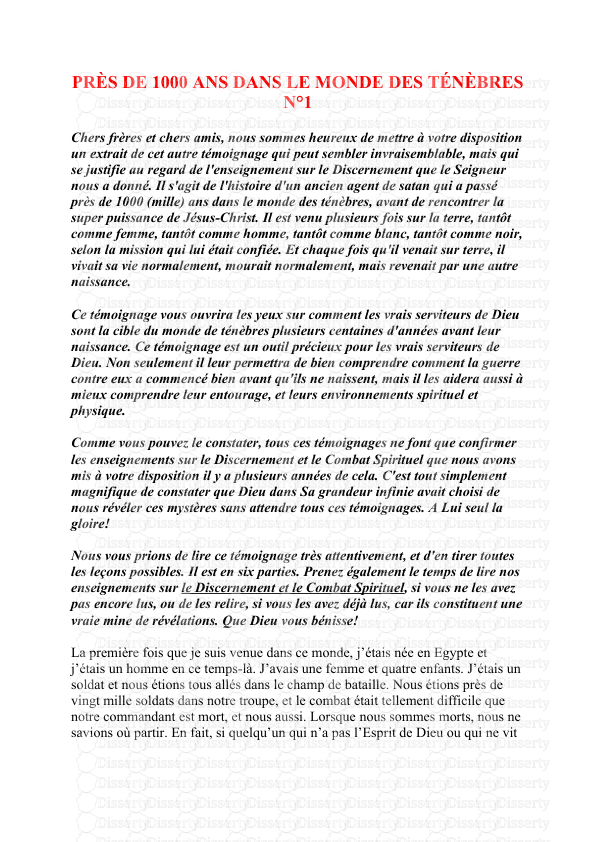



-
92
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 20, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0991MB


