Psychosomatique Quarto.........................................................
Psychosomatique Quarto.................................................................................................................................................................... 3 Des problèmes psychanalytiques face aux phénomènes psychosomatiques et cancéreux Jean Guir................... 4 Propos sur le livre de Fritz Zorn : Mars Jean Guir ............................................................................................. 12 Les genoux de Rimbaud Jean Guir..................................................................................................................... 17 Des psychotiques en analyse ? Cing questions Éric Laurent ............................................................................. 20 Sur l’éthique ou de l’exclusion du psychanalyste Serge André.......................................................................... 27 "MELANGES CLINIQUES"............................................................................................................................... 39 Introduction Maurice Krajzman .................................................................................................................... 39 Entre psychiatrie et champ freudien : une clinique Alfredo Zénoni............................................................... 40 "FIN D’ANALYSE, ENVIE DE PENIS, DEPRESSION GRAVE"(FREUD, 1937) Pierre Malengreau.... 43 2 Accueil Cliquer Quarto SUPPLÉMENT A LA LETTRE MENSUELLE DE L’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE PUBLIE A BRUXELLES Rafraîchir le terme de psychosomatique, tel est le plus légitime des souhaits qu’un médecin puisse à cet égard adresser au psychanalyste. Encore faudra- t-il compter sur ce qu’un tel souhait implique ; que dans sa réponse, le psychanalyste ne se substitue en aucun cas au médecin. C’est ainsi que ce psychanalyste se trouve interpellé par ce qui se donne à voir sous l’appellation de phénomène psychosomatique. Il est en effet interrogé par le discours médical : en l’occasion, ce dernier le questionne sur la limite de sa pratique et sur les ressorts de son action. En outre, le dit-phénomène l’interpelle encore dans son rapport à la Psyché, on sait les relents de maîtrise qu’elle lui suscite ! Un phénomène psychosomatique fait partie de ceci : tout du corps ne se donne pas à entendre. Mais serait-il seulement à voir ? Ce en quoi il rejoindrait les phénomènes abordés par Lacan dans son approche du mimétisme. Participant au Signifiant- maître de la nature – qu’elle se donne à voir –, le phénomène psychosomatique s’adresse quelquefois à des représentants du discours religieux, en tant que ce dernier gère le sens, ou au discours de la science en tant qu’il en supporte la causalité. Le voilà de ce fait en passe de devenir symptôme ; car le donné à voir du phénomène psychosomatique se double ici d’une demande, une demande de savoir. Le médecin y est dès lors intéressé. Se particularise ainsi pour lui un déplacement, car ce n’est plus à un "que peux-tu" que le confronte le dit phénomène, mais à un "que veux-tu". Le "rapport épistémo- somatique ainsi nommé par Lacan, se trouve articulé, du fait de la demande, à ce que ce rapport exclut cependant, à savoir que" un corps est quelque chose qui est fait pour jouir, jouir de soi-même ". La plus grande vigilance est ici de mise pour le psychanalyste. Se fera-t-il le représentant d’un surplus de savoir et de pouvoir, ou au contraire pourra-t-il maintenir l’écart que creuse cette demande de savoir entre plaisir et jouissance ? Tel est un des enjeux de sa confrontation aux difficultés du discours médical. Dès lors, ce n’est pas comme complémentaire que le psychanalyste aura à se positionner, mais il est appelé à témoigner de ceci : que la moindre rencontre avec le réel fait objection au Tout. Pour la rédaction 3 Accueil Cliquer Des problèmes psychanalytiques face aux phénomènes psychosomatiques et cancéreux Jean Guir Dans le séminaire XI, Lacan avance plusieurs propositions pour expliquer les phénomènes psychosomatiques. 1. La psychosomatique, c’est quelque chose qui n’est pas un signifiant, mais qui tout de même, n’est concevable que dans la mesure où l’induction signifiante au niveau du sujet s’est passée d’une façon qui ne met pas en jeu l’aphanisis du sujet (Vorstellung-Repräsentanz). 2. C’est dans la mesure où un besoin viendra être intéressé dans la fonction du désir… C’est en tant que le chaînon désir est ici conservé même si nous ne pouvons plus tenir compte de la fonction aphanisis du sujet. 3. J’irai jusqu’à formuler que lorsqu’il n’y a pas d’intervalle entre S1 et S2, lorsque le premier couple de signifiants se solidifie, s’holophrase nous avons le modèle de la psychosomatique entre autres. 4. Dans les phénomènes psychosomatiques, il n’y a pas de relation à l’objet. Il faudra voir ce que ça veut dire. Nous sommes en présence du narcissisme primaire, de la libido égoïste de Freud. Les phénomènes psychosomatiques échappent aux constructions névrotiques, concernent le réel… Nous rappellerons que le propre du signifiant est de ne pas pouvoir se signifier à lui-même. Et nous partirons de cette formule minimale, donnée par Lacan dans Encore : un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Le signifiant en lui-même n’est rien d’autre de définissable qu’une différence avec un autre signifiant. Le sujet n’est jamais que ponctuel et évanouissement, (fading, aphanisis) car il n’est sujet que par un signifiant et pour un autre signifiant. Il se peut que, dans les phénomènes psychosomatiques, le sujet soit représenté par un signifiant, mais peut-être pas pour un autre signifiant. Donc, dans les phénomènes psychosomatiques : 1 Il n’y a pas d’aphanisis du sujet (fading) On peut dire qu’un signifiant S1 n’a pas représenté le sujet pour un autre signifiant. Le vel de l’aliénation n’a pas marché. A mon avis, ce signifiant S1 n’est ni forclos (pas de psychose), ni refoulé. Pour Lacan, l’aliénation (voir Séminaire XI) est liée inextricablement au processus de séparation qui fait émerger l’objet a, cause du désir. Il semble que la métaphore paternelle ne fonctionne pas, ne fait pas césure entre S1 et S2, pour qu’il y ait émergence de l’objet a, dans la dynamique psychosomatique. Au passage, dans un de mes articles, je disais que dans cette dynamique psychosomatique, on remarquait que, dans un premier temps, un sujet était séparé de quelqu’un de sa famille ; dans un deuxième temps, le signifiant de la séparation revenait. Ce n’est pas pour rien. Lacan dit : séparation vient du latin "se parere" : qui veut dire s’engendrer et s’habiller, il y a en plus la notion juridique : acte d’engendrement. Il semble donc que l’objet a n’apparaisse pas. Le sujet est représenté par un signifiant mais pas pour un autre signifiant. Si nous prenons l’exemple de Lacan : c’est dans les deux phonèmes Fort-Da que s’incarnent les mécanismes propres de l’aliénation. Pas de "Fort" sans "Da" et si l’on peut dire, sans Dasein (Séminaire XI). Le sujet s’exerce à ce jeu fondamental de l’aliénation avec la bobine. (Mais il n’y a pas de Dasein avec le Fort seulement). Pour bien faire comprendre qu’il n’y a pas émergence de l’objet a, prenons un exemple dans le livre de ZORN, jeune zurichois mort d’un cancer. Dans une parole de la mère, nous avons une métaphore de l’aliénation : "une des paroles favorites de la mère est" ou bien, ou bien ". Exemple : Je partirai vendredi prochain à 10h30 pour Zürich ou bien je resterai à la maison. Comme le dit ZORN lui-même, quand on dit trop de" ou bien ", les mots perdent tout leur poids et tout leur sens. La langue se décompose dans une masse amorphe de particules privées de signification, plus rien n’est solide et tout devient irréel. Dans les paroles de la mère, il n’y a pas de battement possible pour qu’un signifiant arrive et représente le sujet pour un autre signifiant. Il y a un mécanisme d’exclusion de la bobine. Si le désir de l’homme, c’est le désir de l’Autre, ici le désir de ZORN ne peut pas de constituer. Il ne s’agit même pas de plonger dans le désir inconnu de la mère, de repérer ce qu’il y a d’inconnu dans ce désir ; il semble que la mère brouille les cartes. En fait, elle n’exprime aucun désir ; il n’y a pas de désir du tout. Il n’y a pas apparition du manque signifié par le premier couple de signifiants S1-S2 dans l’intervalle qui les lie. Là où gît la difficulté, c’est que Lacan précise que le chaînon désir est quand même présent : un besoin 4 Accueil Cliquer viendra à être intéressé dans la fonction du désir. C’est ce qu’exprime ZORN en effet, dans le même passage : suite à "Je partirai vendredi prochain à 10h30 pour Zürich ou bien je resterai à la maison", nous trouvons cette phrase de la mère : "Ce soir, il y a des spaghettis pour dîner ou il y e de la salade de cervelas". Nous voyons bien là qu’un besoin, ici alimentaire, vient à être intéressé dans la fonction du désir. Remarquons aussi que la perversion maternelle semble situer comme équivalents deux signifiants : spaghettis ou salade de cervelas. Il n’y e aucune connotation sexualisée, ni d’interdit, à propos de ces aliments (Fort-Da et vel). Lacan précise que le sujet normalement trouve la voie de retour du vel de l’aliénation par le processus de séparation. Par la séparation, le sujet forme si l’on peut dire, le point faible du couple primitif de l’articulation signifiante en tant qu’elle est d’essence aliénante. Le manque qui gît entre S1 et S2, constitué par le désir inconnu de la mère (ici pour ZORN, la mère ne manifeste aucun désir) va rejoindre et recouvrir le manque constitué par l’aphanisis. Ce que nous pouvons dire dans les phénomènes psychosomatiques, c’est que l’absence d’aphanisis va engendrer une interruption dans le uploads/Litterature/ 011.pdf
Documents similaires








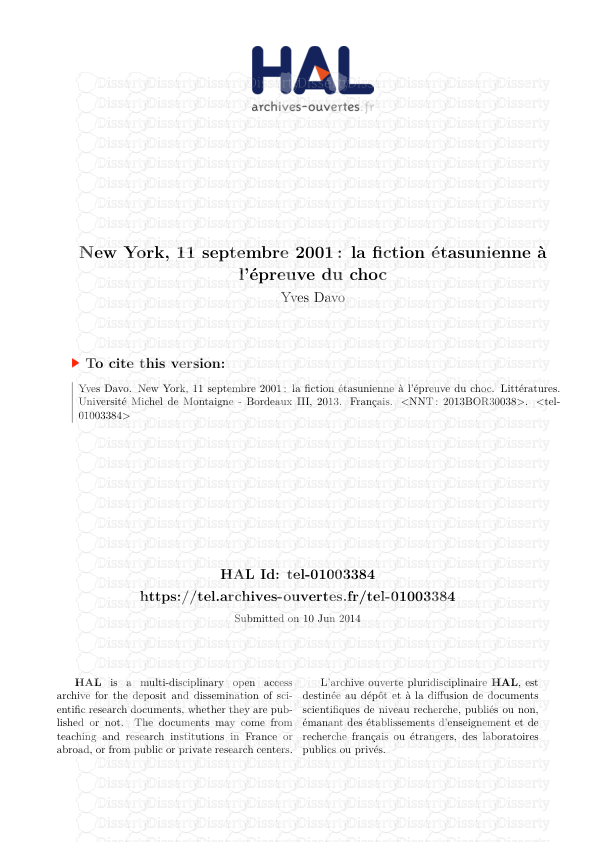

-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 21, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3917MB


