Orphée et l'Orphisme à l'époque impériale. Témoignages et interprétations philo
Orphée et l'Orphisme à l'époque impériale. Témoignages et interprétations philosophiques, de Plutarque à Jamblique p a r L u c BRISSON, Paris Table des matières Première partie: Orphée 2869 I. Origines 2869 II. Inspiration 2869 III. Puissance de sa musique 2873 IV. Mort 2874 V. Disciples 2874 Deuxième partie: Orphisme 2875 I. Les œuvres 2875 1. Description 2875 A. Théogonie: les trois versions 2875 a) La version ancienne 2876 b) La théogonie des 'Rhapsodies' 2885 c) La théogonie de Hiéronymos et d'Hellanikos 2897 B. Autres œuvres attribuées à Orphée 2914 a) Textes ayant rapport avec la vie et les activités d'Orphée 2915 a) Descente chez Hadès (Kaxdßaoiq etç "Ai6ou) 2915 ß) Les Oracles (Xprianoi) 2915 b) Hymnes [et Epigrammes] 2916 а) Hymne à Dionysos 2916 ß) Hymne à Eros 2917 y) Hymne à Déméter 2918 б) L'hymne au nombre ('O elç xòv àpi9|iòv C|ivoç) 2918 e) Epigrammes ('EjtiypàmiaTa) 2919 c) Ouvrages relatifs à des questions naturelles 2919 a) La Dodécennie (AfflôeKaexripiç) 2919 ß) Les Ephémérides ('E(pT|H£pi5Eç) 2919 J e tiens à r e m e r c i e r JEAN-MARIE FLAMAND et SYLVIAN MATTON, qui m ' o n t aidé à c o r r i g e r les épreuves de cet article. Brought to you by | Cambridge University Library Authenticated Download Date | 10/29/16 10:49 AM 2868 L U C B R I S S O N y) Le Cratère (Kpaxiip) 2919 5) Sur la médecine par les plantes et par les herbes (Ilepi < D U T Ü > V ßotavöv <ïaTpucfj;>) 2920 d) Ouvrages apologétiques 2920 a) Le Testament (Aia9f|Kai) 2920 ß) Les Serments ("OpKoi) 2923 2. Grandes orientations 2924 A. Théogonie 2924 B. Mystères bacchiques 2924 C. Pythagorisme 2925 D. Interprétations allégoriques 2926 E. Les réactions juives et chrétiennes 2927 II. Culte(s) 2927 Illustration 2931 Comment, durant les premiers siècles de l'Empire romain, se représentait- on la figure d'Orphée? Quels écrits attribués à Orphée pouvait-on lire? Existait- il des sectes orphiques célébrant des rites particuliers? Voilà les questions que j'aborde ici, en me voulant le plus complet possible, mais sans me départir de la plus grande prudence1. Ces questions porteront sur la période allant des débuts de l'Empire à Jamblique, ce philosophe néoplatonicien étant pris comme terminus ad quem, parce qu'il est celui qui a défini, ne fût-ce que sous forme programmatique, l'entreprise d'accord entre Orphée, Pythagore, Platon et les 'Oracles chaldaïques', que mettra en œuvre l'Ecole néoplatonicienne d'Athènes qui reste notre principale source de témoignages sur l'Orphisme2. Par ailleurs, on peut considérer Plutarque comme point de départ de cette recherche, tout simplement parce qu'il est le premier auteur d'époque impériale, dont le témoignage sur l'Orphisme présente une véritable complétude, et qui propose une interprétation de certaines de ses composantes. 1 Les sigles OT et OF renvoient respectivement aux témoignages sur Orphée et aux fragments qui subsistent des poèmes qui lui sont attribués. Ces témoignages et ces fragments ont été réunis par O. KERN, Orphicorum fragmenta [1922], Dublin/Zürich (Weidmann) 1972 [reprint]. C'est avec beaucoup de prudence qu'on utilisera le livre le plus récent sur l'Orphisme, celui de M. L. WEST, The orphie poems, Oxford (Clarendon Press) 1983. Cf. le compte rendu de Luc BRISSON, intitulé 'Les théogonies orphiques et le papyrus de Derveni. Notes critiques' (Revue de l'Histoire des Religions 202, 1985, p. 3 8 9 - 4 2 0 ) . 2 J'ai analysé l'ensemble des témoignages de Proclus sur l'Orphisme dans 'Proclus et l'Orphisme', dans: Proclus. Lecteur et interprète des anciens, Actes du Colloque interna- tional du CNRS, Paris ( 2 - 4 octobre 1985), publiés par JEAN PÉPIN et H.D. SAFFRF.Y, Paris (éd. du C.N.R.S.) 1987, p. 4 3 - 1 0 4 ; et l'ensemble des témoignages de Damascius, dans: 'Damascius et l'Orphisme', article à paraître dans les Actes du Colloque « Orphisme et Orphée» en l'honneur de Jean Rudhardt ( 1 6 - 1 8 avril 1989). Brought to you by | Cambridge University Library Authenticated Download Date | 10/29/16 10:49 AM ORPHÉE ET L'ORPHISME À L'ÉPOQUE IMPÉRIALE 2869 Première partie: Orphée La fascination qu'exerce Orphée s'explique, en grande partie, par le fait que, comme l'y prédisposent ses origines, il transgresse ou permet de trans- gresser nombre d'oppositions qui définissent l'être humain: hommes / dieux; hommes / bêtes; vivants / morts. I. Origines Pour les Grecs, Orphée appartenait à la génération antérieure à celle qui fit la guerre de Troie, et cela parce qu'il participa à l'expédition des Argonautes (Apollonius de Rhodes, Argonautiques I 32 = OT 7 8 - 8 0 , cf. OT 7 - 2 1 ) . Voilà pourquoi on estimait qu'Homère en était le débiteur (cf. n.45 et OT 7 - 2 1 ) . En général, Orphée est considéré comme le fils d'Oeagre (Platon, Banquet 179 d: Apollonius, Argonautiques I 25, Diodore III 65, 6 entre autres = OT 22 — 23), un Thrace, présenté le plus souvent comme le dieu d'un fleuve, et de Calliope (Apollonius, Argonautiques I 23; pseudo-Apollodore, Bibliothèque I 3,2 notamment, cf. OT 23 et 24), une Muse, celle dont Hésiode dit qu'elle est « la première de toutes» (Ttpoipepecrnrni âjtaaécov) (Théogonie 79). Par son père, Orphée est Thrace (Strabon X 3,17; Pline, Histoire naturelle IV 41 etc. = OT 30 — 37). Sur les représentations figurées, il porte un costume thrace. Par ailleurs, une tradition veut que Libèthres, une cité de Thrace située au pied du mont Olympe, ait été la patrie d'Orphée (OT 223 d, OF 342). II. Inspiration Une telle proximité par rapport au mont Olympe pourrait s'expliquer par le fait qu'Orphée est le fils de Calliope, une Muse, fille de Zeus et de Mnémosyne. Voici d'ailleurs comment, au début de la 'Théogonie', Hésiode décrit l'inspiration qui lui vient des Muses: « Or, sus, commençons donc par les Muses, dont les hymnes réjouissent le grand cœur de Zeus leur père, dans l'Olympe, quand elles disent ce qui est, ce qui sera, ce qui fut, de leurs voix à l'unisson. Sans répit, de leurs lèvres, des accents coulent, délicieux, et la demeure de leur père, de Zeus aux éclats puissants, sourit, quand s'épand la voix lumineuse des déesses. La cime résonne de l'Olympe neigeux, et le palais des Immortels, tandis qu'en un divin concert leur chant glorifie d'abord la race vénérée Brought to you by | Cambridge University Library Authenticated Download Date | 10/29/16 10:49 AM 2870 LUC BRISSON des dieux, en commençant par le début, ceux qu'avaient enfantés Terre et le vaste Ciel; et ceux qui d'eux naquirent, les dieux auteurs de tous bienfaits; puis Zeus, à son tour, le père des dieux et des hommes, montrant comme, en sa puissance, il est le premier, le plus grand des dieux; et enfin elles célèbrent la race des humains et celles des puissants Géants, réjouissant ainsi le cœur de Zeus dans l'Olympe, les Muses Olympiennes, filles de Zeus qui tient l'égide. » (Hésiode, Théogonie 3 6 - 5 2 , trad. P. MAZON) Puisqu'il est le fils de la première des Muses, Orphée doit être le premier des poètes, dans le temps et du point de vue de la qualité. Inspiré par les Muses, et notamment par sa mère, Orphée peut remonter dans le passé jusqu'aux origines: il allait donc de soi qu'on lui attribuât une Théogonie (cf. infra, p. 2876 — 2914). Autour de cette œuvre majeure et pour ainsi dire nécessaire, vint se greffer, à différentes époques, une constellation d'œuvres, dont plusieurs seront décrites plus loin (cf. infra, p. 2 9 1 4 - 2 9 2 3 ) . De l'inspiration poétique, on glisse facilement à l'inspiration mantique (OT 87 — 89), dispensée par Apollon notamment; voilà pourquoi certains témoignages font d'Apollon le père d'Orphée (pseudo-Apollodore, Bibliothè- que I 3,2). Philochore (FGrH III B 328 F 77 = Clément d'Alexandrie, Stromates I 21, 134,4) tenait déjà Orphée pour un devin et, dans son ouvrage 'Sur la divination', il aurait même cité deux vers d'Orphée: « non certes, je ne suis pas maladroit pour rendre des oracles; mais j'ai dans le cœur le désir de dire la vérité. » (Scholie à Euripide, Alceste 968 = OF 332) Par là s'explique qu'on ait pu mettre sous le nom d'Orphée un recueil d'oracles (cf. infra, p. 2915). Et de l'inspiration mantique dispensée par Apollon, on passe facilement à l'inspiration 'télestique'. La religion grecque, intimement liée à la cité (irôA.iç), est une religion publique au sens le plus fort du terme, garantissant l'intégration de l'individu dans la cité. Quiconque refusait ce mode d'intégration pouvait se voir accuser d"impiété' (àaépeia). Mais, dans le même temps, il y avait des cultes non- civiques qui n'intéressaient qu'un groupe restreint dans lequel on ne pouvait entrer que par l'intermédiaire d'une initiation individuelle; c'étaient les mystè- res. En grec ancien, «initier», c'est (iueîv ou xeXeïv. L'initié est appelé |iûcxr|ç, et l'ensemble des cérémonies est qualifié de |iucrxf|pia, alors que le xeA.eaxf|piov est le lieu où se déroulent ces cérémonies. L'ensemble des cérémonies peut aussi être appelé xekexr|, mais le terme peut uploads/Litterature/ 1900-luc-brisson-orphee-et-l-x27-orphisme.pdf
Documents similaires





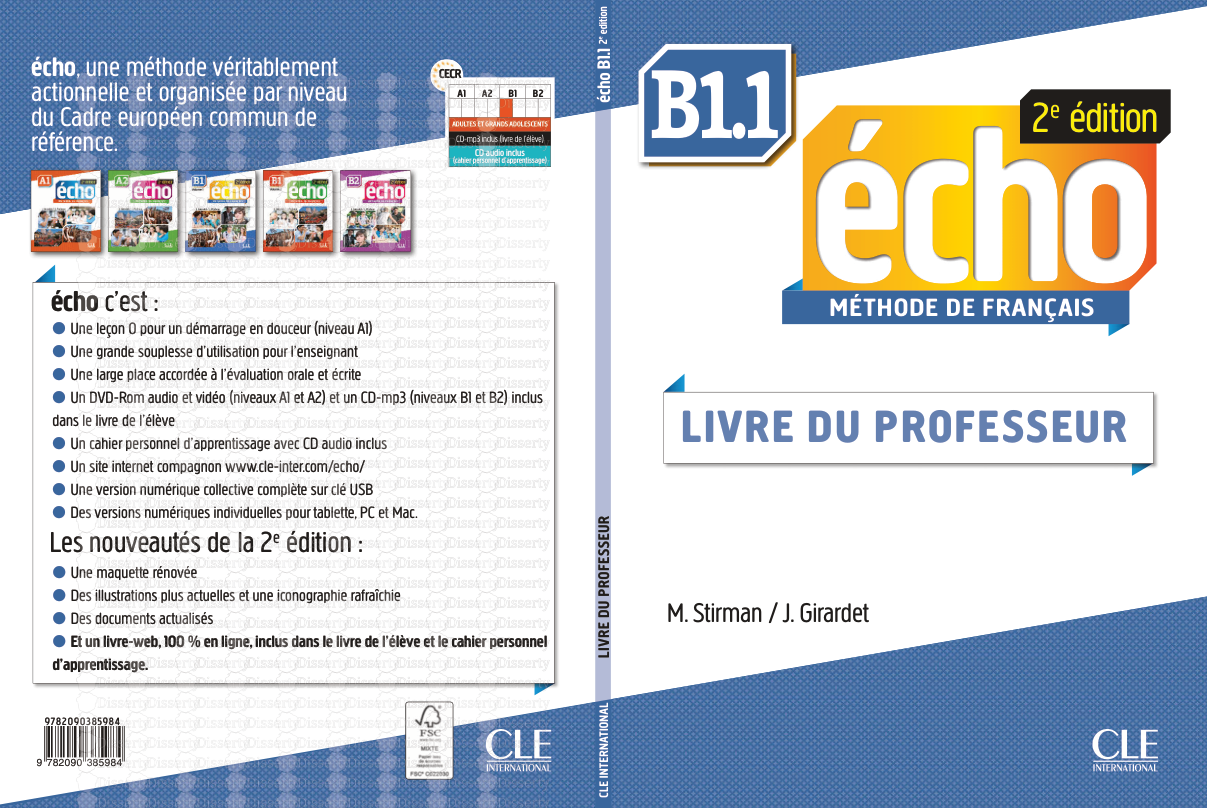




-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 18, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 5.6886MB


