www.comptoirlitteraire.com André Durand présente Antoine de SAINT-EXUPÉRY (Fran
www.comptoirlitteraire.com André Durand présente Antoine de SAINT-EXUPÉRY (France) (1900-1944) Au fil de sa biographie s’inscrivent ses œuvres qui sont résumées et commentées. Bonne lecture ! 1 Né à Lyon, il était le troisième des cinq enfants d'une famille de l'aristocratie (son père portait le titre de vicomte), catholique et traditionaliste. Bien qu'il perdit son père dès l'âge de quatre ans, il vécut une enfance heureuse dans les propriétés familiales de Saint-Maurice-de-Rémens (Ain) et du château de La Môle (Var). Il fut très lié à sa mère, dont la sensibilité et la culture le marquèrent profondément et avec qui il entretint toute sa vie une volumineuse correspondance. Ce paradis de l’enfance lui fit attacher une valeur irremplaçable aux racines, à la demeure. Il y sentit s’éveiller son intérêt pour la mécanique et pour l'aviation : il reçut son baptême de l'air en 1912, à l'aérodrome d'Ambérieu, et cette passion ne le quitta plus. Après des études classiques dans des établissements catholiques, au Mans et à Fribourg, il prépara à Paris, au lycée Saint-Louis, le concours d'entrée à l'École navale. Ayant échoué à l'oral, il s'inscrivit aux Beaux-Arts (1919). Il effectua son service militaire dans l'aviation (1921 à 1923) et obtint son brevet de pilote. Mais la famille de sa fiancée, Louise de Vilmorin, avec qui il ne tarda pas à rompre, s’opposait à son affectation dans l'armée de l'air : il se résigna alors à exercer divers métiers (contrôleur de fabrication aux Tuileries de Boiron, voyageur de commerce pour les camions Sauter) tout en fréquentant les milieux littéraires (1923 à 1926). L’année 1926 marqua un tournant décisif avec la publication d’une nouvelle, “L'aviateur”, et avec son engagement comme pilote de ligne sur le parcours Toulouse-Casablanca, par la société d'aviation Latécoère, dirigée à Toulouse par Didier-Daurat. Écrire et voler : sa vie prenait un sens dans la réalisation de ces deux projets pour lui inséparables. À chaque escale du pilote correspondit désormais l’étape d’une production littéraire nourrie de l’expérience car il ne voulait «n’écrire que ce l’on a risqué», ne rien écrire que sa vie ne garantisse ou qu’il ait eu l’occasion de vérifier à ses dépens. Affecté, en octobre 1927, comme chef d’aéroplace à Cap Juby dans un Rio de Oro (le Sahara espagnol) ébranlé par les révoltes des Maures, il y révéla son sens des responsabilités, affronta les dangers du désert, gagna la confiance des Espagnols et des indigènes. C'est là qu’il écrivit son premier roman : _________________________________________________________________________________ “Courrier Sud” (1928) Roman de 210 pages Le narrateur, Jacques Bernis, pilote de l’Aéropostale, n'a pu entraîner dans son monde d'aventures sa trop casanière compagne, Geneviève. Il meurt dans un accident d’avion en plein désert. Commentaire Aux souvenirs de l'aviateur, notés avec une précision saisissante, à l’appel enthousiaste au dépassement de soi, se mêle une intrigue sentimentale quelque peu conventionnelle mais qui rapproche de nous le héros que nous sentons humain, vulnérable, susceptible de tendresse : «Ô femme après l'amour démantelée et découronnée du désir de l'homme. Rejetée parmi les étoiles froides. Les paysages du cœur changent si vite...» Le roman, où il expérimentait un type de récit qui devait beaucoup au cinéma, fut, en 1937, adapté pour cet art par Saint-Exupéry lui-même. _________________________________________________________________________________ L’escale suivante fut Buenos Aires où Saint-Exupéry, nommé directeur d'exploitation de l’’’Aeroposta Argentina’’, filiale de l'’’Aéropostale’’, rejoignit, en octobre 1929, Mermoz et Guillaumet, avec mission d'organiser le réseau d'Amérique latine. Tel est le cadre de son second roman : _________________________________________________________________________________ 2 “Vol de nuit” (1931) Roman de 150 pages Rivière, qui dirige une équipe de l'Aéropostale en Amérique du Sud, cherche à démontrer que le courrier est acheminé plus rapidement par avion que par chemin de fer : «C’est pour nous une question de vie ou de mort, puisque nous perdons, chaque nuit, l’avance gagnée, pendant le jour, sur les chemins de fer et les navires.» Fabien, l'un des hommes de l'équipe, est porté disparu à la suite d'un vol périlleux. Face à l'épouse de celui-ci, Rivière comprend que l'amour et le sens du devoir sont deux idéaux incompatibles. À la fin du roman, il reste décidé à continuer les vols de nuit : «La défaite qu'a subie Rivière est peut-être un engagement qui rapproche de la vraie victoire. L'événement compte seul.» (chap. XXIII). Commentaire Dans les années vingt et trente, les notions de courage et d'héroïsme se déployèrent le plus admirablement et le plus utilement dans l'aviation, chez les pilotes qui risquaient sans cesse leur vie en service commandé. Ce service nocturne fut d’abord fort critiqué parce que, lors de cette première période héroïque, il était fort hasardeux : à l’impalpable péril des routes aériennes semées de surprises, s'ajoutait le perfide mystère de la nuit. “Vol de nuit” nous peint la tragique aventure d'un de ces pionniers de l'air et prend tout naturellement un ton d’épopée. On sent, à travers cette peinture, toute l'admiration de Saint-Exupéry qui parlait en connaissance de cause, son personnel affrontement d’un fréquent péril donnant à son livre une saveur authentique et inimitable, une valeur documentaire : «Il lut son altitude : mille sept cents mètres. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Le moteur vibra très fort et l'avion trembla. Fabien corrigea, au jugé, l'angle de descente, puis, sur la carte, vérifia la hauteur des collines : cinq cents mètres. Pour se conserver une marge, il naviguerait vers sept cents mètres». Fabien, sans être déshumanisé, s'élève à une vertu surhumaine par ce surpassement de soi qu'obtient la volonté tendue. Rivière, double de Daurat mais également de l'auteur, est une admirable figure de chef : il n'agit pas lui-même mais il fait agir, insuffle à ses pilotes sa vertu, exige d'eux le maximum, et les contraint à la prouesse. Il mêle exercice de l'autorité et exigence d'absolu : - «Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent» (XIX). Son implacable décision ne tolère pas la faiblesse, et, par lui, la moindre défaillance est punie. Sa sévérité peut, au premier abord, paraître inhumaine, excessive. Mais c'est aux imperfections qu'elle s'applique, non point à l'homme même, que Rivière prétend forger. C'est que le sentiment du devoir le domine : «l'obscur sentiment d'un devoir, plus grand que celui d'aimer». Il sent que l'être humain ne trouve point sa fin en lui-même, mais se subordonne et se sacrifie à quelque chose qui le domine et vit de lui : «Nous agissons, pensait Rivière, comme si quelque chose dépassait, en valeur, la vie humaine... Mais quoi?» Et encore : «Il existe peut-être quelque chose d'autre à sauver, et de plus durable ; peut-être est-ce à sauver cette part de l'homme que Rivière travaille.» On voit bien qu’il n'est nullement insensible (rien de plus émouvant que le récit de la visite qu'il reçoit de la femme du disparu) et qu'il ne lui faut pas moins de courage pour donner ses ordres qu'à ses pilotes pour les exécuter. «Pour se faire aimer, dit-il, il suffit de plaindre. Je ne plains guère, ou je le cache... je suis surpris parfois de mon pouvoir.» Et encore : «Aimez ceux que vous commandez ; mais sans le leur dire.» Dans ce roman qui affirme une éthique de l’action, qui est aussi une réflexion sur l'idéal héroïque («Il n’y a pas de fatalité extérieure. Mais il y a une fatalité intérieure : vient une minute où l'on se découvre vulnérable ; alors les fautes vous attirent comme un vertige.» XV), il éclairait cette vérité paradoxale, d'une importance psychologique considérable, que souligna dans sa préface Gide, l’immoraliste aux sentiments sinueux : «Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir». Chacun des personnages de ce livre est ardemment, totalement dévoué à 3 ce qu'il doit faire, à cette tâche périlleuse dans le seul accomplissement de laquelle il trouvera le repos du bonheur. Saint-Exupéry manifesta une plus grande maîtrise narrative et un sens réel du pathétique. Le roman obtint le prix Femina. Il fut, en 1939, adapté pour le cinéma par Saint-Exupéry. L. Dallapiccola en a tiré un opéra en un acte (Florence, 1940). _________________________________________________________________________________ En 1931, la banqueroute de l'’’Aéropostale’’ mit un terme à l'ère des pionniers. Saint-Exupéry épousa Consuelo Suncin, qu'il avait connue à Buenos Aires, mais il ne cessa pas de voler, comme pilote d'essai chez Latécoère (1932), puis à Air France (1934), effectuant aussi plusieurs tentatives de records, dont certaines se soldèrent par de graves accidents : dans le désert égyptien en 1935 (raid Saigon-Paris) et surtout au Guatemala en 1938 (en tentant de relier New York à la Terre de Feu). Dans les années 1930, il multiplia les activités : brevets d'invention, adaptations cinématographiques de “Courrier Sud” en 1937 et de “Vol de nuit” en 1939, nombreux voyages (à Moscou, dans l’Espagne en guerre...), reportages et articles pour divers journaux (“Paris-soir”, “Marianne”, “L’intransigeant”). En convalescence à New York après l'accident du Guatemala, il revint à la littérature en rassemblant, sur les conseils de Gide, uploads/Litterature/ 285-saint-exupery.pdf
Tags
littérature c'est comme saint-exupéry d'une _________________________________________________________________________________Documents similaires








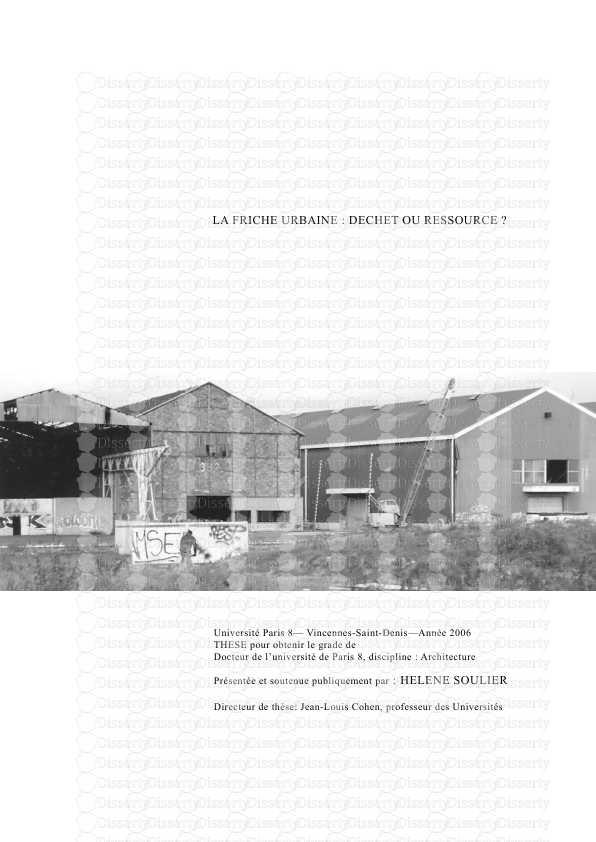

-
89
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1889MB


