Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2016 Ce documen
Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2016 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 6 oct. 2019 15:53 Meta Journal des traducteurs Translators’ Journal Traduire le Black English (« C’est comme ça des fois. ») Kerry Lappin-Fortin Volume 61, numéro 2, août 2016 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1037768ar DOI : https://doi.org/10.7202/1037768ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Les Presses de l’Université de Montréal ISSN 0026-0452 (imprimé) 1492-1421 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Lappin-Fortin, K. (2016). Traduire le Black English (« C’est comme ça des fois. »). Meta, 61 (2), 459–478. https://doi.org/10.7202/1037768ar Résumé de l'article Le problème de la traduction des sociolectes demeure « […] one of the biggest lacunae in translation studies » (Herrera 2014 : 290). Dans ce qui suit, j’espère contribuer à la discussion entamée par Brodsky (1993, 1996), Lavoie (1994, 2002) et d’autres sur la traduction du vernaculaire noir américain (VNA) en examinant le cas de deux romans autobiographiques de Maya Angelou, I Know Why theCaged Bird Sings (1969) et The Heart of a Woman (1981), et le bestseller de Lawrence Hill, The Book of Negroes (2007). Il s’avère que le rôle du Black English dans ces romans dépasse celui de la simple « couleur locale ». Comment les traducteurs Besse (2008), Saint-Martin et Gagné (2008), et Noël (2011/2014), les traducteurs des romans précédemment cités, ont-ils négocié la tension entre fidélité à la langue source et fidélité à la langue cible ? Il ressort de cette étude qu’une plus grande volonté de dévier des normes et des formes du français permettrait de mieux « traduire » ce parler noir dans le but d’en préserver la valeur culturelle et idéologique. Meta LXI, 2, 2016 Traduire le Black English (« C’est comme ça des fois. ») kerry lappin-fortin University of Waterloo, Waterloo, Canada klappinf@uwaterloo.ca RÉSUMÉ Le problème de la traduction des sociolectes demeure « […] one of the biggest lacunae in translation studies » (Herrera 2014 : 290). Dans ce qui suit, j’espère contribuer à la discussion entamée par Brodsky (1993, 1996), Lavoie (1994, 2002) et d’autres sur la traduction du vernaculaire noir américain (VNA) en examinant le cas de deux romans autobiographiques de Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings (1969) et The Heart of a Woman (1981), et le bestseller de Lawrence Hill, The Book of Negroes (2007). Il s’avère que le rôle du Black English dans ces romans dépasse celui de la simple « cou- leur locale ». Comment les traducteurs Besse (2008), Saint-Martin et Gagné (2008), et Noël (2011/2014), les traducteurs des romans précédemment cités, ont-ils négocié la tension entre fidélité à la langue source et fidélité à la langue cible ? Il ressort de cette étude qu’une plus grande volonté de dévier des normes et des formes du français per- mettrait de mieux « traduire » ce parler noir dans le but d’en préserver la valeur culturelle et idéologique. ABSTRACT «The translation of dialect […] still remains one of the biggest lacunae in translation stud- ies» (Herrera 2014: 290). In what follows, I hope to contribute to discussions begun by Brodsky (1993, 1996), Lavoie (1994, 2002) and others on the difficulty of translating Black English (BE) through a study of two autobiographic novels by Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings (1969) and The Heart of a Woman (1981), and the bestseller The Book of Negroes by Lawrence Hill (2007). The role of BE in these novels is not merely one of «local colour». How have translators of those novels, Besse (2008), Saint-Martin and Gagné (2008), and Noël (2011/2014), faced the challenge of honouring the underlying purpose of the source text as well as the needs of the target audience? This study sug- gests that by accepting to deviate more frequently from the norms and forms of the French language, translators could more faithfully render Black idiom, thus preserving its cultural and ideological significance. MOTS-CLÉS/KEYWORDS traduction littéraire, traduction du dialecte romanesque, vernaculaire noir américain, literary translation, translating dialect, Black English, …, « It be’s like that sometimes. »4 (Angelou 2009 : 225) Malgré l’hégémonie culturelle américaine de ce début du 21e siècle − et malgré la présence accrue de personnages afro-américains à l’écran et dans la littérature −, les écrits sur la traduction française du Black English (BE) demeurent plutôt rares. Lavoie (2002) conclut son volume intitulé Mark Twain et la parole noire en incitant les cher- cheurs à étudier le traitement du BE dans d’autres romans, « les travaux en ce sens 460 Meta, LXI, 2, 2016 étant assez peu nombreux » (Lavoie 2002 : 213). La présente étude propose d’alimen- ter la discussion en examinant les traductions récentes de trois romans où cette variété linguistique occupe une place importante : soit deux œuvres autobiogra- phiques de Maya Angelou parues en français en 2008 : Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage, traduit par Christiane Besse (I Know Why the Caged Bird Sings, 1969)1 et Tant que je serai noire traduit par Lori Saint-Martin et Paul Gagné (The Heart of a Woman, 1981)2 ; et Aminata (2011/2014), la traduction de Carole Noël de l’œuvre de Lawrence Hill, The Book of Negroes (2007)3. Il convient de s’interroger sur la raison d’être du BE dans le roman et sur la position adoptée par le traducteur ou la traduc- trice face à la réalité. Jusqu’à quel point peut-on se permettre de dévier des normes linguistiques de la langue d’arrivée (LA) afin de préserver la valeur stylistique, cultu- relle et idéologique du vernaculaire du texte source (TS) (Oséki-Dépré 1999 : 68-77) ? 1. Black English Il existe des théories divergentes quant aux apports des différentes langues africaines parlées par les premiers esclaves dans l’évolution de cette variété linguistique que l’on appelle aujourd’hui le vernaculaire noir américain (VNA), le African American English (AAE) ou le Black English (BE)5 (voir Green 2002 : 8-11). Les « créolistes » ont longtemps maintenu que le BE a pris source dans un pidgin créé sur les plantations de l’Amérique coloniale qui fut transmis aux futures générations d’esclaves comme langue maternelle (donc comme créole) tout en préservant plusieurs caractéristiques ouest-africaines. Plus récemment, les « anglicistes » (Poplack 2000) proposent plutôt que le BE soit né d’une situation de contact prolongé avec d’autres variétés d’anglais non standard parlées à l’époque. Selon Mufwene (2000), les Africains éparpillés sur les fermes et les plantations américaines vivaient en situation minoritaire et en contact régulier avec la communauté blanche dominante anglophone, un contexte sociolinguistique qui ne favorise nullement l’émergence d’un créole. Ce point de vue angliciste accepte toutefois la possibilité d’influences africaines et même antillaises dans l’évolution de ce sociolecte. Quoi qu’il en soit, pour les descendants des esclaves africains, le BE deviendra à la fois langue commune et expression revendicatrice. Longtemps stigmatisé, voire ridiculisé par des locuteurs de variétés linguistiques plus prestigieuses, il a su trouver sa place légitime dans la culture populaire américaine et dans la littérature du 21e siècle. Tels que décrits par les linguistes américains (par exemple Labov 1976 ; Fromkin, Rodman, et al. 1997 ; Green 2002), les principaux traits morphosyntaxiques de cette variété linguistique se résument ainsi : a) « Be deletion » : l’effacement de la copule (par ex. She crazy. Where you at ?) ; b) « Habitual be » : la présence du morphème « be » signale le sens « toujours », par exemple, « John happy » veut dire « John est heureux maintenant », mais « John be happy » veut dire qu’il est toujours heureux (Fromkin, Rodman, et al. 1997 : 273)6 c) Les marqueurs aspectuels « be, been (BIN), done (dən) » pour signifier, respective- ment, une action habituelle et continue (par ex. « She be working downtown ») ; une action habituelle qui se poursuit au présent, mais qui a commencé il y a longtemps (I been -ing comme variante du present perfect progressive) ; et une action ou état maintenant terminé (par ex. « He done show me »), une sorte de « double passé composé » ; traduire le black english 461 d) L’utilisation de la double négation ou multiple et du morphème « ain’t » (traits qui se retrouvent aussi dans d’autres variétés non standard de l’anglais) et surtout de l’inversion négative en tête de phrase (par ex. « Ain’t nobody gonna stop me ») ; e) De nombreuses formes verbales « fautives » sont aussi caractéristiques d’autres variétés d’anglais (sur lesquelles nous reviendrons). Parmi les principales variantes phonétiques, signalons : a) La chute de la consonne « r », sauf devant une voyelle (Fromkin, Rodman et al. 1997 : 271) ; uploads/Litterature/ black-english.pdf
Documents similaires








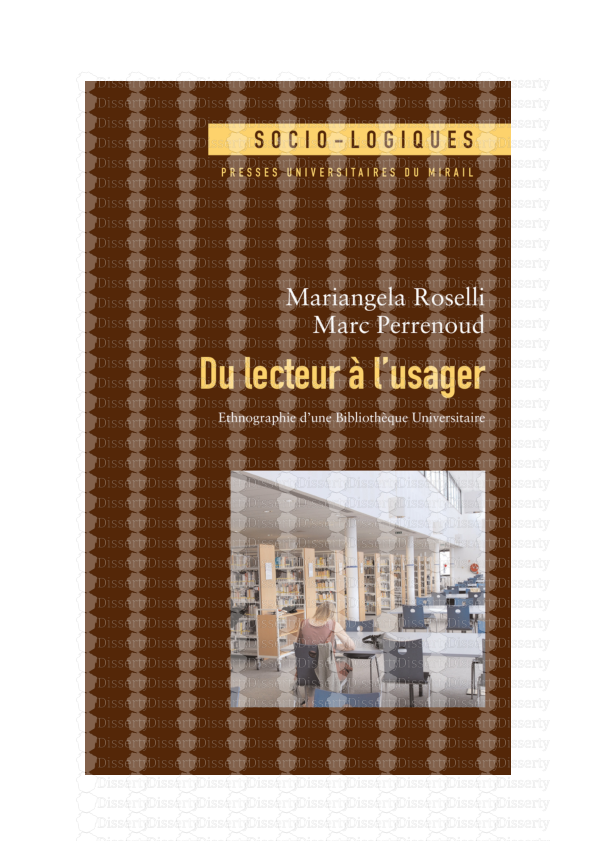

-
72
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 23, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5346MB


