François-René de Chateaubriand MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE (TOME PREMIER) 1848 édité
François-René de Chateaubriand MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE (TOME PREMIER) 1848 édité par la bibliothèque numérique romande ebooks-bnr.com Table des matières INTRODUCTION ...................................................................... 4 I .................................................................................................... 4 II .................................................................................................. 8 III ............................................................................................... 12 IV ............................................................................................... 16 V ................................................................................................. 21 VI ............................................................................................... 29 VII .............................................................................................. 36 VIII ............................................................................................ 40 PRÉFACE TESTAMENTAIRE ................................................ 45 AVANT-PROPOS .................................................................... 51 PREMIÈRE PARTIE ANNÉES DE JEUNESSE. – LE SOLDAT ET LE VOYAGEUR 1768-1800 ............................... 55 LIVRE PREMIER ...................................................................... 55 LIVRE II ................................................................................... 110 LIVRE III ................................................................................. 163 LIVRE IV ................................................................................. 202 LIVRE V ................................................................................... 240 LIVRE VI ................................................................................. 331 APPENDICE ......................................................................... 438 I LA TOMBE DU GRAND-BÉ ................................................ 438 II LE MANUSCRIT DE 1826 .................................................. 447 III LE COMTE LOUIS DE CHATEAUBRIAND ET SON FRÈRE CHRISTIAN ................................................................ 450 IV LE COMTE RENÉ DE CHATEAUBRIAND, ARMATEUR 454 V CHATEAUBRIAND ET LE COLLÈGE DE DINAN ............. 457 VI RÉCITS DE LA VEILLÉE .................................................. 459 VII LE COUSIN MOREAU ET SA MÈRE .............................. 462 VIII M. DE MALESHERBES .................................................. 468 IX LA CLÉRICATURE DE CHATEAUBRIAND ..................... 471 X LE BARON BILLING ET L’AMBASSADE DE LONDRES .. 473 XI FRANCIS TULLOCH ......................................................... 476 XII JOURNAL DE VOYAGE................................................... 481 Ce livre numérique ................................................................ 485 – 3 – INTRODUCTION I En 1834, la rédaction des Mémoires d’Outre-tombe était fort avancée. Toute la partie qui va de la naissance de l’auteur, en 1768, à son retour de l’émigration, en 1800, était terminée, ainsi que le récit de son ambassade de Rome (1828-1829), de la Révolution de 1830, de son voyage à Prague et de ses visites au roi Charles X et à Mme la Dauphine, à Mademoiselle et au duc de Bordeaux. La Conclusion était écrite. Tout cet ensemble ne for- mait pas moins de sept volumes complets. Si le champ était loin encore d’être épuisé, la récolte était pourtant assez riche pour que le glorieux moissonneur, déposant sa faucille, pût songer un instant à s’asseoir sur le sillon, à lier sa gerbe et à nouer sa cou- ronne. Avant de se remettre à l’œuvre, de retracer sa vie sous l’Empire et sous la Restauration jusqu’en 1828, et de réunir ain- si, en remplissant l’intervalle encore vide, les deux ailes de son monument, Chateaubriand éprouva le besoin de communiquer ses Mémoires à quelques amis, de recueillir leurs impressions, de prendre leurs avis ; peut-être songeait-il à se donner par là un avant-goût du succès réservé, il le croyait du moins, à celui de ses livres qu’il avait le plus travaillé et qui était, depuis vingt- cinq ans, l’objet de ses prédilections. Mme Récamier eut mission de réunir à l’Abbaye-au-Bois le petit nombre des invités jugés dignes d’être admis à ces premières lectures. Situé au premier étage, le salon où l’on pénétrait, après avoir monté le grand escalier et traversé deux petites chambres très sombres, était éclairé par deux fenêtres donnant sur le jar- din. La lumière, ménagée par de doubles rideaux, laissait cette pièce dans une demi-obscurité, mystérieuse et douce. La pre- – 4 – mière impression avait quelque chose de religieux, en rapport avec le lieu même et avec ses hôtes : salon étrange, en effet, entre le monastère et le monde, et qui tenait de l’un et de l’autre ; d’où l’on ne sortait pas sans avoir éprouvé une émotion profonde et sans avoir eu, pendant quelques instants fugitifs et inoubliables, une claire vision de ces deux choses idéales, le gé- nie et la beauté. Le tableau de Gérard, Corinne au cap Misène, occupait toute la paroi du fond, et lorsqu’un rayon de soleil, à travers les rideaux bleus, éclairait soudain la toile et la faisait vivre, on pouvait croire que Corinne, ou Mme de Staël elle-même, allait ouvrir ses lèvres éloquentes et prendre part à la conversation. Que l’admirable improvisatrice fût descendue de son cadre, et elle eût retrouvé autour d’elle, dans ce salon ami, les meubles familiers : le paravent Louis XV, la causeuse de damas bleu ciel à col de cygne doré, les fauteuils à tête de sphinx et, sur les con- soles, ces bustes du temps de l’Empire. À défaut de Mme de Staël la causerie ne laissait pas d’être animée, grave ou piquante, élo- quente parfois. Tandis que le bon Ballanche, avec une innocence digne de l’âge d’or, essayait d’aiguiser le calembour, Ampère, toujours en verve, prodiguait sans compter les aperçus, les sail- lies, les traits ingénieux et vifs. Les heures s’écoulaient rapides, et certes, nul ne se fût avisé de les compter, alors même que, sur le marbre de la cheminée, la pendule absente n’eût pas été rem- placée par un vase de fleurs, par une branche toujours verte de fraxinelle ou de chêne. C’est dans ce salon qu’eut lieu, au mois de février 1834, la lecture des Mémoires. L’assemblée, composée d’une douzaine de personnes seulement, renfermait des représentants de l’ancienne France et de la France nouvelle, des membres de la presse et du clergé, des critiques et des poètes, le prince de Montmorency, le duc de la Rochefoucauld-Doudeauville, le duc de Noailles, Ballanche, Sainte-Beuve, Edgar Quinet, l’abbé Ger- bet, M. Dubois, ancien directeur du Globe, un journaliste de province, Léonce de Lavergne, J.-J. Ampère, Charles Lenor- – 5 – mant, Mme Amable Tastu et Mme A. Dupin. On arrivait à deux heures de l’après-midi, Chateaubriand portant à la main un pa- quet enveloppé dans un mouchoir de soie. Ce paquet, c’était le manuscrit des Mémoires. Il le remettait à l’un de ses jeunes amis, Ampère ou Lenormant, chargé de lire pour lui, et il s’asseyait à sa place accoutumée, au côté gauche de la cheminée, en face de la maîtresse de la maison. La lecture se prolongeait bien avant dans la soirée. Elle dura plusieurs jours. On pense bien que les initiés gardèrent assez mal un secret dont ils étaient fiers et ne se firent pas faute de répandre la bonne nouvelle. Jules Janin, qui n’était point des après-midi de l’Abbaye-au-Bois, mais qui possédait des intelligences dans la place, sut faire causer deux ou trois des heureux élus ; comme il avait une mémoire excellente et une facilité de plume merveil- leuse, en quelques heures il improvisa un long article, qui est un véritable tour de force, et que la Revue de Paris s’empressa d’insérer1. Sainte-Beuve, Edgar Quinet, Léonce de Lavergne, qui avaient assisté aux lectures ; Désiré Nisard et Alfred Nettement, à qui Chateaubriand avait libéralement ouvert ses portefeuilles et qui avaient pu, dans son petit cabinet de la rue d’Enfer, assis à sa table de travail, parcourir tout à leur aise son manuscrit, parlèrent à leur tour des Mémoires en pleine connaissance de cause et avec une admiration raisonnée2. Les journaux se mi- rent de la partie, sollicitèrent et reproduisirent des fragments, et tous, sans distinction d’opinion, des Débats au National de 1 Revue de Paris, t. III, mars 1834. 2 L’analyse de M. Nisard sert de préface au volume intitulé : Lec- tures des Mémoires de M. de Chateaubriand (juillet 1834). – Les articles d’Alfred Nettement parurent dans l’Écho de la jeune France, nos de mai et juin 1834. – 6 – 1834, de la Revue européenne à la Revue des Deux-Mondes, du Courrier français à la Gazette de France, de la Tribune à la Quotidienne, se réunirent, pour la première fois peut-être, dans le sentiment d’une commune admiration. Tel était, à cette date, le prestige qui entourait le nom de Chateaubriand, si profond était le respect qu’inspirait son génie, sa gloire dominait de si haut toutes les renommées de son temps, que la seule annonce d’un livre signé de lui, et d’un livre qui ne devait paraître que bien des années plus tard, avait pris les proportions d’un évé- nement politique et littéraire. J’ai sous les yeux un volume, devenu aujourd’hui très rare, publié par l’éditeur Lefèvre, sous ce titre : Lectures des Mé- moires de M. de Chateaubriand, ou Recueil d’articles publiés sur ces Mémoires, avec des fragments originaux3. Il porte, à chaque page, le témoignage d’une admiration sans réserve, dont l’unanimité relevait encore l’éclat, et dont l’histoire des lettres au XIXe siècle ne nous offre pas un autre exemple. 3 Un volume in-8, à Paris, chez Lefèvre, libraire, rue de l’Éperon, n° 6,1834. – 7 – II Les heures pourtant, les années s’écoulaient. Dans son er- mitage de la rue d’Enfer, à deux pas de l’Infirmerie de Marie- Thérèse, fondée par les soins de Mme de Chateaubriand, et qui donnait asile à de vieux prêtres et à de pauvres femmes, l’auteur du Génie du Christianisme vieillissait, pauvre et malade, non sans se dire parfois, avec un sourire mélancolique, lorsque ses regards parcouraient les gazons et les massifs d’arbustes de l’Infirmerie, qu’il était sur le chemin de l’hôpital. La devise de son vieil écusson était : Je sème l’or. Pair de France, ministre des affaires étrangères, ambassadeur du roi de France à Berlin, à Londres et à Rome, il avait semé l’or ; il avait mangé conscien- cieusement ce que le roi lui avait donné ; il ne lui en était pas resté deux sous. Le jour où, dans son exil de uploads/Litterature/ chateaubriand-memoires-outre-tombe1-pdf.pdf
Documents similaires




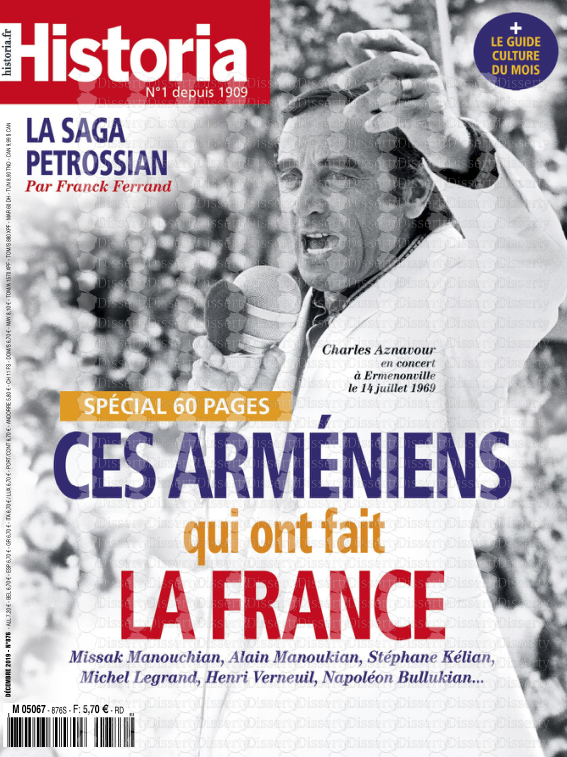





-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 02, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 2.9221MB


