EDMUND HUSSERL L'ORIGINE DE LA GÉOMÉTRIE TRADUCTION ET INTRODUCTION PAR jACQUES
EDMUND HUSSERL L'ORIGINE DE LA GÉOMÉTRIE TRADUCTION ET INTRODUCTION PAR jACQUES DERRIDA PRESSES UNIVERSIT AIRES DE FRANCE Averlissemenl Lt lexle Jonl no/u proposolls id la IraÓl«lion a íti publii pour la premiere fois, JaIlS son Ílltigralili origillal" par Walter Bie;nel, Jansl, 1I01u"" VI J,s Husserliana «Die Krisis der europilischen Wissenschaften und die transzendentale Phanomenologie, Bille EinleillOlg in Jie phiJnommologiuhe Pbilosopbi, » (M. NijbofJ, La Haye, 19M). 11 Y esl e/aui tomme I,xle annexe nO 111 (pp. 365-386) all paragraphe tIt la « Krisis ... » tonsatri a la « giomélrie pure» (118 Parlie, § 9 a, pp. 21-25). Cesl ti ttlle édilioll triliqtll que nous nous sommlS reporli Jans Mire Iratlutlion. L, maHUuril original Jale tIt 1936. Sa Iranltriplion Jatlylograpbiqtll ne porle aunm lilrt. Auleur de alle Iranstt'iplion, Eugtll Finlc en a égallmenl publii un, lIersion élaborée tlans la Revue internationale de Philosophie (nO 2,15 ja""ier 1939, pp. 203-225), sous It lilre «Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional- historisches Problem. » D,puÍI, t' tI/sous alle for1lle que le lexl, a été /u el friquemm,nl d/i. Son hisloire, au moins, lui confirail tIont tlljlz un ter/ain Jroi/ Iz l'inJépentlonr,. NOlu remerrions 1, R. P. H. L. Van Breda ,11';dil,ur M. M. Nijhoff J'QlIoir bien /lo",u nous auJon'nr Iz prls,nJer la Iratlutlion slpar;, de " I,xl,. ISBN 978.2-13-057916-8 ISSN 0768-0708 DépOt légal- 1" édition: 1962 6' édition : 20 lO, janvier Pout le texte de E. Husserl: © 1954, M. Nijhoff, La Haye (Tous droits reservés) Pour l'introducdon, la traduction et les notes: © 1962. Presses Universitaires de France 6, avcnue ReiUe, 75014 Pari. INTRODUCTION Par sa date et par ses themes, cette méditation de Husserl appar- tient au dernier groupe d'écrits rassemblés autour de Die Krisis der euroPiiÍ!(hen Wissens(haften und die transzendentale Phiinomenologie (1). Elle y est fortement enracinée et, dans cette mesure, son originalité risque de n'etre pas immédiatement apparente. Si L'Origine de la G/ométrie se distingue de la Krisis ... , ce n'est pas en vertu de la nou- veauté de ses descriptions. Presque tous les motif s en sont déja pré- sents dans d'autres recherches, qu'elles lui soient largement anté- rieures ou a peu pres contemporaines. Il s'agit en effet, id encore, du statut des objets idéaux de la sdence - dont la géométrie est un exemple -, de leur production par actes d'identification du « m;111e », de la constitution de l'exactitude par idéalisation et passage a la limite a partir des matériaux sensibles, finis et préscientifiques du monde de la vie. Il s'agit id encore des conditions de possibilité, solidaires et concretes, de ces objets idéaux le langage, l'inter- subjectivité, le monde, comme unité d'un sol et d'un horizon. Enfin, les techniques de la description phénoménologique, notam- ment celle des diverses réductions, sont toujours mises en ceuvre. Moins que jamais leur validité et leur fécondité ne paraissent entamées aux yeux de Husserl. Au premier abord, L'Origi,oze de la Géométrie ne se distingue pas davantage par le double faisceau de critiques qu'on y voit dirigées, (1) Husserliana, Band VI, Herausgegeben von Walter Biemel, M. Nijhoff, l.a Haye, 1954. Nous la désignerons en référence par la leUre K. 4 VORlGINE DE LA GJ30MJ3TRIE d'une part contre une certaine irresponsabilité techniciste et objec- tiviste dans la pratique de la science et de la philosophie; d'autre part, contre un historicisme aveuglé par le culte empiriste du jail et la présomption causaliste. Les premieres critiques étaient au point de départ de Logiljll' jorlll,II, '1 /ogit¡114 trallStlnáantalt, des AUdila- /iOIlI earllri,lIl1eJ et de la Krilj¡ ..• Les secondes étaient apparues beau- coup plus tot, dans les RechereheJ /ogiljlleJ, dans La phi/olophi, eOIllIll' lei,lIC' rigollr'lIl, dont elles étaient la préoccupation essentielle, et dans les IdéeJ ••• 1. La réduction, sinon la condamnation, du génétisme historiciste a toujours été solidaire de celle du psychogénétisme; et quand une certaine historicité est devenue theme pour la phénomé- nologie, malgré le prix de bien des difficultés, il ne sera jamais ques- tion de revenir sur ce proceso Mais jamais les deux dénonciations de l'historicisme et de l'objec- tivisme n'avaient été si organiquement unies que dans VOrigin, de la G/olllltri" ou elles procedent d'un méme élan et s'entralnent mutuel- lement tout au long d'un itinéraire dont l'allure est parfois déconcer- tante (1). Or la singularité de notre texte tient a ce que la conjonction de deux refus classiques et éprouvés suscite un dessein inédit mettTe au jour, d'une put, un nouveau type ou une nouvelle pro- fondeur de l'historicité, et déterminer d'autre part, corrélativement, les instruments nouveaux et la direction originaIe de la réBeldon historique. L'historicité des objectités idéales, c'est-a-dire lcur orlgi'" et leur traJilion - au sens ambigu de ce mot qui enveloppe a la fois le mouvement de la transmission et la perdurance de l'héritage - obéit a des regles insolites, qui ne sont ni celles des enchatnements factices de l'histoire empirique, ni celles d'un enrichissement idéal (x) Ces pages de Husserl, d'abord écrites pour sol, ont en eftet le rythme d'une pensée qui se cherche plut6t qu'elle!le s'expose. Mais iel la discontinuité apparente tient aussi 1\ une méthode toujours regrcssive, qui choisit ses interruptioDs et multipüe les retours vers son commeneement pour le reasaisir cbaque fois daDs une lumi~re recurrente. INTRODUCTION et anhistorique. La naissance et le devenir de la science doivent done etre aeeessibles a une intuition historique d'un style inouí, 0\1 la réaetivation intentionnel1e du sens devrait préeéder et eondi- tionner - en droit -la détermination empirique du fait. Dans leur irréduetible originalité, l'historicité de la science et la réflexion qu'el1e appel1e, la Geschkhtlichkeit et l'Historie (1), ont des eonditions aprioriques eommunes. Aux yeux de Husserl, leur dévoilement est principiel1ement possible et devrait nous amener a reconsidérer dans leur plus large extension les problemes de l'histo- ricité universelle. Autrement dit, la possibilité de quelque chose comme une histoire de la scicnee impose une releeture et un réveil du « sms» de l'histoire en général : son sens phénoménologique se eonfondra en derniere instanee ave e son sms téléologique. De ees possibilités de principe, Husserl tente de faire ici l'épreuve singuliere - a propos de la géométrie - et d'y déehiffrer la pres- eription d'une táche générale. Comme la plupart des textes husser- liens, L'Origine de la Géométrie a une valeur a la fois programma- tique et exemplaire. La lecture doit done en etre m~rquée par cette conscience d'exemple propre a toute attention éidétique, et se régler sur le pole de eette tache infinie a partir de laquel1e seule une phénoménologie peut ouvrir son ehemin. Dans l'introduetion que nous allons maintenant tenter. notre seule ambition sera de reconnaitre et de situer, en ce texte, une étape de la pensée husser- lienne, avec ses présuppositions et son inachevement propres. Ultime en fait, ce moment du radicalisme husserlien ne l'est peut- ~tre pas en droit. Husserl semble en convenir a plusieurs reprises. C'est done de son intention meme que nous essaierons toujours de nous inspirer, lors meme que nous nous attacherons a certaines diffieultés. (1) Dans notre traduction, nous ne signaJerons entre parenth~ses la distinction entre Historie et Geschichte que lorsqu'elle répond a une intention explicite de Husserl, ce qui n'est pas, il s'en laut, "toujours le cas. 6 L'ORIGINE DE LA CE-OMbTRIE 1 L'objet mathématique semble etre l'exemple privilégié et le fil conducteur le plus permanent de la réflexion husserlienne. C'est que l'objet mathématique est idlal. Son etre s'épuise et transparatt de part en part daos sa phénoménalité. Absolument objectif, c'est-a-dire totalement délivré de la subjectivité empirique, il n'est pourtant que ce qu'il apparart. I1 est donc toujours déja rMuil a son sens phénoménal et son etre est d'entrée de jeu etre-objet pour une conscience pure (1). La Philosophie der Arilhmelik, premi~re ceuvre importante de Husserl, aurait pu s'intituler L'Or(e,ine de /' Arifhmltique. I1 s'agissait déja, comme dans L'Origine de la Géomltrie, malgré une inflexion psychologiste dont on a souvent et justement souligné l'originalité (z), de réactiver le sens originaire des unités idéales de l'arithmétique par un retour aux structures de la perception et aux actes d'une subjec- tivité concrete. Husserl se proposait déja de rendre compte a la ¡oís de l'idéalité normative du nombre - qui n'est jamais un fait empi- rique accessible a une histoire de meme style - et de sa fondation dans et par l'acte vécu d'une production (5). La genese de l'arithmé- (x) Sur la question de savoir si l'objet mathématique est, pourHusserl,le modele de la constitution de t01lt objet, et sur les conséquenl.'Cs d'une telle hypothése, d. la di"clIssion a laql1eIle ont participé W. Biemel, E. Fink et R. Jngarden, a la suite de la conférellce de W. B IEMEr. sur • Le~ phases décisives dans le développement de la philosophie de Husserl., in Husserl (Cahiers de Royaumont, 195CJ), pp. 63-71. (2) Cf. en particulier W. nIEMEL, ibid., pp. 35 5q. Malgré sa sévérité pour cette tendance psycho)ogiste, Husserl n'a cessé de se référer a son premier livre, en particulier dans la T.ogiqlu formelle et tramcendantalc. (3) • Les flombres sont des créatüms tU l'esp,it, daflS uploads/Litterature/ derrida-j-l-origine-de-geometrie 1 .pdf
Documents similaires

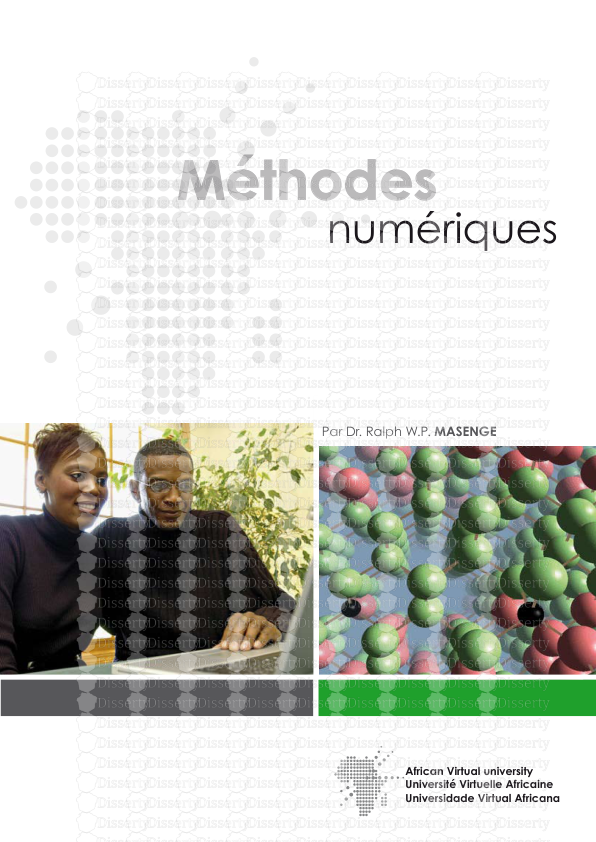








-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 07, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 23.8018MB


