De la leeture avant toute chose... Enseignement / apprentissage du F.L.E. par l
De la leeture avant toute chose... Enseignement / apprentissage du F.L.E. par la littérature Héléne Rufat Perelló Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) Le plaisir du texte ne fait pas acception d'idéologie Roland Barthes Si aetuellement les théories et les études sur Penseignement / apprentissage du F.L.E. par la littérature sont relativement fécondes, il n'en a pas toujours été de méme, et cet intérét récent exprime sürement un mea culpa. En 1982, Henri Besse déclarait amérement que tout retour au texte littéraire comme support et modele d'enseignement/apprentissage de la langue étrangére1 lui paraissait exclu, étant donné que le discours littéraire avait presque toujours eu un role marginal dans l'histoire de la didactique des langues (du moins en Occident). On pourrait rechercher les causes de l'abandon de ce support didactique qui se trouvait étre, á l'origine de l'enseignement des langues étrangéres, la seule référence valable, alors que l'enseignement des langues mortes persiste á se maintenir dans la veine littéraire. II est probable que les langues vivantes aient éprouvé le besoin de se faire reconnaítre et sentir en tant que telles; ce qui les a conduit á adopter un enseignement fondé sur 1'oral. Mon propos n'est pas d'étudier les raisons de ce changement didactique2, mais ce changement est á la source de la problématique que je voudrais exposer: alors qu'actuellement il est courant d'exiger aux jeunes qui s'intégrent á une quelconque activité internationale d'avoir une compétence effective en compréhension écrite d'une langue étrangére (et dans notre cas du Frangais), on se retrouve face á une pauvreté éditoriale si l'on prétend enseigner le F.L.E., á des débutants universitaires, en ayant pour objectif principal la compréhension écrite des textes littéraires. Les manuels de F.L.E. s'inquiétent essentiellement de la production de Toral puis de l'écrit et finissent par subordonner le fait littéraire á l'enseignement de la langue. Pourtant le trajet de la littérature 'Henri Besse, "Éléments pour une didactique des documents littéraires", in J. Peytard et alii (1982), pp. 13-34. 2 Cette étude serait sans aucun doute fort intéressante, et nous renvoyons á ce propos á l'article de D. Coste "Apprendre la langue par la littérature?" in J. Peytard et alii (1982) pp. 59-73, oü il fait un bref exposé de ce que représente Penseignement des langues mortes par la littérature, avec ses réussites et ses échecs. vers la langue se révéle stimulant et tout á fait praticable, surtout (il faut bien l'avouer) avec des étudiants hispanophones et catalanophones. II faut pour cela exercer sans reláche la lecture, qu'elle soit dirigée, commentée et/ou illustrée. Et la validité d'une telle démarche dépend des moyens et de la maniére de la réaliser. Par ses propres caractéristiques, le texte littéraire se défend seul comme matériel principal de l'enseignement / apprentissage. Pourquoi le considérer "sacré", "joli", l'exemple de la "langue noble" (comme semble le faire les enseignants enquétés par Dominique Bourgain * ) et le reléguer, ou le cantonner, ainsi á un role d'illustration? Ceci est la meilleure maniére de l'éloigner, de le distancer de l'apprenant. Peut-étre conviendrait-il de présenter á ce dernier, avant toute autre chose, quelques lignes de Roland Barthes exprimant que Le plaisir du texte [...]peut trés bien prendre la forme d'une dérive [et que celle-ci] advient chaqué fois que [l'on] ne respecte pas le tout\ II est sans doute positif de mythifier un tant soit peu le texte littéraire pour faire prendre en considération sa valeur, mais le sacraliser et le mettre dans une vitrine, ou interposer entre lui et le lecteur une "cloison vitrée"\ ne peut que conduire á un échec de l'approche littéraire, écartée ainsi de toute démocratisation culturelle, et confirmant que "le beau est futile". La linguistique s'intéresse á la relation langue / littérature, dans un pre- mier temps, comme á un probléme philosophique: il s'agirait de révéler la "Vérité littéraire" (selon les mots de Todorov), mais dans un deuxiéme temps ces recherches, ou plutót leurs résultats, sont útiles á l'enseignement de la littérature et de sa langue, malgré les considérations méprisantes de certains philosophes á leur égard6. Todorov exprimait ainsi ses aspirations en 1988 : Ce que je refuse [...] c'est la réification de ces segments de l'expérience littéraire que sont la structure formelle de l'oeuvre ou sa détermination historique en méthodes. En effet, le réductionnisme fonctionnel, structural ou formel est le grand danger de l'étude du texte littéraire; et la linguistique nous aide á mieux cerner les points d'action pour son exploitation en F.L.E.7. C'est ainsi, avec 5 Cf. son article: "Enseigner la littérature? Des enseignants face au texte littéraire" in J. Peytard et alii (1982), pp.77-93. 4 Barthes, R. (1973), p.32 ' C'est ee que reproehait Sartre a Camus á propos du style de UEtranger ( Sartre (1947), P-107) 6 Tel Alain Finkielkraut (1987) qui, aprés une interprétation rapide et superficielle, repro- che, de maniére provocante, á l'analyse structurale son role égalisateur en playant á un méme niveau de qualité, "les chef-d'oeuvre" et le "tout-venant". Ce qui est pour lui un sacrilége! (pp. 77-78, 138). ' Cf. l'excellente étude d'Arnaud Pelfréne et Robert Strick: "Méthodes de langue et texte littéraire", in J. Peytard et alii (1982), pp.35-57. beaucoup de bon sens, que Jean Peytard expose son "parí sémiotique" selon lequel le texte littéraire est celui oü le langage travaille de maniére non-linéaire et non-univoque sans pour autant en interdire une approche réglée8. Parce que précisément il révéle et ¡Ilustre les potentialités múltiples du langage, le texte littéraire a inévitablement sa place dans les cours de F.L.E.. Henri Besse, de son cóté, ajoute au fait que dans le document littéraire la langue travaille autant quelle est travaillée, qu'il est Vun des lieux oü s'élaborent et se transmettent les mythes et les rites dans lesquels une société se reconnait et se distingue9. En effet, le document littéraire bénéficie de la valeur intrinséque de se trouver á la croisée protéiforme des savoirs. Méme si Jakobson soutient l'autonomie relative de la production d'un document littéraire en le définissant comme celui oü la fonction poétique serait dominante par rapport aux cinq autres fonctions, et surtout par rapport á la fonction référentielle, il n'en est pas moins vrai que le texte littéraire reste ouvert á la possibilité de "lectures plurielles" (chéres aux sémioticiens) précisément parce qu'il renferme en soi une multitude de références latentes, qu'elles soient d'ordre culturel, idéologique ou linguistique. Néanmoins, le fait d'admettre que la détermination historique, sociale et culturelle est moins présente dans la plupart des docu- ments littéraires que dans les documents non littéraires, en raison des múlti- ples transformations qu'exige le travail d'écriture et de lecture, ne fait que repórter l'intérét d'un texte sur la langue qui y est travaillée; ce qui renvoie encore aux références culturelles. L'autonomie relative de la production du texte littéraire peut aussi se justi- fier par la situation concréte d'échange: on peut diré, par exemple, méme si d'une maniére peut-étre un peu fantasmatique que l'écrivain produit "pour toujours" (ce qui représenterait une différence par rapport á Particle de jour- nal qui est normalement moins intéressant le lendemain que le jour méme). Ceci est en fait une des causes de la faiblesse de la fonction référentielle du discours littéraire. Parce qu'il renvoie presque toujours á un monde ou á une situation imaginaire qui échappe aux contingences de l'actualité, et qu'il n'est pas forcément en relation avec les intentions et le vécu de l'écrivain, il fait appel aux compétences culturelles du lecteur: l'étudiant-lecteur peut investir le texte de sa propre image, et le fait de solliciter son vécu stimule sa mémoire; ainsi, il appréhende le texte comme il lui convient le mieux, en méme temps qu'il s'intéresse á l'aventure de la langue. 8 Peytard, J. (1986), p.247. 9 H. Besse: "Quelques réflexions sur le texte littéraire et ses pratiques dans l'enseignement du frangais langue seconde ou langue étrangére", Le Tréfle n°9, Lyon, 1989; cité par Adam J.-M. (1991). La pratique de la eompréhension écrite comme unique objectif de Penseignement / apprentissage du F.L.E. présente l'avantage de ne pas devoir affronter le probléme du saut ou du passage á l'écrit qui est le lot de tout enseignement centré sur la production órale oü le document littéraire n'a guére plus qu'une finalité d'illustration de la legón ou bien n'est qu'un prétexte pour la réutilisation des éléments qui doivent étre assimilés. Encore resterait-il á déterminer dans quelle mesure les progrés de lecture sont liés á ceux de l'expression órale ou écrite; l'hypothése d'une relation d'équivalence stricte entre ces deux éléments, de eompréhension et d'expression, est á remettre en cause. L'assimilation du F.L.E. par la lecture est possible parce que le docu- ment littéraire est une illustration "vivante" des regles de morphologie et de syntaxe de la langue, et il n'est pas indispensable de réutiliser le texte pour des exercices de langue, de réadaptation, substitution, pour des exercices de style ou d'explication de texte qui ne sont pas bien acceptés á un niveau universitaire. Le texte littéraire permet d'abord, de par sa présentation, d'apprendre agilement la discrimination entre langue parlée et langue écrite (ou soutenue), de reconnaítre les différents styles d'un discours, de uploads/Litterature/ enseignement-aprentissage-du-fle-par-la-litterature.pdf
Documents similaires




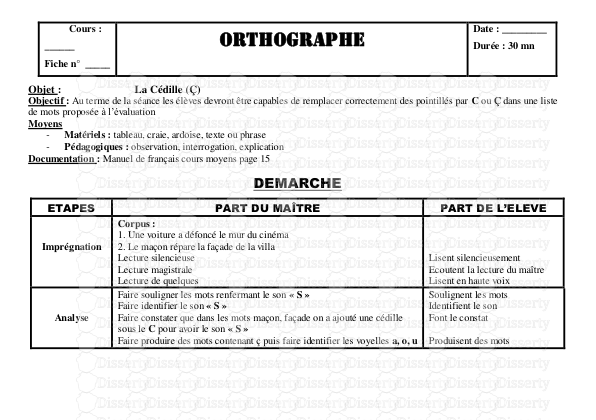





-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 23, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3411MB


