UNIVERSITE DE PARIS VIII A SAINTDENIS MUSICIENS ET POETES EN EGYPTE AU TEMPS D
UNIVERSITE DE PARIS VIII A SAINTDENIS MUSICIENS ET POETES EN EGYPTE AU TEMPS DE LA NAHDA TOME PREMIER -1===- Thèse de doctorat nouveau régime présentée par Frédéric LAGRANGE sous la direction du professeur Jamel Eddine BENCHEIKH. Décembre 1994. -2===- UNIVERSITE DE PARIS VIII A SAINTDENIS MUSICIENS ET POETES EN EGYPTE AU TEMPS DE LA NAHDA TOME SECOND -3===- Thèse de doctorat nouveau régime présentée par Frédéric LAGRANGE sous la direction du professeur Jamel Eddine BENCHEIKH. Décembre 1994. -4===- UNIVERSITE DE PARIS VIII A SAINTDENIS MUSICIENS ET POETES EN EGYPTE AU TEMPS DE LA NAHDA ANNEXES -5===- Thèse de doctorat nouveau régime présentée par Frédéric LAGRANGE sous la direction du professeur Jamel Eddine BENCHEIKH. Décembre 1994. -6===- MUSICIENS ET POETES EN EGYPTE AU TEMPS DE LA NAHDA Thèse de doctorat nouveau régime présentée par Frédéric LAGRANGE sous la direction du professeur Jamel Eddine BENCHEIKH. Décembre 1994. -7===- à mon père... -8===- Mes remerciements et ma profonde reconnaissance vont à ceux sans qui ce travail n'aurait pu être mené à bien: Bernard Moussali, qui m'a initié à cette musique, fait découvrir le 78 tours, qui a aussi formé mon goût et aidé à élaborer une réflexion suite à nos nombreux échanges. et: Hedeya Cherkawi, qui m'a patiemment lu, conseillé et corrigé, m'a rappelé le soin du détail et m'a tant fait profiter de sa double science du dialecte égyptien et de la langue française. Nidaa Abou Mrad, qui m'a appris la musique et m'a fait profiter de sa science et de sa réflexion. °Abd al°Azîz al°Anânî, qui m'a accueilli comme un fils dans la plus riche discothèque d'Egypte, qui m'a tant appris sur les disques et leur histoire, qui m'a tant informé sur la vie musicale égyptienne. et aussi : Ruth Edge, qui m'a aidé dans mes recherches au sein des archives EMI à Hayes. Christian Poché, qui m'a ouvert les trésors de sa bibliothèque et fait accéder à une documentation si rare. Philippe Vigreux, qui m'a généreusement accueilli et hébergé au Caire, me donnant les moyens de mener à bien ma recherche. -9===- SYSTEMES DE TRANSLITTERATION ET DE TRANSCRIPTION La transcription et translittération de l'arabe classique et du dialecte égyptien utilise les caractères I.S.O. modifiés sur certains points de détail: le "h" I.S.O. ("kh" de l'Encyclopédie de l'Islâm) sera ici noté "k" pour raisons informatiques ; suivant la prononciation courante du dialecte comme de l'arabe classique en Egypte, le "g" I.S.O. (dj de l'Encyclopédie de l'Islâm) sera noté "g", sauf dans les noms propres non égyptiens. Le "c" I.S.O. qui symbolise la lettre "cayn" sera noté "°". Pour le dialecte égyptien, nous utiliserons les voyelles additionnelles et les règles établies par Jomier et Khouzam dans le Manuel d'Arabe Egyptien (Kliencksieck, 1975): une seule voyelle longue est possible dans un mot, pas de voyelles longues en fin de mot, transformation de la longue en brève quand elle est suivie de deux consonnes. Ces règles ont été exceptionnellement transgressées quand des nécessités métriques ou des caractéristiques de la langue chantée l'exigeaient. Les interdentales "d" et "t" seront remplacées par "d", "z", "t" ou "s" suivant l'usage, sauf dans les noms propres. La réalisation en hamza du "q" sera notée "q". Pour les noms propres, les titres d'ouvrages, de pièces ou de films en arabe classique, nous optons pour la translittération. Par conséquent, ni les désinences casuelles, ni l'assimilation du lâm de l'article devant les lettres solaires, ni la hamza en début de mot ne seront notés. ex: "magmû°at alagânî alsarqiyya". Nous avons le plus souvent "classicisé" les noms propres égyptiens, "Mahammad °Osmân" devenant "Muhammad °Utmân". Nous y avons renoncé quand cette classicisation aurait mené à des prononciations trop fautives: on ne saurait manipuler le nom des personnes. Ainsi, le chantre Abû al°Ilâ Muhammad n'est devenu ni "Abû al°Ulä", ni "Abû al°Alâ'", conservant un "°Ilâ" peu classique mais que rien ne saurait remplacer. Pour les vers de poésie dialectale ou classique, nous choisissons la transcription. Dans le cas d'une désinance précédent un article, elle a été ajoutée à la fin du mot et l'article noté par un simple "l". ex. classique: "arâka °asiyya ddam°i sîmatuka ssabru" ex. dialectal: "wennabi tôba mani sarba m°âk" Nous avons été contraint pour certains textes en langue intermédiaire à mêler des procédés de transcription relevant du classique et du dialecte. -10===- TABLEAU DES TRANSLITTERATIONS ' b t t pour le classique, s ou t pour le dialecte g, g pour les noms propres non égyptiens h k d d pour le classique, z ou d pour le dialecte r z s s s d t z ° g f q pour le classique, q pour le dialecte k l m n h w y voyelles longues : â, ê, î, ô, û voyelles brèves : a, e, i, o, u -11===- SOMMAIRE INTRODUCTION 1 PREMIERE PARTIE: LA SOCIETE DES MUSICIENS ET DES POETES 21 I Le milieu musical à l'aube de la Nahda: esquisse d'un tableau 22 1. L'Egypte du XIXe siècle et ses musiciens 23 1.1 Croissance et enrichissement d'une société 23 1.2 Les plaisirs du peuple à l'époque du khédive Ismâ°îl 27 1.3 Une tradition urbaine: les Sahbageyya 29 1.4 Les musiciens professionnels et leur guilde 30 1.5 Les musiciennes 34 1.5.1 Pleureuses et magiciennes 35 1.5.2 Les almées 36 1.6 Alsitt Almaz 43 1.7 Le répertoire des almées 44 2. Le chant religieux: psalmodiants et hymnodes 47 2.1 Psalmodie du Coran et appel à la prière 47 2.2 L'art du munsid 50 3. Les plaisirs de l'élite: musiques ottomane et occidentale 56 3.1 Les échanges musicaux entre l'Egypte et le ProcheOrient 57 3.2 La place de la musique occidentale 61 II L'école de la Nahda de l'ère khédiviale à la Grande Guerre 67 1. L'apparition de l'école khédiviale 67 1.1 Une soirée de musique au Caire à la fin du XIXe siècle 68 1.2 Hâmûlî et °Utmân: un essai de biographie anhagiographique 71 1.2.1 °Abduh afandî alHâmûlî 71 1.2.2 Le compositeur Muhammad °Utmân 77 2. L'image du musicien: à la recherche de la respectabilité 79 2.1 Le mécénat khédivial 79 2.2 L'hymnode et les musiciens 81 2.3 Vivre de sa musique? 83 2.4 La mauvaise réputation 86 3. Des salons à la scène: les espaces du plaisir 90 3.1 Un munsid sur les planches: la naissance du théâtre lyrique 93 3.1.1 La vie du Sayk Salâma Higâzî 94 3.1.2 Son apport à la musique de la Nahda 96 3.2 La musique savante au caféconcert et la naissance de la variété 100 3.3 Les almées montent sur les planches 103 4. Intellectuels et musiciens 105 -12===- 4.1 La musique dans la dynamique de la Nahda 106 4.2 Le discours des savants 119 4.2.1 La faiblesse des textes 119 4.2.2 Les manières des musiciens 121 4.3 Le complexe du kawâga 122 III L'intrusion du 78 tours dans la musique égyptienne 133 1. Les compagnies à la conquête de l'Orient 136 1.1 La création des multinationales 136 1.2 Tournées mondiales et premières séries d'enregistrement 138 1.3 Les tornées Zonophon et Gramophone de 1903 et 1905 139 1.4 Premières tournées allemandes 142 1.5 Les compagnies s'installent dans leurs meubles 144 1.6 Le disque objet de désir 151 1.7 Les catalogues 153 1.8 La fin de l'ère du 78 tours 156 2. La nature des enregistrements commerciaux 158 2.1 Le 78 tours témoin de l'activité ou miroir déformant? 158 2.2 La musique religieuse 161 2.3 Une image biaisée de la vie musicale 163 2.4 Conditions d'enregistrement de la wasla 166 3. L'évolution du goût musical à travers le 78 tours 172 3.1 L'évolution des genres 172 3.2 Analyse des graphiques 182 4. Les évolutions provoquées par le disque 191 4.1 Du mécénat au salaire: le financement de la musique 192 4.2 La propriété artistique 198 4.3 Le public: des cénacles à l'homme de la rue 203 IV Du chant à la chanson: mort d'un classicisme, naissance de la variété 215 1. Les années 20, âge d'or du caféchantant et de l'opérette 218 1.1 Déclin de l'école khédiviale et nouvelles tendances 218 1.2 La Sultane du Chant 221 1.3 Le Rossignol de l'Orient 224 1.4 L'opérette, cheval de Troie de l'acculturation 226 1.5 Sayyid Darwîs, héros de la musicologie arabe 231 2. Les professions musicales entre patrimonisme et modernisme 238 2.1 Les écoles et la naissance d'une musicologie 238 2.2 L'Institut et ses avatars, le Syndicat des Musiciens 240 3. Du Congrès de 1932 au kultûmisme, l'idéologie du changement 246 3.1 Le Congrès de Musique Arabe du Caire, 1932 246 -13===- 3.2 Umm Kultûm et °Abd alWahhâb: le modernisme triomphant 250 3.2.1 L'appartion du monologue et uploads/Litterature/ frederic-lagrange-musicienes-et-poetes-en-egypte-au-temps-de-la-nahda.pdf
Documents similaires


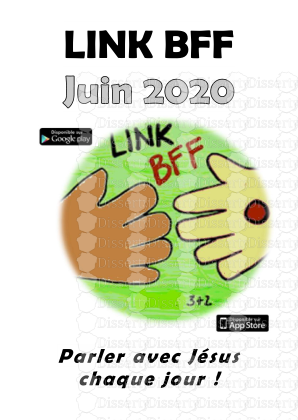







-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 11, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 3.3018MB


