La femme africaine dans Une si longue lettre de Mariama Bâ et Assèze l’Africain
La femme africaine dans Une si longue lettre de Mariama Bâ et Assèze l’Africaine de Calixthe Beyala « On ne naît pas femme, on le devient » Simone de Beauvoir Författare: Malin Haaker Handledare: Liviu Lutas Examinator: Chantal A. Ottesen Termin: HT-2013 Ämne: Franska Nivå: G3 Kurskod: 2FR30E 2 ABSTRACT This study is based on the main female African characters in Une si longue lettre written in 1979 by Mariama Bâ and Assèze l’Africaine written in 1994 by Calixthe Beyala. Both novels describe the African society and the obstacles that exist for women in this society where men dominate. This study presents the transformation of Ramatoulaye that is a traditional and passive woman but she becomes modern. In addition, it presents the transformation of young Aïssatou that becomes an independent and strong woman, in these two novels. These two women are facing similar forms of discriminations and oppression in the African society and they are struggling against injustice in various ways. The aim of this analysis is to investigate how the image of the African women and the feminism in Africa show and develop through the main characters, Ramatoulaye and Aïssatou. The conclusion reveal that the image of the African women has considerably changed over the years in a positive way and that Femininity is a cultural construction and not a natural construction. The conclusion further reveal that even today a woman is not independent, but is still considered "the Other" in relation to the man. Keywords: Mariama Bâ. Une si longue lettre. Calixthe Beyala. Assèze l'africaine. Female characters. Africa. Feminism. Polygamy. African writers. 3 Table des matières 1. INTRODUCTION 1.1 Objectif 4 1.2 Approche théorique et méthodique 4 1.3 Études antérieures 7 2. LA LITTÉRATURE DE MARIAMA BÂ 9 2.1 Résumé du roman 9 2.2 Conception du mariage 10 2.3 Femme moderne ? 11 3. LA LITTÉRATURE DE CALIXTHE BEYALA 13 3.1 Résumé du roman 14 3.2 Femme à la recherche d’elle-même 14 3.3 Modernité et tradition 16 4. CONCLUSION 17 BIBLIOGRAPHIE 4 1. Introduction 1.1 Objectif Dans Une si longue lettre, Mariama Bâ discute une grande question : la polygamie. Dans Assèze l'africaine, Calixthe Beyala discute entre autres l’identité de la femme africaine. Ce qui est intéressant avec ces deux ouvrages, c’est qu’ils sont écrits pendant deux époques différentes au cours de l’histoire du féminisme. Les deux romans décrivent la société africaine et les obstacles qui existent pour les femmes dans cette société. Ces romans ont été choisis parce qu’ils illustrent bien la vie des femmes africaines d’auparavant et d’aujourd’hui vivant surtout en Afrique mais aussi en Europe. Ce sont également deux romans bien écrits avec un vocabulaire très varié, et ils présentent des aspects intéressants sur l’engagement féministe de Mariama Bâ et de Calixthe Beyala. Dans ce mémoire, nous analyserons l’image de la femme que se font les personnages principaux dans les relations hommes-femmes d’une société patriarcale en Afrique. En même temps, nous allons aussi examiner les similarités et les disparités en ce qui concerne le développement du féminisme africain entre les deux romans. Notre problématique est la suivante : comment l’image de la femme africaine et le féminisme en Afrique sont-ils présentés et comment ont-ils évolués entre les deux romans ? 1.2 Approche théorique et méthodique « Le féminisme ; Doctrine qui lutte en faveur de droits égaux entre l’homme et la femme ». Le Petit Robert La littérature féminine africaine d’expression française a émergé dans les années 70 quand les femmes africaines ont commencé à mettre en question leurs propres conditions d’existence et à les exprimer sous formes de fictions romanesques. Le féminisme en Afrique a souvent été soumis à une critique en ce qui concerne la question de l'absence de pouvoir des femmes et le manque de critique de la domination des hommes dans la vie publique, dans l'économie, dans la politique et dans la société. Il n'y a pas une définition unique pour décrire le féminisme: elle change selon l'époque et la société. Jusqu’aux années 70, les premiers écrits produits par les femmes étaient plutôt autobiographiques et tournaient autour de la vie quotidienne. La plupart des romans écrits par 5 les femmes montrent l'importance de la famille. Mais vers les années 80, les écrits des femmes africaines changent d’orientations et passent des thèmes de leur marginalisation par la tradition et le colonialisme, à d’autres thèmes. Les femmes écrivaines abordent également les thèmes qui les préoccupent, tels que: la maternité, le mariage, la relation mère-enfant, l’éducation de la femme, la lutte pour l’équité, la femme au travail, l’indépendance économique et les stratégies féminines de résistance à toute forme d’oppression. Aujourd’hui, les écrivaines d’Afrique s’intéressent aux problèmes sociaux, politiques et économiques. Elles revendiquent un changement social et leurs œuvres deviennent un aide pour transformer la réalité dans laquelle elles vivent. (Arndt, 2002 :71) Pour pouvoir examiner les questions concernant le féminisme africain, nous nous appuierons sur le livre The Dynamics Of African Feminism (2002) qui est écrit par Susan Arndt. L’auteure discute et définit la nature du féminisme africain et la littérature féministe africaine. Selon Arndt, le féminisme africain n'est qu'un modèle théorique. En Afrique, le féminisme moderne est complexe et il a beaucoup de manifestations et expressions, et il n'est donc pas possible de se référer à un seul « féminisme africain ». Eu égard à la diversité ethnique, culturelle, sociale, économique, politique et religieuse de l'Afrique, il existe nombreuses variétés de féminisme africain et il existe au sein de et en dehors de l'Afrique d'aujourd'hui. Nous pouvons supposer que tous les types de féminisme en Afrique ont une fondation en commun. Susan Arndt définit le feminisme comme: Feminism is a worldview and way of life of women and men who, as individuals, groups, and/or organisations, actively oppose existing gender relationships based on discriminating hierarchies and ratings. Feminists not only recognize the mechanisms of oppression, they also aim at overcoming them (Arndt, 2002:71). Dans Calixthe Beyala – Performing of Migration (2006), Nicki Hitchcott examine des représentations de Calixthe Beyala dans les médias et les réponses critiques à son écriture. Hitchcott analyse les efforts de Beyala de se positionner comme un champion des droits des femmes. Hitchcott accorde une attention particulière aux romans de Beyala et elle retrace leurs explorations du rôle de la migration dans la création de l'identité personnelle. Pour pouvoir examiner les questions concernant la femme, les théories de Simone de Beauvoir nous seront utiles puisqu'elle analyse la situation de la femme dans son livre Le deuxième sexe I (1949a). L'auteure répond à la question de savoir ce qu'est une femme : elle 6 explique la différence entre homme et femme en étudiant plusieurs auteurs et philosophes. De Beauvoir explique dans son œuvre que la femme est toujours considérée comme l'Autre : « Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle ; elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le Sujet, il est l'Absolu : elle est l'Autre » (De Beauvoir, 1949a : 16). Dans Le deuxième sexe II (1949b), Beauvoir traite entre autres la question de la polygamie et traite l'image de la femme par rapport à l'homme. Elle analyse la situation de la mère et de la femme mariée mais aussi sa situation dans la vie sociale. Selon de Beauvoir, le mariage est le destin traditionnel de la femme, mais les époux ne sont jamais égaux. Le mariage rend la femme passive. (De Beauvoir, 1949b : 9). Selon de Beauvoir, nous vivons dans une société patriarcale où les hommes dominent. Ils ont plus de pouvoir que les femmes ce qui l'amène à conclure que les hommes sont la majorité et les femmes la minorité. Mais la femme est importante dans la société parce que dans une relation entre deux personnes, on est dépendant l'un de l'autre : « elle est l'Autre au cœur d'une totalité dont les deux termes sont nécessaires l'un à l'autre » (De Beauvoir 1949b : 21). Dans Le deuxième sexe I, Simone de Beauvoir lutte contre l'idée de l'importance des différences biologiques entre les sexes ; elle écrit « [qu'] on ne naît pas femme, on le devient » (De Beauvoir, 1949a : 285). C'est donc l'éducation sociale et psychologique qui créent les différences les plus importantes entre les femmes et les hommes et, dans ce processus, la distribution inégale du pouvoir est signifiante. Bien que la femme, comme les hommes, soit à l'origine un sujet indépendant, elle est forcée par l'homme à devenir l'Autre, la négation de l'homme. Pour approfondir nos connaissances sur la situation de la femme, nous allons aussi étudier Critical theory today (1999) de Lois Tyson qui donne une explication détaillée de plusieurs théories comme par exemple le féminisme, en utilisant des exemples de la vie quotidienne, la culture populaire, et les textes littéraires : « In every domain where patriarchy reigns, woman is « other » : she is marginalized, defined only by her difference from male norms and values, which means defined by what she (allegedly) lacks that men uploads/Litterature/ full-text-01 2 .pdf
Documents similaires

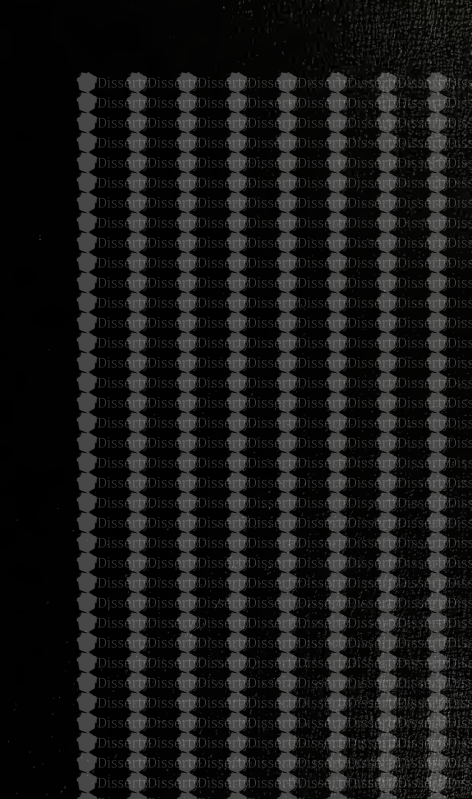








-
93
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 18, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7272MB


