Jean-Patrick Deb bèche A thesis submitted in conformity with the requirements f
Jean-Patrick Deb bèche A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of French University of Toronto Copyright by Jean-Patrick Debbèche, 1997 National Library Bibliothèque n a t i o n a l e du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographic Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395. rue Wellington Ottawa ON K1A ON4 OtrawaON K1AON4 Canada Canada The author has granted a non- exclusive licence allowing the National Library of Canada to reproduce, loan, distribute or seli copies of this thesis i n microfonn, paper or electronic formats. The author retains ownership of the copyright in this thesis. Neither the thesis nor substantial extracts h m it may be printed or otherwise reproduced without the author's pemission. Your W Voire rëierenw Our Norre reldrence L'auteur a accordé une licence non exclusive permettant à la Bibliothèque nationale du Canada de reproduire, prêter' distribuer ou vendre des copies de cette these sous la forme de microfiche/Eilm, de reproduction sur papier ou sur fonnat électronique. L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur qui protège cette thèse. Ni la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans son autorisation. Repenser 1' intertextualité par rapport à I' épistémologie sémiotique, tel est notre projet dans ce travail. La recherche sur l'intertextualité menée tambour battant par la critique des années soixante dix, à laquelle nous consacrerons la première partie de cette étude, a laissé beaucoup de questions en suspens. Si la critique littéraire doit faire sienne, en principe, l'étude des tensions entre textes, elle s'arrange le plus souvent pour fixer des critères définitoires davantage redevables de jugements de valeur sur l'état de la pollution (pureté/impureté) de la forme intertextuelle, et sur le statut de la source et de l'influence, que sur le mode de production de 1' intertextuahté. C'est donc un parcours que nous proposerons, un parcours de l'intertextualité depuis Aristote, car l'intertextuel a toujours été lié à la poétique classique et aux conventions ... jusqu'à Kristeva. Mais c'est bien par cette dernière que nous commencerons, une manière de s'engager d'emblée dans la voie du rendement épistémologique de l'intertextualité et dans celle, capitale, de la définition des enjeux que l'intertextualité pose pour la sémiotique. Il importe de préciser d'ores et déjà, qu'en dépit de ces quelques quatre cent pages qui vont suivre, nous ne sommes pas des fanatiques de l'intertextualité, tant s'en faut, le souci qui guidera cette étude sera de poser des gestes sémiotiques sur l'intertextualité, d'explorer les présupposés théoriques de ce modèle, de proposer enfin dans la troisième partie de cette étude une analyse de l'intertextualité dans la pièce Eugénie de Beaumarchais, doublée d'un cadre conceptuel sémiotique pour la saisie de l'intertextualité. Or de quelle sémiotique s'agit-il? Depuis que le sentir est venu à la rencontre (ou à la rescousse) du connaître, l'épistémologie sémiotique a inauguré un nouveau rapport au sens, un rapport fondé sur la perception, la médiation du corps, le senrir, la tensivité. Nous ajouterons donc ces nouveaux paramètres, développés par AIgirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille dans Ln Sémiotique des passions, des états de choses a z u r états d'ûrne (1991), à notre saisie de l'intertextualité, tout en réaménageant le dispositif théorique en fonction de l'objet d'analyse. La sémiotique des passions n'est pas un bradage épistémologique des acquis de Hjelmslev, elle est tout au plus une réorganisation du champ théorique qui tient compte de l'effet de sens émanant du monde sensible. Notre approche continuera donc de se réclamer des acquis de Hjelmslev et de Saussure. Mes remerciements vont à Paul Perron, directeur de cette thèse, Anne Ubersfeld, Marj0r-k Rolando, Peter Marteinson, Denise Banks, Yolanda Ballard, et tous ceux qui ont rendu possible cette recherche. TABLE DES MATIERES 13 INTRODUCTION CHAPITRE I 15 LE NIVEAU DE PERTINENCE 15 1 . Positions 18 2 . Première hypothèse : solidarité et dépendance 21 3 . Seconde hypothèse : vers un modèle plus souple 22 L'INTERTEXTUALITE 22 1 . La mise en place d'un cadre conceptuel : Knsteva 18 1 . Le croisemernt et la transformation 27 2 . La dénotation hors jonction 30 3 . Le référent 32 4 . Le symbolique et le psychique 37 5 . L'anisotopie 40 II . Barthes : l'intertextualité, la source et l'influence 43 III . Métasémiotique de l'intertextualité déconstructionniste : Demda 43 1 . Déconstruction et traces 46 2 . La sémiotique et l'intertextualité demdienne 54 3 . L'intertextualité, la greffe et le polémico-mimétique 57 4 . Discussion critique 65 IV . Riffaterre et les figures imposées de I'intertextualité 65 1 . Le devoir-signifier et le faire interprétatif 67 2 . La relation fiduciaire et l'intersubjectivité 72 DE LA DIEFICULTE D'UN BALISAGE THEORIQUE DE L'INTERTEXTUALITE 72 1 . Les conditions de recevabilité en sémiotique 72 1 . "Transformer la Iimite en seuil" 75 2 . Pluralité des interprétations 76 3 . Les codes 77 4 . L'ostension 8 0 CECI N'EST PAS UNE SOURCE 1 . La recatégorisation idéologique 1 . La dénégation 2 . La nouvelle normativité II . Les modalités de l'influence et de l'intertextualité 1 . Le sujet syncrétique 2 . Les transformations 3 . L'hétéroclite et l'impur 4 . L' influence et I'activi té sémantique "incommensurable" 5 . Conclusions partielles 6 . L'originalité 7 . Les tensions de l'antériorité 8 . Conclusions partielles CHAPITRE II 1 16 L A CONVENTION CLASSIQUE 1 1 6 1 . Le faire prescriptif de la première heure 1 1 6 1 . La convention classique et le niveau de pertinence 1 18 2 . Aristote commenté et revisité 121 I I . D'Aubignac, le spectacle et les modalités déontiques 121 1 . Le spectacle, l'illusion et le vraisemblable 126 2 . Les modalités déontiques 131 3 . L'identité modale 134 III . Corneille face aux modalités véndictoires 134 1 . Le contrat axiologique du vraisemblable 139 2 . La recatégorisation de la convention 143 N . Molière : l'idiolecte et le thymique avant tout 143 1 . Une stratégie de l'esquive 145 2 . le jugement éthique et l'investissement pathémique 148 3 . La pratique théâtrale et la notion de "plaisir" 150 4 . Le rationdisme et le sentir-croire 153 5 . Présence obsédante de Molière au XVIIIe siècle 156 V . Les Anciens et les Modernes 156 1 . La double conjonction 158 2 . La trajectoire existentielle 16 1 3 . Le faire persuasif 165 4 . Les modalités épistémiques 168 5 . L'imitation 175 6 . Axiologie du faire i m i t a t i f au X W e siècle 183 7 . Les tensions de l'imitation et de l'intertexhdité: Beaumarchais/Diderot, entrée en matière CHAPITRE III 290 IN'IXRTEXTUALITE DU DRAME 190 I . Positions intertextuelles et préliminaires méthodologiques 190 1 . La bourgeoisie en quête d'une figuration 194 2 . Texte centreur et intertexte 199 3 . Le champ intertextuel 20 1 II . Intertextualité Diderot/Beaumarchais : désignation intertextuelle indexée 201 1 . Les configurations passionnelles 2 1 1 2 . Délimitation d'un genre 2 12 3 . Règles 2 14 4 . Conformité des caractères et des situations 2 14 5 . Pantomime, gestuelle, didascalies 2 16 6 . Espace scénique 216 7 . Options drarnaturgiques: incidents, intrigue, action, tableaux, coups de théâtre, apartés 218 8 . Valet 219 9 . Décor 219 10. Costume III . Intertextualité de Beaumarchais: le texte centreur Eugénie 1 . Les configurations passionnelles . Les rôles pathémiques . Les jalons protensifs . La répression pathémique . Eugénie sujet opérateur . Conlusions partielles et implications théoriques . Le désespoir . La moralisation . Conclusions relatives à la moralisation . Le faire réceptif et le faire émissif 2 . Délimitation d'un genre 3 . Règles 4 . Conformité des caractères et des situations 5 . Pantomime, gestuelle, didascalies . L'urgence conjonctive . Le manque . Le faire perceptif et le sentir 6 . Espace scénique 7 . Options drarnaturgiques : incidents, intrigue, tableaux, coups de théâtre, apartés 8 . Vdet 9 . Décor 10 . Costume IN . Intertextualité de Beaumarchais: évaluation 1 . Le leadership du sens 2 . Tensivité collectrice et tensivité argumentative 3 . Les champs intertextuels et la tension collectrice 1) Les configurations passionnelles . L'excès . Le faire émissif . Le faire-attendrir . La moralisation 2) Délimitation d'un genre 3) Règles 4) Conformité des caractères et des situations 5) Pantomime, gestuelle, didascalies 6) Espace scénique 7) Options dramaturgiques: incidents, intrigue, tableaux, coups de théâtre, apartés 8) Valet 9) Décor 10) Costume 4 . La tensivité argumentative 4 1 1 CONCLUSION 424 BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTION Repenser 1 ' intertextualité par rapport à l'épistémologie sémiotique, tel est notre projet dans ce travail. La recherche sur l'intertextualité menée tambour battant par la critique des années soixante dix, à laquelle nous consacrerons la première partie de cette étude, a laissé beaucoup de questions en suspens. Si la critique littéraire doit faire sienne, en principe, l'étude des tensions entre textes, elle s'arrange le plus souvent pour fixer des critères définitoires davantage redevables uploads/Litterature/ intertexte-beaumarchais.pdf
Documents similaires






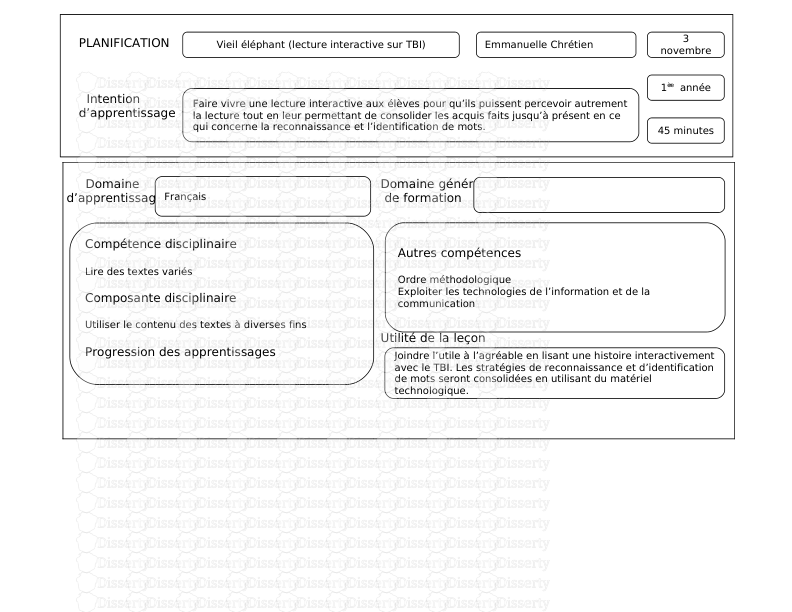



-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 12, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 21.6801MB


