Anales de Filología Francesa, n.º 25, 2017 Ángeles Sirvent Ramos 207 L’Afrique
Anales de Filología Francesa, n.º 25, 2017 Ángeles Sirvent Ramos 207 L’Afrique noire en voix de femme: Le féminisme précurseur d’Aoua Kéita et Mariama Bâ Black African Women’s Writing: Pioneering Feminism in Aoua Keita’s and Mariama Bâ’s novels Ángeles Sirvent Ramos Universidad de Alicante ma.sirvent@ua.es Resumen Muchas escritoras del África subsahariana han dejado constancia en sus escritos de una doble exclusión, al pertenecer a un país del denominado tercer mundo, y por el solo hecho de ser mujer. El espacio autobiográfico de Aoua Keita nos desvela la toma de conciencia política y las dificultades del compromiso, así como la problemática social y sexual de las mujeres de su generación. En la escritura de Mariama Bâ –de la que resaltaremos determinados aspectos textuales–, así como en su militantismo asociativo, se ponen de relieve su compromiso feminista, la condición de las mujeres musulmanas en los países africanos, el sufrimiento mudo de tantas mujeres sometidas a una fuerte tradición patriarcal. Asistimos, en definitiva, al enfrentamiento entre tradición y modernidad en el que se debaten en el desafío hacia su libertad. Dos pioneras que cuestionaron el orden establecido y que debemos recordar. Dos precursoras de la promoción de las mujeres africanas y de la adquisición de sus derechos, a través de su acción y de su escritura. Abstract Many female writers from sub-Saharan Africa have experienced a two-fold exclusion in their writing, due to the fact that they belong to a third-world country and for simply being women. The autobiographical space of Aoua Keita’s writing reveals her political awareness as well as a conscious manifestation of the difficulties of actively writing about the social problems and sexuality of women of her generation. In Mariama Bâ’s writing –where certain textual aspects will be highlighted–, as well as her associative militancy, what stands out is her commitment to feminism, the position of Muslim women in African countries and the silent suffering of so many women subjected to a strong patriarchal tradition. This reads as a reflection of the debate between tradition and modernity in women’s quest for freedom. Both writers can be considered as two female pioneers who raised the benchmark and are precursors of promoting African Women in their struggle towards achieving their rights. Anales de Filología Francesa, n.º 25, 2017 L’afrique noire en voix de femme: le féminisme précurseur d’Aoua… 208 Key-words Aoua Keita, Mariama Bâ, feminism, Black Africa, Muslim women Palabras clave Aoua Kéita, Mariama Bâ, féminisme, Afrique noire, femmes musulmanes. Mon cœur est en fête chaque fois qu’une femme émerge de l’ombre Mariama Bâ, Une si longue lettre, 129. Il faudra attendre les années soixante-dix1 pour voir s’étaler dans le panorama littéraire de l’Afrique sub-saharienne une écriture de femme, de femme en tant que sujet de l’écriture; une écriture, en plus, qui relève de la préoccupation sur la condition de la femme africaine, de la femme en soi et de l’affirmation en tant que femme. La prise de parole des écrivaines se fait enfin visible en proie à leur émancipation, la formation et l’indépendance économique étant une prémisse incontournable pour de nouveaux horizons. Comme toujours, il y a un livre pionnier essentiel dans ce processus: Il s’agit dans ce cas-ci de Femme d’Afrique (1975) d’Aoua Kéita (née à Bamako. Soudan français, l’actuel Mali), sous-titré La vie d’Aoua Kéita racontée par elle-même. Femme d’Afrique devient ainsi non pas seulement le premier ouvrage de la littérature malinienne publié par une femme mais aussi la première vaste autobiographie, avec De Tilène au Plateau. Une enfance dakaroise, de 1 Conséquence de la différente instruction reçue par les filles. Précédemment on pourrait citer tout de même deux textes du Cameroun: Ngonda, un court récit autobiographique de Marie-Claire Matip, en 1956, et Rencontres essentielles, le roman de Thérèse Kuoh-Moukoury, en 1969 (Herzberger, 2000: 407), sans oublier des écrits publiés par des normaliennes, tel un petit article anonyme mais attribué à une élève togolaise, Frida Lawson (Barthélemy, 2009: 838): “Je suis une Africaine… J’ai vingt ans”, publié le 12 mars 1942 dans la presse coloniale Dakar-Jeunesse (Herzberger, 2000: 37) qui deviendrait ainsi, pour l’instant, la première écrivaine des lettres africaines et l’auteure du premier –encore que petit– récit autobiographique. Citer, encore, la nouvelle d’Annette Mbaye d’Erneville –journaliste et écrivaine dont nous parlerons plus tard– La bague de cuivre et d’argent, publiée en 1961 dans le magazine Jeune Afrique, avant sa publication en 1983 dans les Nouvelles Éditions Africaines. Mariama Bâ, elle aussi, publiera en 1947 “Ma petite patrie” dans Notes Africaines, revue trimestrielle de l’IFAN (Institut français d’Afrique noire), dont nous nous attarderons aussi plus tard. Herzberger-Fofana avait déjà fait remarquer dans son essai –remaniement de sa thèse en 1993– à quel point l’École Normale des filles encourageait la création littéraire (2000: 35ss). Alain Mabanckou met en valeur cet essai, qu’il considère “la Bible de la littérature féminine francophone”, et rend hommage, tel que Jacqueline Nafissatou nous l’apprend, “au sérieux apporté à cette nouvelle contribution scientifique qui enrichit la recherche en genre” (Nafissatou, 2000: 7). Au moment où Herzberger-Fofana publie son essai, les livres d’Ormerod et Volet (1994) et celui de Cazenave (1996) sont déjà sortis. Nous voulons souligner de même l’article pertinent et précurseur de Mohamadou Kane “Le féminisme français dans le roman africain de langue française” (1980), qui, même s’il ne fait pas allusion à des écrivaines –son étude s’arrête très tôt, en 1978– pose la présence de traits féministes à travers les personnages de certains romanciers antérieurs à cette année-là. L’essai publié par Madeleine Borgomano en 1989: Voix et visages de femme dans les livres écrits par des femmes en Afrique francophone, est toujours aussi intéressant. Elle y fixe déjà sa typologie de personnages féminins chez les écrivaines femmes. Anales de Filología Francesa, n.º 25, 2017 Ángeles Sirvent Ramos 209 la sénégalaise Nafissatou Diallo, parue la même année, d’une femme africaine d’expression française. Tandis qu’aucune trace féministe ne se trouve dans l’œuvre de Nafissatou Diallo, qui invite le lecteur à l’univers magique de son enfance, ce qui est vraiment intéressant chez Kéita, c’est que, étant donné que cet ouvrage constitue un point de départ de la création féminine et un premier témoignage autobiographique, elle ne nous présente pas, tel qu’on pourrait s’y attendre, comme Ormerod et Volet le signalent, la vie d’une femme enfermée dans un univers domestique, limitée par de fortes traditions ancestrales, mais le témoignage déjà d’une forte personnalité, d’une grande détermination –“j’avais confiance, écrira-t-elle dans Femme d’Afrique, en moi-même et dans l’avenir” (Kéita, 1975: 27)–, d’une femme engagée, déjà à cette époque-là, syndicalement et politiquement (Ormerod & Volet, 1996: 426-72). Aoua Kéita accordera dans son œuvre une place privilégiée à son “action militante”, aux aspects politiques par rapport aux aspects personnels; “l’autobiographie au sens strict faisant place à des ‘mémoires’ sur sa vie de femme politique et les résistances qu’elle encourait comme telle3” (Cazenave, 1996: 28 note 10). Il est vrai, comme Madeleine Borgomano le remarque, le silence que Kéita réserve à sa vie sentimentale et intime. Pourtant les allusions à la polygamie, qu’elle-même a subies, sont présentes dans le livre, encore qu’elle ne s’y attarde pas. Diawara, son mari, médecin possédant une instruction, et non favorable à la polygamie, refusera tout d’abord de prendre une deuxième épouse malgré l’insistance de sa famille en apprenant qu’Aoua ne pouvait pas avoir d’enfants. La puissance de la belle-mère se manifeste, et après la lettre qu’elle écrit à son fils: “Je sais que tu tiens à Aoua. Mais si jamais ma mort te trouve dans l’union avec Aoua, tu seras malheureux pour le reste de ta vie. Je te maudirai même dans la tombe” (Kéita, 1975: 77), il cèdera vite, “tellement il adorait sa mère et craignait ses malédictions […]. N’ayant jamais perdu la tête devant une situation quelle qu’elle soit, j’ai continué mon travail” (Kéita, 1975: 77). L’œuvre est composée de huit chapitres de longueur inégale, portant sur l’éducation soudanaise traditionnelle; sur sa formation à l’École de Médecine de Dakar et son travail à la maternité de Gao; sur son baptême politique auprès du RDA (Rassemblement Démocratique Africain4); sur son retour à Gao et la lutte anticolonialiste du RDA dans cet espace géographique; sur sa mutation disciplinaire au Sénégal; sur ses activités professionnelles, syndicales et politiques à Nara; sur l’organisation et les actions du RDA après le frère Mamadou Konaté, et sur l’apprentissage de l’indépendance. 2 Ces auteurs citeront de même deux autres “autobiographies politiques” postérieures, celles d’Andrée Blouin et de Léonie Abo. 3 Elle suit, en ce sens, Madeleine Borgomano dans Voix et Visages de femmes (1989). Ce ne sera pourtant pas Kéita que Cazenave étudiera dans son essai –étant donné que celui-ci se consacre uniquement aux romans–, mais Mariama Bâ; concrètement son deuxième roman: Un chant écarlate (1981), dont nous ne nous occuperons pas dans cet article, nous concentrant uniquement sur son roman précurseur Une si longue lettre (1979). 4 Ayant des ramifications dans les différentes colonies françaises de l’Afrique. Anales de Filología Francesa, n.º 25, 2017 L’afrique noire en voix de femme: le féminisme précurseur d’Aoua… 210 Quant aux aspects personnels, il uploads/Litterature/ l-x27-afrique-noire-en-voix-de-femme.pdf
Documents similaires






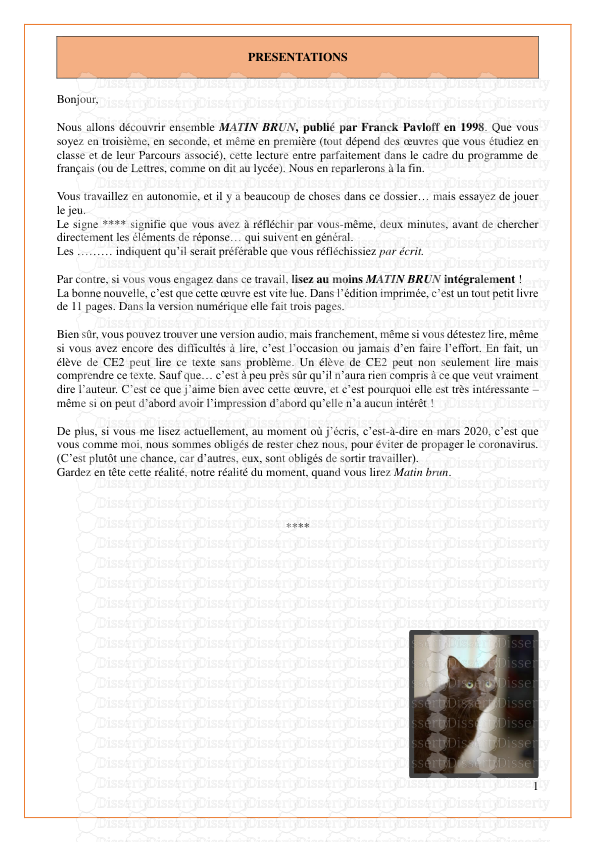



-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 18, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3851MB


