Bruno Paul Bruno Paul La Signature du La Signature du Qaternaire Qaternaire Log
Bruno Paul Bruno Paul La Signature du La Signature du Qaternaire Qaternaire Logique, sémantique et Tradition Logique, sémantique et Tradition Essai Essai ÉDITIONS CONSCIENCE SOCIALE ÉDITIONS CONSCIENCE SOCIALE Bruno Paul La signature du quaternaire ÉDITIONS CONSCIENCE SOCIALE 2018 Textes copyright Dr. Bruno Paul. Le contenu de ce livre est sous licence : Creative Commons BY-SA 4.0 International (paternité – partage à l’identique des conditions initiales) I mage de la première page extraite de Voyages par Jean de Mandeville ; enlumineur : Maître de Boucicaut ; Paris, vers 1410. Parchemin, Manuscript Fr. 2810 f.222 © BnF. « Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. » (Livre de la Genèse, 2:10) « Qui se trouvera assez sot pour penser que, comme un homme qui est agriculteur, Dieu a planté un jardin en Éden du côté de l’Orient et a fait dans ce jardin un arbre de vie visible et sensible, de sorte que celui qui a goûté de son fruit avec des dents corporelles reçoive la vie ? Et de même que quelqu’un participe au bien et au mal pour avoir mâché le fruit pris à cet arbre ? Si Dieu est représenté se promenant le soir dans le jardin et Adam se cachant sous l’arbre, on ne peut douter que tout cela, exprimé dans une histoire qui semble s’être passée, mais ne s’est pas passée corporellement, indique de façon figurée certains mystères. » (Origène, Traité des principes, IV, 3, 1 ; ce livre fut terminé en l’an 231) Dr. Bruno Paul La signature du quaternaire Logique, sémantique et Tradition PREMIÈRE ÉDITION version numérique Ce livre est publié au Canada et est soumis aux lois canadiennes en ce qui concerne les droits d’auteur. À cet effet, d’après la loi sur le droit d’auteur L.R. (1985), ch. C-42, art. 6 et 1993, ch. 44, art. 58, « le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. » L’œuvre de René Guénon est ainsi dans le domaine public au Canada depuis l’année 2002. Publié par les Éditions Conscience Sociale conscience-sociale.blogspot.ca Édité par Bruno Paul Cet ouvrage a été rédigé et édité à l’aide du logiciel Libre Office. L’intégrité du présent fichier peut être vérifiée en comparant son empreinte SHA - 256 avec celle publiée sur le site de l’auteur. ISBN : 978-2-9564760-0-9 format PDF. À toutes celles et ceux qui L’ont toujours recueilli, à toutes celles et ceux qui toujours Le recueilleront. Au Cheikh Abd al-Wâhid Yahyâ René Guénon. « Quand chacun tient le beau pour beau vient la laideur Quand chacun tient le bon pour bon viennent les maux Étant et n’étant pas s’engendrent Aisé et malaisé se parfont Long et court renvoient l’un à l’autre Haut et bas se penchent l’un vers l’autre Voix et son consonnent ensemble Devant et derrière se suivent. » (Tao-Te-King, 2) Première partie : De la métaphysique à la logique * Aristote a dit : « l’être est tout ce qu’il connaît », de telle sorte que, là où il y a connaissance réelle – non son apparence ou son ombre – la connaissance et l’être sont une seule et même chose. (René Guénon, Mélanges, Chap. VI « Connais-toi toi- même », 1976, Pp. 56 ; première publication en arabe dans la revue El-Ma’rifah, n° 1, mai 1931) [*] partie I publiée en version initiale sur conscience-sociale.org le 14/11/2017 Introduction oute la connaissance moderne est fondée sur la logique. À quelques rares exceptions près – appareillage technique utilisant la logique floue ou des états de la physique quantique – l’ensemble des sciences naturelles et humaines, y compris la philosophie occidentale depuis au moins Platon, repose sur la logique classique, bivalente, établissant la véracité ou la fausseté d’une proposition. T La logique classique présente pourtant des limites connues depuis son origine. On range négligemment ces situations, pourtant exprimables en quelques phrases simples, parmi les paradoxes. Les conséquences du refus de traiter ces situations paradoxales sont des plus critiques, puisque cette lacune nous oblige à plaquer des œillères sur notre compréhension du monde et de soi. Plus personne ne pouvant ignorer que le monde moderne traverse une crise ultime, toute contribution visant à élargir le cadre des possibles est la bienvenue et même pourrions-nous dire, est nécessaire. C’est l’objectif de cet ouvrage. Nous commencerons cette première partie par un bref historique de la logique, en remontant avant l’apparition de la logique classique, où nous verrons au passage que la logique naît de la métaphysique. Ce qui nous conduira à un dialogue interposé entre Héraclite, Aristote, Granger et Guénon. Nous proposerons ensuite la première description complète de la logique tétravalente booléenne avec ses tables de vérité et ses syllogismes, après en avoir expliqué la nécessité. Nous terminerons par l’application du cadre de cette logique à la sémantique de quelques attributs du manifesté et du non manifesté, où nous retrouverons à chaque fois les conceptions de la Tradition. 2 Tout commence par une négation i l’on prend une proposition P et sa négation logique notée non(P), on peut se placer dans l’un des trois cas suivants : S • cas 1 : P est vraie ou bien non(P) est vraie, exclusivement ; • cas 2 : P et non(P) sont toutes deux vraies, simultanément ; • cas 3 : ni P ni non(P) ne sont vraies, simultanément. Héraclite d’Ephèse (~541 – ~480 av. J.-C.), descendant du roi d’Athènes et issu d’une famille sacerdotale, proclamait l’unité et l’indissociabilité des contraires, c’est-à-dire la prise en compte du cas numéro 2, comme en témoigne ses Fragments : « Toutes choses naissent selon l’opposition… Le changement est une route montante-descendante et l’ordonnance du monde se produit selon cette route… » « Toutes choses sont mutuellement contraires. » « Le dieu est jour-nuit, hiver-été, guerre-paix, satiété-faim. Il se change comme quand on y mêle des parfums ; alors on le nomme suivant leur odeur. » « Ce qui est taillé en sens contraire s’assemble ; de ce qui diffère naît la plus belle harmonie ; tout devient par discorde. » « C’est la maladie qui rend agréable et bonne la santé, la faim la satiété, la fatigue le repos. » « Ce qui est contraire est utile ; ce qui lutte forme la plus belle harmonie ; tout se fait par discorde. » « Joignez ce qui est complet et ce qui ne l’est pas, ce qui concorde et ce qui discorde, ce qui est en harmonie et en désaccord ; de toutes choses une et d’une, toutes choses. » « Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s’accorder. L’harmonie du monde est par tensions opposées, comme pour la lyre et pour l’arc. » « Il y a une harmonie dérobée, meilleure que l’apparente et où le dieu a mêlé et profondément caché les différences et les diversités. » « Même chose ce qui vit et ce qui est mort, ce qui est éveillé et ce qui dort, ce qui est jeune et ce qui est vieux ; car le changement de l’un donne l’autre, et réciproquement. » Le principe de non-contradiction rejette cependant le cas 2 : il prétend que l’on ne peut pas penser P et non(P) vraies à la fois. 3 Le principe de non-contradiction est un axiome, c’est-à-dire qu’il est pris comme une vérité première qui contribue à démontrer les autres théorèmes, mais lui-même ne peut être déduit, démontré. Cet axiome est une invention relativement récente. Il a été popularisé par Platon (428 – 348 av. J.-C.) dans La République (IV, 436 b) et surtout par Aristote (~384 – ~322 av. J.-C.) : « Il est impossible qu’un même attribut appartienne et n’appartienne pas en même temps et sous le même rapport à une même chose » (Métaphysique, livre Gamma, chap. 3, 1 005 b 19-20). Le tiers exclu a été introduit par Aristote comme conséquence du principe de non-contradiction. Le tiers exclu (souvent qualifié à tort de principe) soutient que soit une proposition est vraie, soit sa négation est vraie. Selon Aristote, on ne peut pas penser le troisième cas hypothétique qui est donc rejeté.1 Il est essentiel de remarquer que depuis la plus haute antiquité la connaissance du vrai et du faux est une expérience de pensée. La construction de la logique découle de la connaissance de l’être, c’est- à-dire de la métaphysique.2 La conjonction du principe de non-contradiction et du principe du tiers exclu ont participé à fonder la logique mathématique formelle dite classique. 1 En logique binaire classique, le théorème du tiers exclu se déduit du principe de non-contradiction en introduisant la relation d’égalité ou d’équivalence, l’opérateur de négation booléen, et en acceptant les axiomes supplémentaires : • principe d’identité : P = P • élimination de la double négation : non(non(P)) = P puis en établissant les valeurs des tables de vérité des opérateurs « non », « et », « ou » et en démontrant ensuite l’égalité non(A et uploads/Litterature/ la-signatuer-quaternaire.pdf
Documents similaires







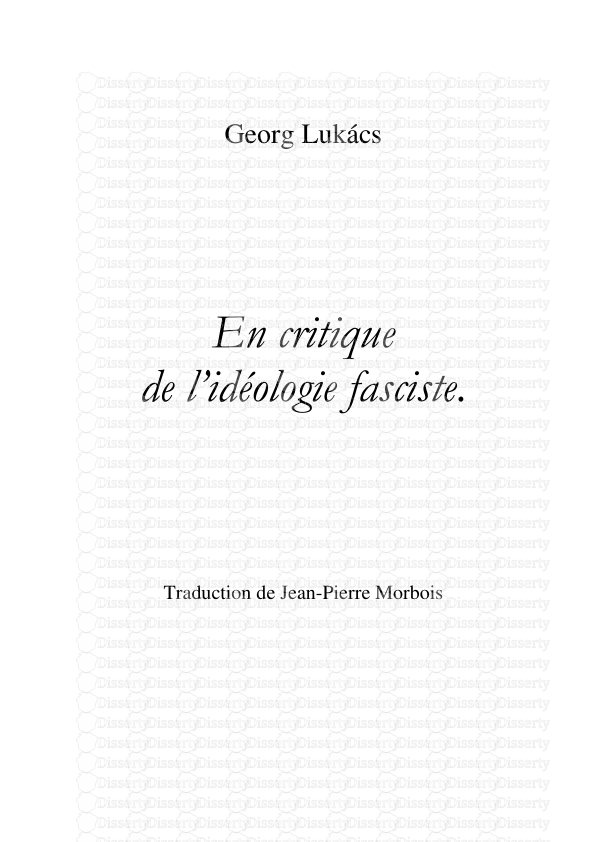


-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 18, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 4.8840MB


