LA LECTURE ANALYTIQUE – METHODOLOGIE © Tous droits réservés 1 7 – 99 – 10604 L
LA LECTURE ANALYTIQUE – METHODOLOGIE © Tous droits réservés 1 7 – 99 – 10604 L L LA A A L L LE E EC C CT T TU U UR R RE E E A A AN N NA A AL L LY Y YT T TI I IQ Q QU U UE E E M M ME E ET T TH H HO O OD D DO O OL L LO O OG G GI I IE E E La lecture analytique a pour but de mettre en évidence l’originalité et la singularité d’un texte littéraire : • dans son sujet (situation, personnages, idées…) ; • dans les intentions, les objectifs, les buts de l’auteur ; • dans les moyens que l’auteur a utilisés pour atteindre son/ses but/s : genre littéraire, procédés de style, registres… Le principe de la lecture analytique est d’expliquer et de commenter un texte littéraire en regroupant les remarques autour de centres d’intérêt qui donnent son originalité au texte : • La lecture analytique repose sur deux ou trois idées directrices à développer et à argumenter, à illustrer d’exemples comme des thèses successives qui éclairent le texte. • Toute lecture qui ne propose pas d’idées directrices est à proscrire. Attention : une idée directrice n’est pas un thème, mais une thèse, un jugement porté sur ce qui caractérise le texte et fait son intérêt. PROCEDER AVEC METHODE (PLAN) Etape 1 : Travail de recherche des idées directrices. • Méthode A : du relevé-repérage à la synthèse. • Méthode B : des impressions de lecture à leur vérification dans le texte. Etape 2 : Construction et mise en œuvre de la lecture analytique. TEXTE D’ETUDE : ROUSSEAU, LES CONFESSIONS En 1867, Jean-Jacques Rousseau, âgé de plus de cinquante ans, commence à écrire son autobiographie, les Confessions, pour se défendre de ses détracteurs et pour revivre des temps heureux, jalonnant son œuvre des aveux de ses fautes depuis son enfance. Un souvenir, qui me fait frémir encore et rire tout à la fois, est celui d’une chasse aux pommes qui me coûta cher. Ces pommes étaient au fond d’une dépense (pièce où l’on range les provisions) qui, par une jalousie (fenêtre grillagée) élevée, recevait du jour de la cuisine. Un jour que j’étais seul dans la maison, je montai sur la maie (huche à pain) pour regarder dans le jardin des Hespérides (allusion mythologique = arbre aux pommes d’or) ce précieux fruit dont je ne pouvais approcher. J’allai chercher la broche pour voir si elle y pourrait atteindre : elle était trop courte. Je l’allongeai par une autre petite broche qui servait pour le menu gibier ; car mon maître (artisan chez qui le jeune Rousseau était en apprentissage) aimait la chasse. Je piquai plusieurs fois sans succès ; enfin je sentis avec transport que j’amenais une pomme. Je tirai très doucement : déjà la pomme touchait à la jalousie ; j’étais prêt à la saisir. Qui dira ma douleur ? La pomme était trop grosse, elle ne put passer par le trou. Que d’inventions ne mis-je point en usage pour la tirer ! Il fallut trouver des supports pour tenir la broche en état, un couteau assez long LA LECTURE ANALYTIQUE – METHODOLOGIE © Tous droits réservés 2 7 – 99 – 10604 pour fendre la pomme, une latte pour la soutenir. A force d’adresse et de temps je parvins à la partager, espérant tirer ensuite les pièces l’une après l’autre ; mais à peine furent-elles séparées, qu’elles tombèrent toutes deux dans la dépense. Lecteur pitoyable (accessible à la pitié), partagez mon affliction. Je ne perdis point courage ; mais j’avais perdu beaucoup de temps. Je craignais d’être surpris ; je renvoie au lendemain une tentative plus heureuse, et je me remets à l’ouvrage tout aussi tranquillement que si je n’avais rien fait, sans songer aux deux témoins indiscrets (les deux moitiés de la pomme tombées dans la dépense) qui déposaient contre moi dans la dépense. Le lendemain, retrouvant l’occasion belle, je tente un nouvel essai. Je monte sur mes tréteaux, j’allonge la broche, je l’ajuste ; j’étais prêt à piquer… Malheureusement, le dragon ne dormait pas ; tout à coup, la porte de la dépense s’ouvre : mon maître en sort, croise les bras, me regarde et me dit : « Courage ! »… La plume me tombe des mains. Jean-Jacques Rousseau Les Confessions, I (1767, publication posthume en 1781) ETAPE 1 : TRAVAIL DE RECHERCHE DES IDEES DIRECTRICES Méthode A : du relevé-repérage à la synthèse Mots et expressions du texte Commentaires (observation et interprétation). Un souvenir qui me fait frémir encore et rire tout à la fois Temps du verbe : le présent de l’autobiographe. Regard contrasté de l’autobiographie. Chasse aux pommes Situation d’aventure, rappel mythologique. Objet de la quête du héros. Me coûta cher Temps du verbe : passé simple, retour dans le passé (narration). Enjeu de l’anecdote sur la vie de Rousseau. Ces pommes étaient Temps du verbe : imparfait, retour dans le passé (description). Situation initiale. Au fond d’une dépense qui, par une jalousie élevée, recevait du jour de la cuisine Précision spatiale et cadre de l’aventure. Un jour que j’étais seul Caractère exceptionnel de l’aventure. Caractère dramatique : solitude du héros face à l’épreuve, risque. Jardin des Hespérides Rappel et image mythologique (situation épique). Précieux fruit Périphrase ; valeur symbolique de la pomme. Epithète homérique. La broche Arme du héros, un peu ridicule parce que peu noble (humour). Trop courte Péripétie, premier obstacle à la quête. Je montai sur la maie… J’allai… Je l’allongeai… Je piquai…. Je tirai… Juxtaposition de phrases, amplification épique et accélération (rythme vif). Verbes de mouvement : « exploits » du héros, suspense. Je l’allongeai par une autre petite broche Ingéniosité du héros. Mimétisme de l’écriture (la phrase s’allonge, comme la broche). Avec transport Exagération, hyperbole. Déjà la pomme touchait à la jalousie ; j’étais prêt à la saisir Suspense dans le récit. LA LECTURE ANALYTIQUE – METHODOLOGIE © Tous droits réservés 3 7 – 99 – 10604 Qui dira ma douleur ? Modalité de phrase : interrogation rhétorique au lecteur. Exagération, hyperbole, registre de langue soutenu. Registre dramatique et épique. Elle ne peut passer par le trou Deuxième échec du héros, variation dans le rythme du récit. Que d’inventions ne mis-je point en usage pour la tirer ! Modalité de phrase : exclamation hyperbolique, registre soutenu et emphatique. Juxtaposition : rythme vif du récit. Supports pour tenir la broche Ingéniosité du héros. Un couteau assez long pour fendre la pomme, une latte pour la soutenir Ingéniosité du héros. Armes du héros, un peu ridicules (humour). A force d’adresse et de temps Ralentissement du récit, suspense. Qualités du héros. Mais à peine furent-elles séparées, qu’elles tombèrent Troisième échec. Lecteur pitoyable, partagez mon affliction Modalité de phrase : apostrophe rhétorique au lecteur. Exagération, hyperbole, niveau de langue soutenu. Registre pseudo-tragique et épique. Humour et autodérision, mais aussi gravité. Je craignais d’être surpris Suspense accru. Point de vue interne. etc. Ce qu’il convient de faire ensuite : 1. Dans la colonne de droite, surlignez d’une couleur identique les commentaires qui se recoupent. 2. Quelle idée directrice de lecture analytique chacune des couleurs vous suggère-t-elle ? 3. Construisez, à partir des idées directrices que vous aurez trouvées, la lecture analytique du texte. Méthode B : des impressions de lecture à leur vérification dans le texte a) « Définition » du texte Genre et type de texte : récit autobiographique. Thème : d’un vol de pommes par le narrateur quand il était enfant. Registres et qualifications : vivant et dramatisé, riche en suspense. A la fois amusant et grave. Parodique de l’épopée. Buts de l’auteur : pour revivre un moment crucial de l’enfance. b) Problématiques extraites de la « définition » du texte Qu’est-ce qui donne sa vivacité au récit ? Comment Rousseau dramatise-t-il cette anecdote ? (A surligner en bleu) D’où vient l’humour ? En quoi Rousseau enfant apparaît-il comme un héros parodique d’épopée ? (A surligner en jaune) Quel regard contrasté l’autobiographe adulte porte-t-il sur son « crime » d’enfant ? (A surligner en vert) LA LECTURE ANALYTIQUE – METHODOLOGIE © Tous droits réservés 4 7 – 99 – 10604 c) Ce qu’il convient de faire ensuite : 1. Passer de la « définition » du texte aux problématiques qui serviront d’idées directrices. 2. En respectant les couleurs affectées à chaque problématique, balisez dans le texte les indices sur lesquels vous appuierez votre analyse et vérifierez la pertinence des idées directrices. ETAPE 2 : CONSTRUCTION ET MISE EN ŒUVRE DE LA LECTURE ANALYTIQUE Introduction (genre de l’œuvre, contexte, type de texte, thèmes…). Lecture du texte (à voix haute et expressive). Annonce des idées directrices. Développement de la lecture analytique (exemple de plan) : I. Une anecdote vivante et bien menée, l’art de la dramatisation • Structure et rythme du récit. • L’emploi des temps, du passé au présent. • La modalité des phrases. • Théâtralisation et interventions orales. II. Un récit héroï-comique : une parodie d’épopée uploads/Litterature/ lecture-analytique.pdf
Documents similaires
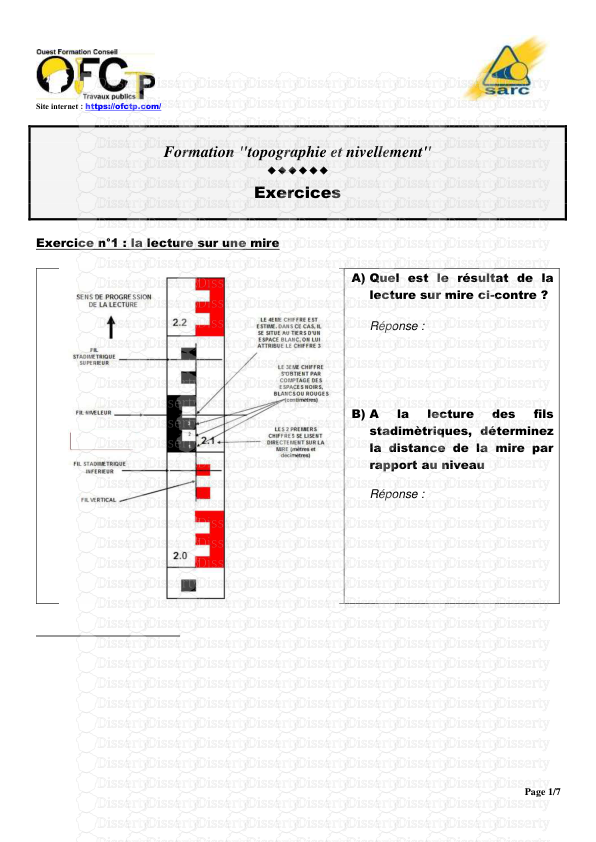









-
84
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 02, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0462MB


