Le lecteur-Sherlock Holmes et le sens caché du texte réaliste et naturaliste :
Le lecteur-Sherlock Holmes et le sens caché du texte réaliste et naturaliste : notes pour une herméneutique de la trace dans l’œuvre de Flaubert, Maupassant, Zola Maria Gugliotta L’article reprend les théories de C. Ginzburg sur le « paradigme indiciaire1 », modèle épistémologique qui s’est imposé à la fin du XIXe siècle, selon une perspective qui lui est propre : le but est une analyse de nature indicielle des connexions entre ses théories et la littérature . On privilégie une dimension synchronique à travers une lecture des courants littéraires qui caractérisent cette époque, Le Réalisme et le Naturalisme, en prenant en considération les œuvres et les données théoriques de Flaubert, Maupassant, Zola. L’œuvre réaliste et naturaliste apparait inséparable de cette épistémè et des pratiques scientifiques et culturelles ayant produit, pendant ce siècle, le paradigme indiciaire. Le texte réaliste montre, fait voir, suggère mais ne dit pas expressément. Faire voir est de l’ordre de l’ indiciaire: au lecteur de découvrir la vérité cachée. L’acte de lecture devient acte herméneutique ayant des implications éthiques. Le lecteur - Sherlock Holmes doit découvrir le sens que le texte recèle. Les théories de Ginzburg sur « le paradigme indiciaire » ; l’ origine de la littérature : une théorie entre histoire et légende. Dans son article C. Ginzburg montre qu’au XIXe siècle, précisément dans les années 1870- 1880, des disciplines apparemment différentes entre elles comme la critique d’art, la psychanalyse, le roman policier présentent la même approche herméneutique : une lecture des phénomènes fondée sur le détail . 1Carlo Ginzburg, «Traces. Racines d’ un paradigme indiciaire», Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989, pp. 139-180. Les travaux de l’historien d’art italien G. Morelli, publiés initialement sous le pseudonyme, qui est presque un anagramme, de Lermoieff dans les années 1870, proposent de corriger les erreurs d’attribution grâce à l’analyse de détails caractéristiques mais à première vue insignifiants - lobes d’oreilles ou doitgs, ongles – et d’une manière et d’une technique propres alors à déterminer avec précision l’identité du peintre. Ginzburg théorise l’influence des travaux de Morelli sur Freud, influence confirmée plus tard par ce dernier dans Le Moïse de Michel Ange, ouvrage dans lequel il affirme : « Je crois que la méthode de Morelli a beaucoup d’affinité avec la psychanalyse. Celle-ci est également habituée à deviner les choses secrètes et cachées par des éléments méprisés ou peu considérés par les écarts ou les refus de l’ observation2 ». Morelli apprend à Freud l’importance du détail infime, insignifiant et le principe que l’identité profonde se manifeste surtout dans les actes accomplis spontanément, mécaniquement, et surtout, inconsciemment. Le détail, s’il devient le fondement d’ une lecture sémiologique de l’œuvre, se constitue également en marqueur d’identité ou en signe révélateur de comportements Ce sont les mêmes principes qui régissent les enquêtes de Sherlock Holmes, le détective issu de la plume de Conan Doyle à partir de 1887. Sur la triade Morelli, Freud, Doyle le critique affirme : « Dans les trois cas des traces infinitésimales permettent de cueillir une réalité plus profonde autrement insaisissable. Traces : plus précisément symptômes (chez Freud), indices (chez Conan Doyle) et signes picturaux (chez Morelli)3 ». Traces est le mot-valise qui comprend les trois types de signes : symptôme, indice, signes picturaux. Ginzburg n’ opère aucune différenciation à cet égard. L’intrigue mystérieuse ou la représentation picturale sont caractérisées par un même paradigme emprunté à la sémiologie médicale. Ce n’ est pas un hasard si Morelli, Freud, et Doyle étaient tous 2Sigmund Freud, Le Moïse de Michel- Ange, 1914, p. 23. 3Carlo Ginzburg, op. cit., p. 147. trois médecins. Leurs recherches portent en tout cas sur l’identité : l’identité de l’auteur du tableau, du coupable, du patient. Vingt cinq ans après, dans un texte4 pour un volume collectif sur le paradigme indiciaire, Ginzburg reviendra sur son premier article en soulignant la fracture entre une première partie où le paradigme indiciaire est abordé, comme déjà explicité, selon une dimension synchronique, et une seconde partie dans laquelle une brusque variation nous introduit dans une dimension mythique. En effet sa thèse fait remonter le paradigme indiciaire à un savoir entre histoire et légende, grâce auquel le chasseur lit les traces de sa proie, transformant les signes en autant d’indices . Ce qui caractérise ce savoir [du chasseur], c’est la capacité de remonter, à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables, à une réalité complexe qui n’est pas directement expérimentable. On peu ajouter que ces faits sont toujours disposés par l’ observateur de manière à donner lieu à une séquence narrative, dont la formulation plus simple pourrait être "quelqu’un est passé par la". Peut-être l’idée même de narration (distincte de l’ enchantement, de la conjuration ou de l’invocation) est-elle née pour la première fois, dans une société de chasseurs, de l’expérience du déchiffrement d’ indices minimes5. Sa thèse met en œuvre une idée de l’origine de la littérature liée à l’énigme de la lettre, à la traduction du signe et à la production herméneutique de la solution. La logique du récit, l’ordre que projette la narration sur le réel permettent d’accéder à des réalités qui seraient autrement inaccessibles, et de les appréhender. L’étude attentive de la trace, de l’empreinte, du détail permettent de retrouver une histoire individuelle, de comprendre les propriétés distinctes d’un animal ou d’un être. C’est là que le genre romanesque s’inscrit. Les enquêteurs du réel La mimesis réaliste et naturaliste est avant tout observation, regard porté sur le réel. Paul Bourget parle de « l’ esthétique de l’observation6 » comme du principe fondamental de la production réaliste. 4Carlo Ginzburg, «Réflexions sur une hypothèse vingt-cinq ans après», L’ interprétation des indices, Presses Univ. Septentrion, 2007, pp. 37-48. 5Carlo Ginzburg, op. cit., p. 148-149. 6Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine , Paris, Plon-Nourrit, 1899, p.434. Regard pictural, capable de fixer, de cueillir formes, couleurs, lumières ombres ; regard endoscopique qui sait percer l’apparence pour découvrir l’âme, regard qui explore les signes de la maladie physique et surtout mentale : la folie , l’hystérie. Il est impossible de ne pas établir une connexion de nature épistémologique avec les autres sciences du déchiffrement, finalisées à rendre intelligibles ou identifiables des individualités, des processus et des systèmes. Il faut indubitablement parler d’osmose : les limites entre littérature et sciences humaines sont brouillés : la littérature devient le lieu privilégié d’élaboration de théories scientifiques : il suffit de penser au roman expérimental naturaliste, tandis qu’en psychanalyse on recourt à la narration, au récit comme formes privilégiées de développement des cas. En 1853 Flaubert écrit à Louise Colet : « La littérature prendra de plus en plus les allures de la science ; elle sera surtout exposante, ce qui ne veut pas dire didactique. Il faut faire des tableaux, montrer la nature telle qu’elle est, mais des tableaux complets, peindre les dessous et les dessus7 ». La science intéresse Flaubert pour sa valeur documentaire, sa rigueur intellectuelle, ainsi que ses méthodes d'observation et d'exposition. Elle ouvre des horizons inexplorés tout en permettant d'étudier de manière impartiale le monde environnant pour porter un regard détaché et lucide sur les êtres, les choses et les événements. La littérature doit se faire « exposante » et non « discutante », doit rivaliser avec la science, être donc rigoureuse dans la méthode, mais exempte de toute finalité didactique. Il est important de souligner les termes employés par Flaubert : « peindre », « tableau » relèvent de la peinture plutôt que de la littérature et renvoient, même indirectement, à Morelli . La littérature doit renoncer à expliquer, enseigner, dire. Elle doit peindre, montrer, mais pour montrer il faut savoir observer et bien observer, La réalité impressionne nos sens, qui, à leur tour, impressionnent notre esprit, explique Maupassant dans Le Roman, l’étude publiée avec le roman Pierre et Jean : « Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, 7Gustave Flaubert, Correspondance, édition présentée, établie et annotée par J. Bruneau, Paris, N.R.F., Bibliothèque de la Pléiade, V tomes , 1980, t.I, p. 234. Toutes les citations des lettres de Flaubert renvoient à cette édition. notre goût différents, créent autant de vérités qu'il y a d'hommes sur la terre. Et nos esprits qui reçoivent les instructions de ces organes, diversement impressionnés, comprennent, analysent et jugent comme si chacun de nous appartenait à une autre race8 ». Le mot « impressionné », utilisé par Maupassant9, renvoie au modèle photographique et à l’idée que la réalité est de quelque façon enregistrée, fixée par nos sens qui laissent une sorte d’empreinte, de trace d’ elle dans l’ intellect. Ce n’est pas un hasard si la photographie s’est développée, elle aussi, au XIXe siècle. Elle conjugue, selon Peirce10, l’iconicité propre à la peinture avec le caractère indiciaire propre à l’empreinte. R Barthes, J. M. Schaeffer ont mis en évidence sa nature d’empreinte, trace, preuve de réel, indice du jeu. Photographique est l’attribut du regard de Flaubert, selon la définition de M. Caraïon : « Flaubert traite naturellement le réel comme le fait un appareil photographique, se laissant impressionner par des images développées ultérieurement, uploads/Litterature/ maria-gugliotta-le-lecteur-sherlock-holmes-et-le-sens-cache-du-texte-realiste-et-naturaliste-notes-pour-une-hermeneutique-de-la-trace-dans-l-x27-oeuvre-de-flaubert-maupassant.pdf
Documents similaires


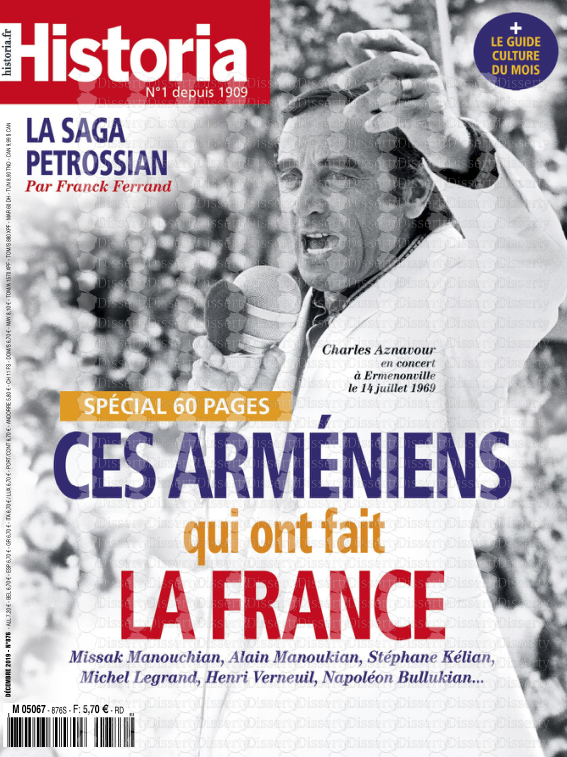







-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 21, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1803MB


