Maurice Blanchot et Michel Foucault : hétérotopies par Manola Antonioli La mult
Maurice Blanchot et Michel Foucault : hétérotopies par Manola Antonioli La multiplicité n’est ni axiomatique ni typologique, mais topologique. Le livre de Foucault représente le pas le plus décisif dans une théorie-pratique des multiplicités. Telle est aussi, d’une autre façon, la voie de Maurice Blanchot dans la logique de la production littéraire qu’il élabore : le lien le plus rigoureux entre le singulier, le pluriel, le neutre et la répétition, de manière à récuser tout à la fois la forme d’une conscience ou d’un sujet, et le sans-fond d’un abîme indifférencié. Foucault n’a pas caché la parenté qu’il éprouve à cet égard avec Blanchot. Gilles Deleuze, Foucault Foucault a reconnu à plusieurs reprises sa dette à l’égard de Maurice Blanchot : « Klossowski, Bataille, Blanchot, ont été pour moi très importants. Et je crains bien de n’avoir pas fait dans ce que j’ai écrit la part suffisante à l’influence qu’ils ont dû avoir sur moi.1 » De son côté, Maurice Blanchot a consacré un petit livre à la pensée de Foucault, Michel Foucault tel que je l’imagine (MF). Mais le lien entre ces deux auteurs ne se limite pas à l’influence réciproque dont témoignent leurs écrits, ni à l’intérêt commun pour certains « thèmes » récurrents (le langage, la loi, le pouvoir, les espaces). Leur rencontre a lieu de façon plus essentielle dans une sorte de topographie commune, la capacité de montrer − dans la théorie et la fiction − les « lieux autres », que Foucault a appelés hétérotopies, et leur rapport au temps, au langage, aux énoncés du savoir et aux stratégies du pouvoir. La pensée du dehors Au cours des années 1960, Foucault a publié un ouvrage sur Raymond Roussel 2 ainsi qu’une série d’importants articles sur la littérature, dont « La pensée du dehors3 », consacré à Maurice 131 Blanchot. À cette époque, la littérature constitue pour Foucault une voie d’accès privilégiée à la béance entre le langage et le sujet que l’époque contemporaine a découverte à travers la linguistique, l’étude des mythes ou la psychanalyse : « L’être du langage n’apparaît par lui-même que dans la disparition du sujet.4 » C’est dans la littérature, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, que s’affirme cette « expérience du dehors » que Nietzsche a introduite au sein de la philosophie : chez Mallarmé, qui expose le mouvement du langage dans lequel disparaît celui qui parle, chez Artaud, qui introduit dans la langue la violence du corps et du cri, chez Bataille, dans le discours de la transgression et de la limite, et dans l’expérience du double et des simulacres qui traverse l’œuvre de Klossowski. Pour Foucault, Blanchot n’est pas seulement l’un des témoins de la pensée du dehors, mais celui qui l’incarne, qui est « pour nous cette pensée même la présence réelle, absolument lointaine, scintillante, invisible, le sort nécessaire, la vigueur calme, infinie, mesurée de cette pensée même5 ». L’extrême difficulté que présente l’écriture de Blanchot est la difficulté même que l’on rencontre quand on veut donner au dehors un langage qui lui soit fidèle. Le risque − dans l’écriture théorique, comme dans la fiction − est celui de « tisser à nouveau la vieille trame de l’intériorité ». C’est pour échapper à ce piège que Blanchot essaie de « convertir le langage réflexif », en ayant recours aux procédés les plus fréquents de son écriture : l’usage non dialectique de la négation6, le ressassement et la répétition, le ruissellement d’un langage « qui a toujours déjà commencé ». Le langage de la fiction doit, à son tour, se plier à une « conversion » analogue : il ne doit plus multiplier et faire briller les images pour faire voir l’invisible, mais parvenir à montrer « combien est invisible l’invisibilité du visible7 ». Les récits de Blanchot mettent ainsi en scène l’impossible vraisemblance des rencontres, de la proximité et de la distance entre les hommes, les femmes, les choses et les mots, à travers des « lieux sans lieu », les maisons, les couloirs, les chambres, les portes qui se multiplient sans cesse, espaces clos et ouverts en même temps. C’est ce mode d’être singulier du discours (plutôt que la présence des mêmes thèmes) qui définit le lieu commun aux « romans » ou aux « récits » de Blanchot et à son écriture « critique », et cette même distinction ne cesse de s’atténuer, jusqu’à l’écriture ni narrative ni réflexive de L’Attente L’Oubli, ou à celle suspendue entre fiction et témoignage de L’Instant de ma mort. Foucault analyse aussi certaines des « figures sans figure » ou sans image de l’écriture de Blanchot : l’attirance et la négligence, la MANOLA ANTONIOLI 132 loi, Euridyce, les Sirènes, le double et le « compagnon », la logique neutre du ni... ni... À ses yeux, elles annoncent la défaillance du sujet qui s’inscrit dans le passage du « je » à la dimension neutre du « il », qui installe l’ambiguïté et la fragmentation au cœur de toute identité. Une puissance neutre semble ainsi s’étendre, progressivement, du langage littéraire au langage quotidien et à toute identité qui voudrait constituer un centre de cohérence ou un principe d’unité immuable et autonome. La présence sans visage qui annonce cette expérience impossible du dehors est tout particulièrement celle du « compagnon », double étrange qui hante presque tous les narrateurs anonymes des récits et romans de Blanchot. Ce compagnon toujours dérobé, ce double qui reste toujours à distance tout en étant extrêmement proche, attire irrésistiblement hors de soi l’intériorité du narrateur, creuse le dedans du « je » pour y introduire la puissance impersonnelle du dehors, d’un « langage sans sujet assignable, une loi sans dieu, un pronom personnel sans personnage, un visage sans expression et sans yeux, un autre qui est le même8 ». Dans « La pensée du dehors », Foucault a mis également en évidence la dimension politique, longtemps négligée par les commentateurs, de l’écriture de Blanchot. En effet, celui-ci ne cesse de montrer, tout particulièrement dans Thomas l’Obscur, Aminadab et Le Très-Haut, les lieux où se manifeste sous toutes ses formes une loi insaisissable et inaccessible, les lieux où le lien entre le langage et les structures juridico-politiques qui le fondent devient visible et reste, cependant, toujours caché. Si la dimension institutionnelle de ces lieux (chambre d’hôpital, tribunal, salle de classe...) semble évoquer les lieux du pouvoir disciplinaire dans lequel Foucault verra en 1975 (Surveiller et punir) l’une des structures typiques de la modernité, la nature insaisissable de ce pouvoir partout présent, visible et invisible en même temps, se rapproche plutôt des formes de « sécurité » et de « police », des mécanismes de ce que Deleuze, à partir d’une lecture de Foucault, a appelé la « société de contrôle9 ». Quelques années après la publication de « L’écriture du dehors », Foucault propose lors d’un entretien10 une nouvelle interprétation de l’œuvre de Blanchot, qui témoigne également d’un changement d’orientation de sa recherche personnelle ; le 22 décembre 1970, il prononce en effet sa leçon inaugurale au Collège de France, publiée sous le titre L’Ordre du discours11, qui marque le début d’un intérêt renouvelé pour le politique. Interrogé par les rédacteurs d’une revue littéraire japonaise, Foucault exprime une évidente désillusion vis-à-vis de la puissance BLANCHOT ET FOUCAULT 133 de transgression dont peut être capable la littérature dans le monde contemporain. Si des écrivains comme Hölderlin et Artaud ont pu affirmer dans leur écriture la puissance de la folie, si Sade et Bataille ont su imposer le discours de la transgression sexuelle, si Mallarmé et Blanchot ont su montrer les ressources inouïes du langage et de l’écriture, il faut bien reconnaître − déclare Foucault − qu’aujourd’hui « la bourgeoisie en est arrivée à vaincre la littérature », et que la subversion par la littérature est probablement devenue un pur fantasme, à cause de la puissance de récupération du capitalisme, de ses maisons d’édition et de ses journalistes. Blanchot est cité dans ces pages comme « le dernier écrivain », celui qui a su délimiter un espace littéraire irréductible qui s’est constitué au cours des XIXe et XXe siècles, mais dont la fonction transgressive et subversive est en train de disparaître. Ayant recours à une comparaison très audacieuse, Foucault présente Blanchot comme le « Hegel de la littérature » : comme Hegel a transformé les murmures de l’Histoire pour créer le sens même de la modernité, Blanchot « a extrait quelque chose de toutes les œuvres importantes de l’Occident, quelque chose qui leur a permis aujourd’hui, non seulement de nous interpeller, mais aussi de faire partie du langage que nous parlons aujourd’hui12 ». Mais le « Hegel de la littérature » est en même temps l’opposé de Hegel : le philosophe allemand a exposé le contenu de l’histoire de la philosophie et des grandes étapes de l’histoire universelle pour montrer leur immanence au présent, pour produire « une magnifique synthèse de l’intériorisation sous forme de mémoire13 », alors que Blanchot s’est adressé aux grandes œuvres de uploads/Litterature/ maurice-blanchot-et-michel-foucault-heterotopies-par-manola-antonioli.pdf
Documents similaires




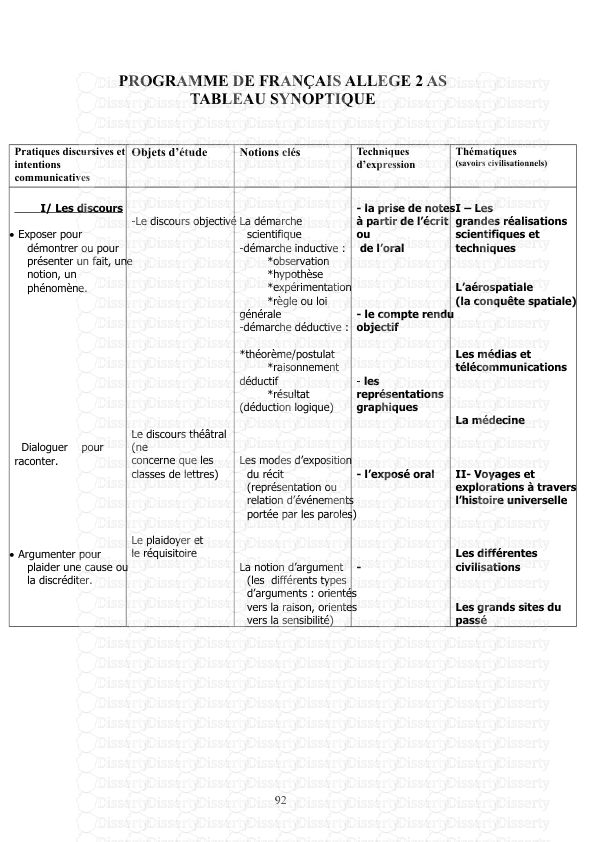





-
28
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 26, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3562MB


