Tous droits réservés © Les Presses de l'Université de Montréal, 2006 Ce documen
Tous droits réservés © Les Presses de l'Université de Montréal, 2006 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 30 mars 2021 12:46 Études françaises Un duel entre la main et l’oeil Intensités du rapport texte/image dans certains phototextes de Sophie Calle Isabelle Décarie Figures et frictions. La littérature au contact du visuel Volume 42, numéro 2, 2006 URI : https://id.erudit.org/iderudit/013862ar DOI : https://doi.org/10.7202/013862ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Les Presses de l'Université de Montréal ISSN 0014-2085 (imprimé) 1492-1405 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Décarie, I. (2006). Un duel entre la main et l’oeil : intensités du rapport texte/image dans certains phototextes de Sophie Calle. Études françaises, 42(2), 25–45. https://doi.org/10.7202/013862ar Résumé de l'article Quand Sophie Calle explique dans En finir pourquoi ce projet fut un échec, elle écrit que les images qu’on lui avait fournies « ne se suffisaient pas à elles-mêmes. En montrant des photos trouvées sans apport vécu de ma part, je ne collais pas à mon propre style. » Pour elle, le texte manquait, « ce texte, poursuit-elle, qui me colle à la peau ». En partant de cette affirmation, nous nous proposons de relire et de revoir certaines oeuvres de Sophie Calle afin de les confronter à cette question du style et du texte-peau qui vient à manquer. Sophie Calle, qui ne semble pas croire aux métaphores, entretient un rapport aplani à la réalité où la limite entre le propre et le figuré n’existe pas. Nous montrons comment cette façon de voir le monde influence le contact entre écriture, peinture et photographie dans ses oeuvres. En relisant ses filatures, en analysant son rapport aveugle à la peinture et ses tentatives d’épuiser tout sentiment dans ses deux derniers livres, nous expliquons comment le rapport texte/image est chaque fois défini par l’absence d’un « déboîtement » (Roland Barthes) entre les deux, offrant très peu d’espace au commentaire et au rêve du lecteur. Un duel entre la main et l’œil Intensités du rapport texte/image dans certains phototextes de Sophie Calle Vouloir devenir écrivain, je le pressentais vaguement, ce serait donc cela, croire qu’on se laisse porter par la vie tout en se fi xant des rendez-vous qui durcissent le cadre. Jean-Christophe Bailly, Tuiles détachées Depuis la fi n des années 1970, Sophie Calle produit des œuvres où sont associées deux pratiques artistiques distinctes, photographie et littéra- ture. Ses travaux ont fait l’objet d’analyses tant du côté de la critique d’art que des études littéraires. Bien que Calle emploie le terme « artiste » pour désigner sa profession1 et non « écrivain », Christine Macel, commissaire de l’exposition des œuvres de Sophie Calle intitu- lée M’as-tu vue2, n’hésite pas à retracer, dans le catalogue de l’exposi- tion, l’histoire de la notion d’auteur en littérature depuis la fi n des années 1960 afi n de montrer en quoi « Sophie Calle apparaît aujourd’hui, avec près de vingt-cinq ans de développement, comme une infi rmation absolue de tous ces présupposés3 ». Ces « présupposés », on le sait, ren- voient à la mort de l’auteur annoncée par Roland Barthes et au désir d’effacer toute trace du sujet qui écrit en faveur d’une importance isabelle décarie 1. Sophie Calle, « Évaluation psychologique », dans Sophie Calle. M’as-tu vue, catalogue de l’exposition, Paris, Éditions du Centre Pompidou, Éditions Xavier Barral, 2003, p. 230. 2. L’exposition a eu lieu au Centre Pompidou à Paris du 19 novembre 2003 au 15 mars 2004. 3. Christine Macel, « La question de l’auteur dans l’œuvre de Sophie Calle. Unfi nished », dans Sophie Calle. M’as-tu vue, op. cit., p. 20. 26 accordée au texte et au lecteur. On connaît trop bien les détails de cette histoire pour les reprendre à nouveau, mais ce qui paraît notable ici, c’est le détour par la théorie littéraire qu’emprunte le commissaire pour faire sens de la pratique de Calle. D’ailleurs, cette dernière n’est certes pas la seule à avoir « infi rmé » la mort de l’auteur. Plutôt, il faut bien dire que ses « tableaux-textes4 » s’inscrivent directement dans le déroulement logique et historique de la notion d’auteur : dès 1975 avec Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune et Fils de Serge Doubrovsky5, les pratiques textuelles vont renverser le balancier pour exacerber, démultiplier, outrer même la fi gure de l’auteur jusqu’à la caricaturer6. De plus, la question du texte et son rapport à l’image ont participé à la redéfi nition de l’autobiographie et du récit de soi à cette même époque avec des ouvrages aussi différents que La chambre claire de Barthes, L’amant de Marguerite Duras ou encore Photos de racines d’Hélène Cixous7, des ouvrages qui ont, chacun à sa façon, contribué aussi à la redéfi nition du genre littéraire sur lequel ils prenaient appui, que ce soit autobiographie, roman ou essai. En 1997, Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone consacrent d’ailleurs un chapitre à l’image dans leur ouvrage sur l’autobiographie8. Aujourd’hui, tout porte à croire que l’illustration, le dessin ou la photographie sont d’emblée associés au récit de soi, comme en témoigne la collection qui porte le titre évocateur de « Traits et portraits », créée en 2004 aux éditions du Mercure de France et qui rassemble des autoportraits d’artistes, d’écri- vains (comme J.M.G. Le Clézio ou Marie Ndiaye), où « [l]es textes sont ponctués de dessins, d’images, de tableaux ou de photos qui habitent les livres comme une autre voix en écho, formant presque un récit souterrain9 ». Mentionnons aussi le dernier livre d’Annie Ernaux qui constitue un autre exemple de la recrudescence de l’écriture de soi attachée à l’image, L’usage de la photo, écrit avec Marc Marie, et qui est 4. Ibid., p. 27. 5. Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975 ; Serge Doubrovsky, Fils, Paris, Galilée, 1977. 6. Je pense ici au roman Scrapbook de Nadine Bismuth (Montréal, Éditions du Boréal, 2004) qui s’affi che comme une parodie de l’autofi ction. 7. Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Cahiers du cinéma », 1980 ; Marguerite Duras, L’amant, Éditions de Minuit, 1984 ; Hélène Cixous, avec Mireille Calle-Gruber, Photos de racines, Éditions des femmes, 1994. 8. Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone, L’autobiographie, Paris, Armand Colin, 1997, p. 253-262. 9. Description de la vocation de la collection qui se trouve sur le site Web du Mercure de France. études françaises • 42, 2 27 un récit autobiographique autour de photographies intimistes prises par le couple10. Sans doute Christine Macel passe-t-elle aussi par la théorie littéraire pour tenter de défi nir les « phototextes11 » de Calle d’un point de vue générique : il semble toujours plus facile d’emprunter à une autre disci- pline ses principes et son vocabulaire pour défi nir une pratique qui nous échappe. Calle travaille sur la frontière entre « le visible et le dicible12 », où le propre de l’image et de l’écriture est chaque fois poussé à sa limite, comme c’est le cas dans le projet intitulé Les aveugles, pour lequel Sophie Calle a demandé à des personnes nées aveugles de lui dire ce qu’est pour elles l’image de la beauté. L’installation est composée des photographies de ces personnes interrogées, de l’image de la beauté en question photographiée (un carré de pelouse pour un enfant qui aime par-dessus tout le vert), et la réponse elle-même encadrée. Les images de la beauté, virtuelles, imaginées et inventées par les aveugles ont donc été prises (photographiées) au pied de la lettre par Calle pour leurs auteurs qui ne pourront jamais les voir. Ce projet est un exemple parmi d’autres d’un travail sur la frontière entre voir et dire, mais aussi entre propre et fi guré, entre virtuel et réel, une limite que l’artiste se plaît à faire disparaître. Lorsque Macel s’appuie sur des courants artistiques pour décrire les installations de Calle, elle parle de « mythologies individuelles » ou encore de « Narrative Art », deux expressions qui ont été forgées dans les années 1970 pour décrire des regroupements et des pratiques d’artistes et qui permettent de désigner une part seulement des phototextes de Calle. Mais fi nalement, le commissaire retient surtout un genre litté- raire pour parler des œuvres de l’artiste : le roman-photo13. Bien que Calle répète plusieurs fois certaines de ses expériences et de ses tacti- ques artistiques, la mise en place ou la mise en page de ses œuvres peuvent changer, ce qui complique l’opération de dénomination. Le terme roman-photo sert surtout à décrire les premières œuvres telles que À suivre… ou encore L’hôtel14. Yve-Alain Bois, quant à lui, emploie 10. Annie Ernaux et Marc Marie, L’usage de la photo, Paris, Gallimard, 2005. uploads/Litterature/ sophie-calle.pdf
Documents similaires






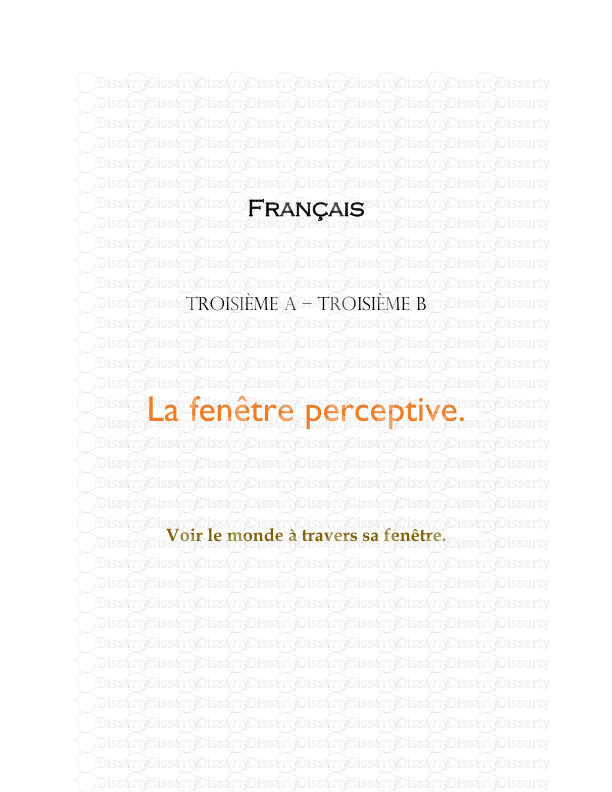



-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 25, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1999MB


