Catastrophes naturelles : de la crise de communication à la communication de cr
Catastrophes naturelles : de la crise de communication à la communication de crise Louisa Dris-Aït Hamadouche, maître-assistante. Faculté des Sciences Politiques et de l’Information ; Département des sciences politiques et des Relations internationales Introduction 1- Qu’est-ce que la communication de crise ? - Définition et caractéristiques - Moyens et objectifs 2- La communication descendante (l’autorité responsable): - Plan de communication - Stratégies 3- La communication ascendante (relais du public): - Fonction complémentaire (psychologique et logistique) - Fonction contestataire (critique et désignation des responsables) Conclusion Il est coutume de dire que la différence entre l’information et la communication réside dans le fait que la transmission de l’information profite au récepteur, tandis que la communication est au service de l’émetteur. La communication de crise ne déroge pas à la règle. En fonction de sa provenance, elle transmet un message bien précis, dans un but qui l’est tout autant. Cette intervention se propose de mettre en évidence deux éléments clés. Le premier aborde le sujet à travers son objectif, en montrant dans quelle mesure l’existence d’une véritable communication de crise est indispensable dans la gestion d’une catastrophe naturelle ou technologique et comment elle permet, sinon d’en atténuer les conséquences, du moins de ne pas les aggraver. En terme de vision minimaliste, Galilée a une réflexion intéressante (dans Galileo Galilei, la pièce Berthold Brecht): «Pourquoi vouloir dès maintenant nous montrer si intelligents quand nous pourrions tout juste être un petit peu moins bêtes ?».1 1 Didier Heiderich, «La communication de crise, vraiment une spécialité?», Mars 2003, http://www.communication-crise.com/articles/article0030.php Le second élément clé situe la communication dans son contexte fonctionnel, une optique selon laquelle la communication de crise apparaît dans toute sa partialité. Elle remplit, en effet, des fonctions déterminées, dont certaines sont plus avouables que d’autres, quand bien même s’agirait-il d’une crise provoquée par une catastrophe naturelle. Aussi la communication de crise n’est-elle ni une variable indépendante, ni un élément extérieur au politique. D’où les sensibilités, les susceptibilités et les débats incisifs que la communication de crise ne manque pas de susciter. Avant d’aborder le sujet dans le contexte de lé défense civile, il paraît indispensable de déterminer la nature du sujet. I- Qu’est-ce que la communication de crise ? Définition La communication de crise n’est pas une discipline indépendante, mais une partie intégrée, une approche spécialisée de la gestion de crise qui inclut des disciplines récentes et parfaitement identifiées à l’image des méthodes d’organisation pointues et de la communication. En cas de crise, il ne faut plus raisonner en terme de jours, ni en heures, mais en minutes. La capacité à résister, conditionnée par le degré de préparation, fera la différence. Sans préparation, l'entreprise ne tient pas le coup et génère en fait ses propres crises. C’est pourquoi il est exigé une maîtrise multisectorielle, à savoir la communication financière, industrielle, sociale, environnementale, commerciale, publicitaire, les relations presse, la communication interne (l’institution, l’entreprise) et externe (partenaires naturels et conjoncturels). La communication de crise est directement liée à la situation de l’institution concernée par rapport à la catastrophe. Cette catastrophe peut se situer en dehors de l’institution, dans lequel cas, elle devient la victime de la catastrophe. Si, en revanche, elle survient à l’intérieur de l’institution, cette dernière est alors coupable. La communication n’est pas la même que l’institution soit confrontée au premier ou au second cas, mais elle doit toujours s’attendre à être prise à partie et accusée d’avoir une part de responsabilité. Les bases de la communication de crise Les catastrophes naturelles ou technologiques suscitent indéniablement des questions et des commentaires récurrents. Que s’est-il passé ? Quelle est la première préoccupation ? Qui est responsable (le coupable) et pourquoi (les défaillances techniques) ? Qui va payer et Combien ? Cela s’est-il déjà déroulé auparavant ? Quels changements par rapports aux précédants ? La réponse doit être concise, compréhensible, sans prise de position, ni commentaires prématurés. Elle doit reconnaître les faits avec tous les interlocuteurs pour ne pas que le communiquant apparaisse sur la défensive2. Extrapolons avec la catastrophe de Bab El Oued. Il fallait dire : Il s’agit d’une accumulation de fortes précipitations exceptionnelles qui ont atteint 210 mm en 48 heures. Celles-ci ont été accentuées par la configuration géographique, les caractéristiques urbanistiques de Bab El Oued et l'obstruction des canaux d'évacuation des eaux pluviales. A Bab El Oued, la puissance et la vitesse de cette crue ont emporté tout ce qui se trouvait sur leur passage3. Les eaux se sont engouffrées dans le collecteur d'eau d’oued M'kacel, dans la zone de Frais Vallon et ont creusé un trou sur le bord de ce dernier. Le terrain s’est effondré peu après. Puis les eaux se sont engouffrées par le trou dans le collecteur, ce qui a créé un siphon similaire à celui d'un mouvement de tourbillon lorsqu'on vide un lavabo. Il reste un cratère de plus de 10 m de diamètre qui est tout à fait circulaire. Au fond de ce cratère, il y a le collecteur d'eau qui est aujourd'hui envasé. L'ensemble des sols a été déboisé, ce qui fait que plus rien ne retenait la terre. En présence d'un déluge, l'eau amène des quantités phénoménales de terre sur l'axe de Triolet jusqu'à la mer. (Explications de Dominique Laplace). Deuxième chose à garder en tête : les premières préoccupations déclarées doivent toujours aller vers les victimes directes (attentats, accident) et celles subissant de grosses pertes. Relevons que ces préoccupations déclarées ne sont pas forcément les préoccupations réelles. En cas de catastrophes technologiques, en effet, la première question que se posent les preneurs de décision n’est pas «combien y a-t-il de victimes ?» mais plutôt «s’agit-il d’un accident ou d’un attentat ?». Afin de garantir la cohérence de la réponse, une temporisation peut se révéler nécessaire. Temporisation ne signifie pas le silence radio. La temporisation est de l’ordre de la demi-heure, après l’afflux des premières questions des médias. Le silence est propice à toutes les supputations et aux pires critiques ainsi que l’a démontré le black out ayant frappé une grande partie du pays en 2004. Si cette coupure spectaculaire de courant a été traitée par le silence en Algérie, une autre expérience met en lumière les avantages de la communication par la reconnaissance. Fin 1999, la double tempête qui sévit en France a détruit une partie du réseau électrique, démontrant au passage la rareté des lignes enterrées. Répondant aux critiques qui lui ont été adressées, EDF a mis en place une stratégie de proximité. Les médias étaient invités à filmer des lignards remontant les lignes sous des 2 Jean-Michel d’Hoop, «La communication de crise», Les Cahiers techniques, http://64.233.183.104/search? q=cache:sA2TqDWsTZIJ:www.marsh.fr/marshv2/conseils.nsf/d4cd07be33ef6263c1256c0f003218b5/140d427b 1f6bcd34c1256c24005136c5/%24FILE/communication%2520de %2520crise.pdf+La+communication+de+crise&hl=fr 3 Entretien avec Mohand-Amokrane Mendjekane, responsable à la sous-direction des risques majeurs de la Protection civile, Le Matin, 29 novembre 2001. conditions atmosphériques très mauvaises. Tous les acteurs possibles ont été mobilisés, qu'ils soient en retraite ou d'une compagnie étrangère. EDF n'a pas fait de grosse communication, ni de promesse, mais a fait se succéder des petites actions, tout en diffusant des conseils à la radio ou à la télévision. Finalement, EDF est devenu l'entreprise préférée des Français4. Qui communique en cas de crise et pourquoi ? Les personnes habilitées à communiquer dans ce type situation sont celles capables de maîtriser l’ensemble des secteurs impliqués. L’absence régulière de ces personnes est due à un manque de préparation. Ainsi constate-t-on en amont un déficit de politiques prédéterminées, une mauvaise préparation et une méconnaissance des véritables relais d’opinion. Par exemple, dans les heures qui ont suivi l’accident de Skikda en janvier 2004, un responsable non identifié de la sécurité du site a incriminé une «chaudière défectueuse». Loin de convaincre les spécialistes, cette version a été contredite par d’autres versions. Ainsi interrogé par la presse américaine, l’ambassadeur algérien aux Etats-Unis, Idriss Jazairy, a-t-il affirmé que les premiers éléments de l’enquête penchaient en faveur d’une fuite de gazoduc. Cela signifie que les personnes habilitées à communiquer en cas de crise sont absentes, dans un secteur aussi sensible que celui-ci. En amont, le résultat est une mauvaise appréciation et une compréhension partielle de la situation, une incapacité à agir, des réflexes non appropriés, des lacunes dans la construction du discours et un positionnement versatile. Parmi les personnes indispensables dans la cellule de communication de crise citons les psychosociologues. Leur connaissance de la société, de ses repères culturels et religieux est donc indispensable. Leur rôle est capital dans la mesure où une catastrophe naturelle ou technologique créée un vent de panique qu’il est impératif de contenir pour prévenir l’aggravation de la situation. A titre d’exemple, certains experts ont préconisé l’usage de bassins de rétention à la place -ou en plus- des tuyaux enterrés. La raison vient du fait que les aménagements visibles de l'extérieur sont à même de rassurer les populations. Les bassins sont visibles et sécurisants. La catastrophe naturelle a souvent pour conséquence la rupture brutale de la communication (coupure d’électricité, téléphones coupés, routes barrées….). Or, le premier objectif ou la première mission de la communication de crise est la détermination des besoins de secours les plus uploads/Management/ de-la-crise-de-communication-a-la-communication-de-crise.pdf
Documents similaires








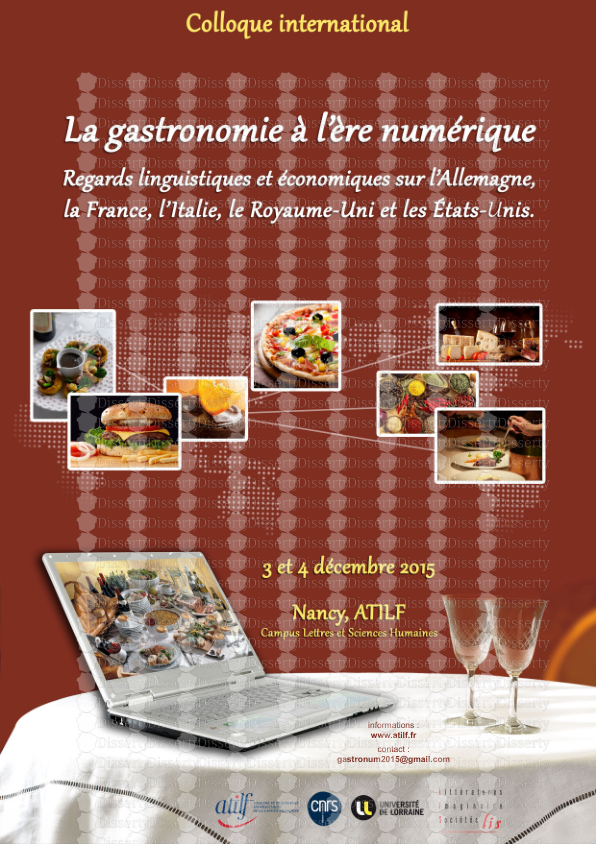

-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 27, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.1698MB


