L'Homme et la société Fondements conceptuels de la théorie de l'organisation Vi
L'Homme et la société Fondements conceptuels de la théorie de l'organisation Victor Leonard Allen Citer ce document / Cite this document : Allen Victor Leonard. Fondements conceptuels de la théorie de l'organisation. In: L'Homme et la société, N. 4, 1967. pp. 79-96. doi : 10.3406/homso.1967.1025 http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1967_num_4_1_1025 Document généré le 16/10/2015 fondements conceptuels de la théorie de l'organisation V. L. ALLEN Nous voulons examiner dans cet article la nature et la signification des transformations de l'approche théorique du phénomène de l'organisation. Nous montrerons que les principales approches constituent divers modèles procédant du même cadre d'analyse et non des théories distinctes. Nous définissons une théorie comme un ensemble logiquement cohérent d'outils généraux d'analyse, obtenus par déduction à partir d'une représentation simplifiée de la réalité. Un modèle, d'autre part, est un corps de propositions strictement formalisé; il peut se référer à un aspect particulier d'une théorie; il n'est qu'une interprétation de celle-ci1. C'est une formule heuristique, construite pour donner une explication particulière d'une théorie. Il peut donc y avoir de nombreux modèles d'une même théorie, se référant à sa totalité, à certains de ses aspects ou à un même aspect. Chacun de ces modèles est différent des autres par sa construction formelle, mais tous ont les mêmes bases théoriques. Les théories, elles, diffèrent autant que les représentations de la réalite qui les fondent. Deux explications du même aspect de la réalité devraient donc être des versions entièrement différentes pour avoir qualité à représenter des théories différentes. Dans le domaine de l'activité des organisations, deux explications des comportements, fondées l'une sur une représentation statique de la réalité et l'autre sur une représentation dynamique constitueraient deux approches théoriques différentes. En montrant que les soi-disant théories de l'organisation sont en fait des modèles, nous chercherons à révéler leurs liens conceptuels fondamentaux.. C'est une représentation statique de la réalité qui sous-tend les modèles de théorie de l'organisation que nous décrirons ici ; elle a pour conséquence une analyse de l'activité des organisations dénuée de toute référence à aucun facteur externe. En effet, tout segment d'activité peut être isolé en un système autonome. La réalité, cependant, est un phénomène dynamique dont une représentation statique ne peut évidemment pas fonder une explication adéquate. Même les plus bornés des théoriciens de l'organisation prennent conscience de cette insuffisance. On peut en voir une preuve dans les tentatives de construction des modèles qui tiennent compte du changement social. Il y a une rupture entre les modèles statiques des 1. Pattern in Organization Analysis : a Critical Examination, par Shermann Krupp, 1967, p. 53 et seq. . 8o V. L. ALLEN années 20 et 30 et les modèles équilibrés des années postérieures à 1940. Des termes comme dysf onction, tension, friction et même conflit, sont courants dans le vocabulaire de Talcott Parsons, R.K. Merton, P. Selznick, Ami- tai Etzioni et autres. Ces tentatives n'ont cependant pas produit de nouvelles théories; seulement de nouveaux modèles pourvus de mécanismes tenant compte de mouvements limités. L'autonomie des organisations n'a été troublée en rien, afin qu'elles puissent encore être analysées indépendamment des facteurs liés à l'environnement. On concède aux organisations des changements internes mais, pour les empêcher d'échapper à tout contrôle et pour éviter les transformations qualitatives, on affirme que les organisations possèdent des mécanismes de rééquilibrage automatique qui rendent le changement marginal et assurent le retour au statu quo. Autrement dit, on introduit dans un cadre d'analyse inchangé la possibilité d'un changement, mais limité et déterminé, et cette formation ingénieuse permet de conserver une représentation simplifiée de la réalité. La construction d'un modèle analytique qui permettrait des changements qualitatifs imposerait une représentation de la réalité qui admette la prééminence du tout sur ses parties. Ceci, qui implique de refuser l'autonomie des organisations ou de toute autre partie de la réalité et de reconnaître que les forces causales émanent de facteurs externes liés à l'environnement et à l'histoire, aurait entraîné un rejet complet de la vision statique de la réalité. Il serait superflu de supposer que les organisations possèdent des mécanismes rééquilibrants. Cette nouvelle vision de la réalité aurait posé la question de la capacité des organisations à se maintenir et à se perpétuer. Autrement dit, une représentation simplifiée de la réalité qui permette une analyse causale est, pari passu, un rejet du statu quo, car elle intègre à l'analyse des faits créateurs de changements qualitatifs. En travaillant dans un cadre d'analyse inchangé, les théoriciens de l'organisation qui ont essayé de donner des explications causales, ont donc tenté un travail impossible. La théorie de l'organisation est passée par un processus de construction méthodologique et est donc devenue plus complexe. Ses derniers développements ont été des synthèses des différentes approches. Ils n'ont pas introduit de nouveaux faits pour étayer leur analyse ni de nouveaux outils analytiques. Ils ont simplement rassemblé et synthétisé ce qui était connu. Les plus intéressantes de ces synthèses sont Les Organisations, de J.G. March et H. A. Simon, publié en 1958, et Les organisations complexes d'Amitai Etzioni, publié en 1961. Nous ne nous préoccuperons pas en détail de ces derniers ouvrages; nous analyserons par contre les éléments qu'ils tentent de synthétiser, car c'est par rapport à ces éléments que nous jugerons finalement ces synthèses. Nous ne nous préoccuperons pas non plus de toutes les contributions à la théorie de l'organisation. Nous traiterons seulement de celles, qui, selon nous, ont apporté des modifications importantes aux explications antérieures. Les premières tentatives pour expliquer l'activité des organisations sont directement issues du désir d'augmenter l'efficacité des managers. Elles prennent le parti de ces derniers et utilisent leur terminologie. Cette approche est sans ambiguïté : on parle le langage des patrons et des managers, on ne s'embrouille pas de jargon et nulle prétention à l'impartialité. Elle est généralement décrite comme l'organisation scientifique du travail, mais on la range dans les types de théories de l'organisation sous le nom de théorie classique. Cette approche a deux directions distinctes. La première traite du contrôle technique et de l'efficacité dans la coordination des hommes et des machines : elle se fonde sur les travaux de F.W. Taylor. L'essentiel du travail de Taylor est contenu dans son ouvrage: L'Orga- LA THÉORIE DE L'ORGANISATION 81 nisation scientifique du travail (1911) 2. Il tente d'y montrer comment la production matérielle d'une firme pourrait croître par l'analyse, la mesure et la manipulation des activités physiques qui concourent à la production. Taylor ne s'est pas intéressé à l'ensemble des activités physiques d'une firme mais aux seules tâches simples et répétitives. On critiqua ce caractère incomplet de son travail. D'après March et Simon, les tâches que Taylor et ses successeurs ont examinees « ne demandent pas au travailleur qui y est affecté de résoudre des problèmes complexes... Parce qu'elles sont relativement routinières, les tâches dont la théorie s'est préoccupée peuvent être presque complètement décrites en termes de comportements manifestes, sans référence explicite au processus mental de l ouvrier... L'étude traditionnelle du temps et des méthodes a laissé de côté les tâches où on résout des problèmes et ne s'est donc pas intéressée aux aspects du comportement humain qui vont nous occuper tout au long de cet ouvrage 3.»On critiqua aussi le caractère normatif du travail de Taylor. On ne peut comprendre en détail l'Organisation scientifique du travail ni juger sa contribution à l'explication du fonctionnement des organisations sans construire d'abord le cadre d'analyse dont elle procède. L'organisation est la firme définie par son statut légal. C'est une entité limitée, isolée, séparée des autres entités et de son environnement. La firme n'est pas seulement dans un environnement statique; elle est elle-même une entité statique. Il n'est pas, en son sein, de divisions irréductibles ni de forces que l'application, à l'intérieur de la firme, d'une science et d'une action rationnelle ne pourrait contrôler. Ce modèle repose sur l'hypothèse de motivations exclusivement économiques et celle de l'existence de conditions, non spécifiées, qui rendent possibles des réponses rationnelles. Il suppose aussi que chaque firme a un objectif unique, la maximisation des profits par la maximisation de la production matérielle de la firme à partir de combinaisons données des facteurs de production. Tout, y compris la force de travail, considérée d'ailleurs comme un appendice des machines, est subordonné à ce but et aux règlements créés par la firme pour le remplir. La structure autoritaire qui soutient ces règlements devient un facteur donné, non remis en question; de même, bien sûr, la répartition des moyens de production qui détermine sa forme. La question de la légitimité de l'autorité ne se pose jamais. La seconde direction de la théorie « classique », en se plaçant dans un cadre administratif formel, approche, plus que Taylor, du stade que les théoriciens de l'organisation appelleraient le parachèvement. On la nomme la théorie désorganisation administrative du travailwou théorie « classique de l'administration » ou, simplement, la théorie « de l'organisation». March et Simon la décrivent comme suit : « Le problème général auquel s'attache la théorie formelle est le suivant : étant donné le but général d'une organisation, nous pouvons définir les tâches élémentaires nécessaires pour atteindre ce but. uploads/Management/ homso-0018-4306-1967-num-4-1-1025.pdf
Documents similaires






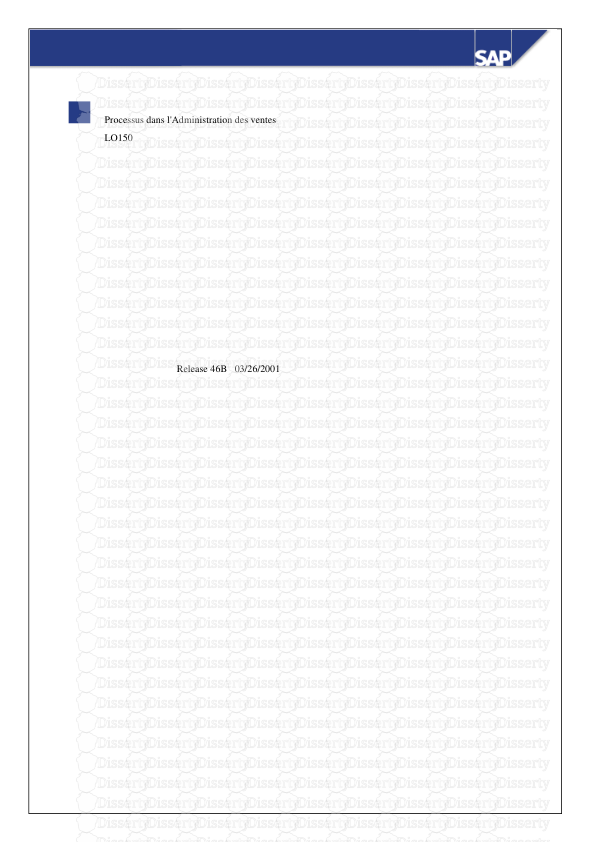



-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 16, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.8552MB


