Revue électronique de Psychologie Sociale, 2009, No. 4. 32 La régulation des ém
Revue électronique de Psychologie Sociale, 2009, No. 4. 32 La régulation des émotions Silvia Krauth-Gruber Université Paris Descartes Les émotions que nous ressentons, quelles soient positives ou négatives, ne sont pas toujours désirables et exprimées. Qui n’a pas à un moment ou à un autre ravalé sa colère, refoulé ses larmes ou masqué sa peur ou au contraire exagéré sa joie? Les tentatives de maîtriser, de contrôler et, plus généralement, de réguler ses émotions nous sont toutes familières. Chacun a probablement à sa disposition des « techniques » pour apaiser les émotions qui l’étreignent tels compter jusqu’à 10, prendre une profonde respiration, se distraire ou penser à autre chose. La régulation des émotions renvoie aux processus que les individus emploient pour influencer quelles émotions ils ont, quand ils les ont et comment ils les éprouvent et expriment. Dans cet article, nous nous intéresserons aux raisons qui poussent les gens à réguler leurs émotions, c’est-à-dire les motivations sous-jacentes à la régulation émotionnelle. Puis nous verrons comment les gens régulent leurs émotions, c’est-à-dire quelles stratégies ils utilisent, consciemment ou non, pour le faire. L’efficacité de la régulation émotionnelle, autrement dit, ses conséquences pour l’individu et ses relations avec autrui seront discutées dans la dernière partie de l’article. Pourquoi régulons-nous nos émotions ? Il existe une multitude de raisons qui poussent les gens à réguler, à contrôler leurs émotions (pour une revue de question voir Fischer, Manstead, Everts, Timmers, & Valk, 2004 ; Niedenthal, Krauth- Gruber, & Ric, 2008). Pour tout individu le bonheur et le plaisir sont le bien suprême dans la vie et leur recherche est donc une des motivations principales de régulation. Mais la régulation va au-delà de cette motivation hédoniste à éviter des émotions désagréables pour ressentir du bonheur, du plaisir. Ce que les gens désirent sentir ou exprimer est aussi déterminé par les conséquences négatives que les émotions peuvent avoir pour les autres et pour leurs relations avec les autres. Lorsque nous ne montrons pas notre déception au sujet d’un cadeau que notre ami a choisi avec tant d’attention, nous le faisons pour des raisons dites prosociales, c’est-à-dire pour protéger les sentiments d’autrui. Et lorsque nous n’exprimons pas notre jalousie, c’est souvent pour des raisons de protection de soi parce que se montrer jaloux pourrait provoquer des reproches et même la colère chez l’autre, et pourrait au final mettre notre relation en péril. Enfin, les gens n’aiment pas faire mauvaise impression et être jugés négativement par leur entourage. Ainsi, ils contrôlent aussi leurs émotions afin de se conformer aux coutumes et normes sociales en exprimant des émotions socialement désirables et en dissimulant celles qui sont considérées comme inappropriées et donc indésirables. Ce sont les normes émotionnelles qui indiquent comment répondre de manière appropriée dans une situation donnée. Elles spécifient quelle émotion peut être éprouvée ou exprimée, à quel moment, par qui, et avec quelles intensité et fréquence. Les normes émotionnelles sont spécifiques aux cultures, aux situations, et au genre. Nous avons appris à ne pas rire lors d’un enterrement et à ne pas trop afficher notre fierté en public après un exploit, ou encore à être souriant sur notre lieu de travail (Hochschild, 1983). Cependant, le comportement émotionnel n’est pas seulement déterminé par le contexte dans lequel il se produit, mais également par le sexe de l’individu. Les femmes sont censées exprimer les émotions qui facilitent leurs rapports avec les autres. Elles sont encouragées à être gentilles, aimables et souriantes, et à ne pas se comporter de manière agressive. En revanche, l’expression des émotions de puissance telles que la colère, le mépris ou la fierté est considérée comme appropriée pour les hommes tandis que l’expression de la tristesse, la peur, la douleur ou d’autres signes de faiblesse et de vulnérabilité leur est proscrite (Fischer, 2000). Enfin, les normes émotionnelles varient d’une culture à l’autre. Dans la plupart des cultures occidentales comme, par exemple, les pays de l’Europe ou les Etats-Unis, le soi* est défini comme une entité autonome, qui est source de la pensée, des décisions, et des actions de l’individu. Les normes émotionnelles dans ces cultures, appelées « cultures individualistes* », encouragent l’expérience et l’expression des émotions qui reflètent l’indépendance et l’autonomie du soi. La satisfaction des besoins et buts personnels est censée procurer des émotions positives de fierté ou de joie alors que la colère ou la frustration sont considérées convenables lorsque les but personnels ou l’autorité de la personne sont menacés. En revanche, dans la plupart des cultures non-occidentales, asiatiques, comme par exemple le Japon ou la Chine, le soi est défini par les relations avec les membres de son groupe, de sa culture. Ces cultures, aussi appelées « cultures collectivistes* » encouragent l’expérience et l’expression des émotions, comme par exemple la sympathie, mais aussi la honte, la culpabilité ou la peur, qui reflètent le désir à maintenir le soi dans une position d’interdépendance et qui permettent d’entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Par contre, les émotions qui risquent de perturber l’harmonie relationnelle, telles la colère ou Revue électronique de Psychologie Sociale, 2009, No. 4. 33 la fierté, sont proscrites (Markus & Kitayama, 1991). En résumé, les normes émotionnelles prescrivent le comportement émotionnel considéré comme approprié pour les femmes et les hommes, dans un contexte social et culturel spécifique. L’expérience et l’expression des émotions incompatibles avec ces normes émotionnelles ont des coûts sociaux qui peuvent aller de la désapprobation sociale jusqu’au rejet social et induire des sentiments de culpabilité et d’inquiétude. Ces conséquences négatives incitent les individus à réguler leurs émotions en conformité avec les normes émotionnelles. Comment régulons-nous nos émotions ? Les émotions sont communément définies comme des processus dynamiques induits par l’évaluation de la situation par rapport à sa signification pour l’individu. Cette évaluation provoque un ensemble coordonné de réponses physiologiques, expressives et comportementales (Scherer, 2005, Niedenthal et al., 2008). En se basant sur cette définition nous pouvons aisément comprendre que la régulation des émotions peut intervenir à différents moments du processus émotionnel : soit au moment où l’individu est exposé à une situation potentiellement émotionnelle (l’antécédent), soit au moment où il réagit à cette situation par exemple avec un sentiment de colère, une augmentation de la tension sanguine, un froncement des sourcils (les réponses émotionnelles). Cette idée se retrouve dans le modèle processuel du psychologue américain James Gross (1999, 2007) qui distingue la régulation centrée sur les antécédents émotionnels et la régulation centrée sur les réponses émotionnelles (voir figure ci-contre). La régulation centrée sur les antécédents est une stratégie préventive* qui apparait très tôt dans le processus émotionnel, c’est-à-dire avant même que l’émotion elle-même soit complètement activée. Elle consiste à modifier l’impact émotionnel d’une situation. L’individu peut sélectivement éviter des situations ou personnes qui risquent de lui procurer des émotions déplaisantes ou au contraire, approcher celles qui induisent des émotions plaisantes. Concrètement, une personne peut décider de ne pas aller dans un café où elle risquerait de rencontrer son ex-petit ami, ce qui pourrait la rendre malheureuse. Pour retrouver le moral, elle peut aussi décider d’aller voir une comédie au cinéma ou de rendre visite à une amie dont la bonne humeur est communicative. L’individu peut également essayer de modifier la situation de manière à ce qu’elle perde sa signification émotionnelle. Par exemple, une personne qui a peur des chiens peut demander à un ami de tenir son chien en laisse lors de sa visite, ce qui rend la situation moins anxiogène pour elle. Dans certaines situations potentiellement émotionnelles il peut être suffisant de se distraire, de penser à autre chose, c’est-à-dire, de réorienter son attention vers les éléments non-émotionnels de la situation. Une dernière possibilité de prévenir des émotions indésirables consiste à interpréter une situation ou différemment, autrement dit, à réévaluer des stimuli potentiellement émotionnels d’une manière qui modifiera leur signification émotionnelle. Pensez au collègue de travail qui passe devant vous sans dire un mot. En interprétant son comportement comme intentionnel, désobligeant vous risquez de ressentir de la colère. Par contre, si vous attribuez son comportement soit à ses problèmes personnels qui le préoccupent, ou à un trait de caractère, sa timidité par exemple, vous vous sentez probablement moins irrité. La régulation centrée sur les réponses émotionnelles intervient plus tard dans le processus émotionnel, une fois que l’individu a conféré une signification émotionnelle à la situation. Elle vise à modifier les réponses émotionnelles spécifiques qui se situent au niveau du ressenti, physiologique, ou expressif. Pour réguler leur ressenti émotionnel les gens peuvent soit se focaliser sur les pensées qui accompagnent les émotions, soit essayer de supprimer ces pensées. La première, appelée rumination mentale, consiste à se concentrer sur les pensées, les sentiments et souvenirs qui apparaissent de manière récurrente lors d’un événement émotionnel. Cette confrontation permet de mieux les comprendre et, à long terme, de réduire leur impact désagréable. Mais la rumination qui a principalement été étudiée dans le contexte Figure 1. Modèle processuel de la régulation émotionnelle (Gross, 1999, 2007) Revue électronique de Psychologie Sociale, 2009, No. 4. 34 des états dépressifs, peut, au contraire, aggraver les symptômes dépressifs, uploads/Management/ krauth-gruber-2009-la-regulation-des-emotions.pdf
Documents similaires








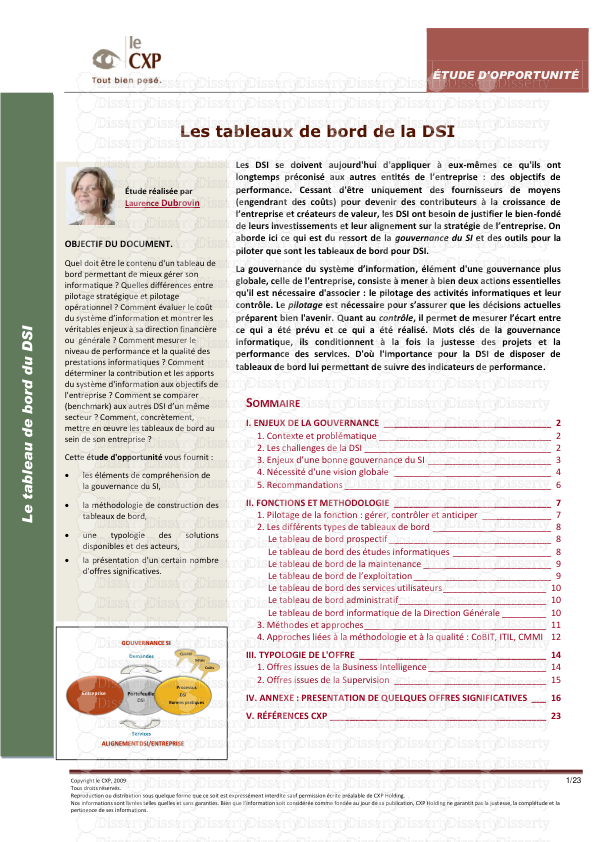
-
106
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 14, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.1789MB


