HÉBERT (Louis), « L’analyse », L’Analyse des textes littéraires. Une méthodolog
HÉBERT (Louis), « L’analyse », L’Analyse des textes littéraires. Une méthodologie complète, p. 11-13 DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-3329-0.p.0011 La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé. © 2014. Classiques Garnier, Paris. Reproduction et traduction, même partielles, interdites. Tous droits réservés pour tous les pays. L’ANALYSE DÉFINITION DE L’ANALYSE Analyser un objet quelconque (par exemple, un texte, un groupe de textes, un genre textuel, une image), c’est le caractériser, c’est-à-dire stipuler une ou des propriétés (ou caractéristiques). En termes logiques, l’objet est alors un sujet et la caractéristique, un prédicat que l’on affecte au sujet ; les deux forment une proposition (au sens logique du terme). Une proposition est affectée d’une valeur de vérité : vrai, faux, indécidable (on ne peut trancher entre vrai et faux), indécidé (on n’a pas (encore) stipulé sa valeur de vérité). La proposition affectée de sa valeur de vérité est associée à une instance, un sujet observateur, qui en assume la teneur. Dans la proposition L’eau bout à 100 degrés Celsius trouvée dans un article scientifique : le sujet est l’eau ; le prédicat est le fait qu’elle bout à cent degrés Celsius ; la valeur de vérité est vrai ; et l’instance qui produit et assume cette proposition est l’auteur de l’article. Les mêmes principes valent pour des propositions littéraires comme Phèdre est un monstre, Phèdre n’est pas un monstre, Hamlet aime vraiment Ophélie, Hamlet n’aime pas vraiment Ophélie. Les deux premiers exemples illustrent le fait qu’une proposition peut porter sur une entité (un terme) et les deux derniers, le fait qu’une proposition peut porter sur une relation ou un processus (une action) entre entités. Termes, relations et processus (ou opérations) sont les trois types possibles de phénomènes. Au sens large, une analyse est un genre textuel qui met intensément en œuvre les opérations analytiques, en particulier la comparaison, la décomposition, le classement et la typicisation (voir ci-dessous). Elle englobe alors des genres textuels comme l’analyse (au sens restreint), la dissertation, l’explication de texte, le commentaire composé, le mémoire ou la thèse de maîtrise (de master), la thèse de doctorat, le compte rendu et d’autres formes analytiques. La dissertation, l’explication de texte, le commentaire composé, le mémoire et la thèse sont des genres textuels scolaires. Bien que le compte rendu et l’analyse (au sens restreint) ne © 2014. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites. 12 L’ANALYSE DES TEXTES LITTÉRAIRES soient pas des genres uniquement scolaires, ils peuvent évidemment être produits dans un contexte scolaire1. Il existe deux attitudes face aux propriétés à dégager par l’analyse, attitudes qui définissent deux sortes d’analyses différentes : (1) soit on les pose en hypothèse (ou elles ont été posées à ce titre par quelqu’un d’autre) et l’on vérifie par l’analyse si l’hypothèse est fondée ; (2) soit on ne les pose pas en hypothèse mais simplement les dégage par l’analyse. Voir le chapitre sur l’hypothèse. Pour une présentation des différentes sortes possibles de propriétés dégagées par l’analyse, voir le chapitre sur les propriétés. OPÉRATIONS DE L’ANALYSE Les quatre grandes opérations analytiques (et leurs relations corré- latives), qui permettent donc de stipuler les propriétés d’un objet, sont les suivantes : 1. Comparaison (relations comparatives) : un sujet observateur donné, en un temps donné, établit entre deux objets ou plus une ou plusieurs relations comparatives (identité, similarité, opposition, altérité, similarité métaphorique, etc.). Sur les relations de comparaison, voir Hébert 2005- et 2012-. 2. Décomposition (relations méréologiques) : un sujet observateur, en un temps donné, dégage les parties d’un tout ; l’opération inverse est la composition (qui consiste à ne plus envisager les parties mais que le tout, à ne plus « voir » le sucre et les œufs dans la meringue, que la meringue). 3. Typicisation (ou catégorisation ; relations typicistes) : un sujet observateur, en un temps donné, rapporte une occurrence 1 On peut ajouter à ces genres textuels le résumé, qui est également une forme d’analyse puisqu’il fait ressortir les propriétés jugées essentielles de ce qu’il résume. Le résumé est également une composante des textes analytiques ; par exemple on pourra résumer l’intrigue d’une œuvre ou une théorie avant de l’analyser. Par ailleurs, le chercheur en littérature est amené à pratiquer d’autres genres textuels encore : le devis de recherche (voir le chapitre sur le sujet), le rapport de recherche, la demande de subvention, la pro- position de communication ou d’article, le texte d’orientation d’un colloque, la lettre de recommandation, etc. © 2014. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites. L’analys 13 (par exemple, cet animal) à un type (par exemple, c’est un chien), un modèle dont elle constitue une manifestation, une émanation, plus ou moins conforme et intégrale. 4. Classement (relations ensemblistes) : un sujet observateur, en un temps donné, rapporte un élément (par exemple, une bille noire) à une classe (les billes noires). Les trois dernières opérations sont similaires en ce qu’elles mettent en présence des formes globales (tout, classe, type) et des formes locales (partie, élément, occurrence). De plus, le classement et la typicisation sont des formes de comparaison ou du moins présupposent une comparaison. En effet, pour déterminer si une unité appartient à une classe, est un de ses éléments, on compare les propriétés (ou traits) définitoires de la classe (par exemple, être vertébré) et celles de l’élément potentiel (cet animal est bien vertébré) ; pour déterminer si une unité relève de tel type, on compare les propriétés du type (par exemple, un texte romantique est écrit au « je », exprime une émotion et de forte intensité, etc.) et celles de son occurrence potentielle (ce texte possède les propriétés du texte romantique, il est donc un texte romantique). Les quatre opérations participent de deux opérations interprétatives fondamentales : la dissimilation, qui augmente les différences entre unités et l’assimilation, qui les diminue. Par exemple, dans une comparaison, on fait ressortir les identités latentes en lissant, diminuant les diffé- rences patentes et on fait ressortir les différences latentes en lissant les identités patentes. Des opérations de transformation (par exemple, l’adjonction, la suppression, la substitution, la permutation) peuvent de leur côté modifier les unités et donc les relations qui les unissent. Sur les opérations de transformation, voir Hébert 2005- et 2012- ou voir ici le chapitre sur les aspects. © 2014. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites. uploads/Management/ l-analyse-des-textes-litteraires-une-methodologie-complete-l-analyse.pdf
Documents similaires





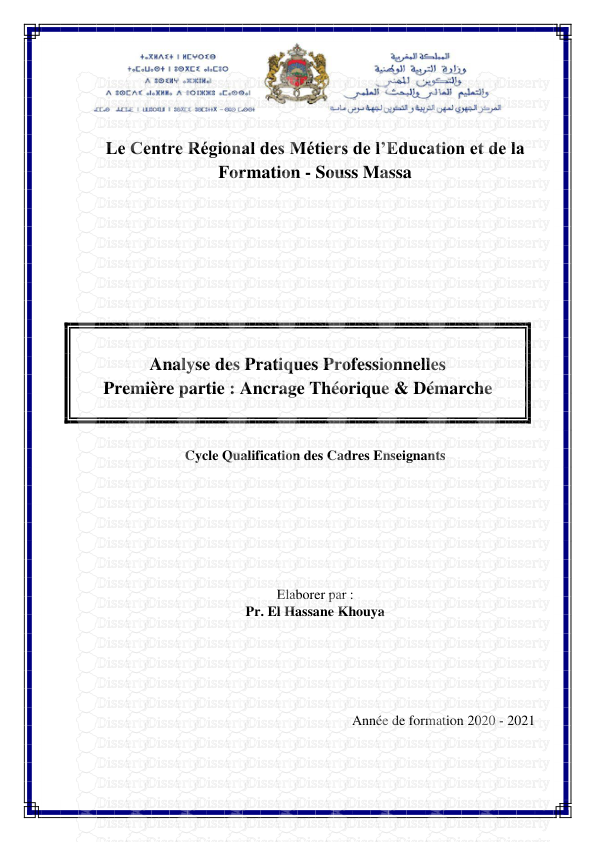




-
70
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 24, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.1090MB


