2019/2020 Validation d’une méthode d’analyse Encadré par : Mr. Pr. A. ZAALOUL R
2019/2020 Validation d’une méthode d’analyse Encadré par : Mr. Pr. A. ZAALOUL Réaliser par : • HAFDI Ouissal • EL HOUATE Imane • ZOUHRI Loubna • EL HANAFI Mourad • JLIBINA Badr Résumé 1- Description d’une méthode d’analyse - Schéma général représentant les principales étapes d’une analyse - Définir une méthode d’analyse consiste à décrire chacune de ses étapes, indissociables les unes des autres, en précisant pour chacune d’elles les opérations élémentaires qu’il faut réaliser - Il existe de très nombreuses méthodes de mesure. Le choix de l’une d’entre elles va guider le choix de la méthode de traitement qui sera préalablement appliquée à l’échantillon analytique (= prise d’essai) - Le traitement de l’échantillon analytique constitue en règle générale l’étape clef de la méthode d’analyse : elle contient la majeure partie de l’erreur analytique et représente un facteur limitant en termes de rapidité et d’automatisation 2- Performances et critères de choix d’une méthode d’analyse - Limites de détection et de quantification - Justesse et fidélité (répétabilité) ; exactitude et reproductibilité - Domaine de linéarité et sensibilité - Robustesse - Spécificité, rapidité et aptitude à l’automatisation - Coût (investissement et fonctionnement) 3- Validation d’une méthode d’analyse ➢ Objectifs : avoir une méthode juste (sans biais) et connaître sa fidélité (répétabilité) ➢ Moyens : estimation puis élimination du biais de la méthode • DEMARCHE : 1. Préparation d’un Echantillon de Référence Interne du Laboratoire (ERIL) 2. Estimer le biais : - Par rapport à une méthode de référence - Par rapport à un échantillon de référence - Au moyen d’une analyse inter-laboratoires 3. Eliminer le biais ===> Recherche des causes d’erreurs - Eviter les erreurs liées à la réponse instrumentale - S’affranchir des effets de matrice : méthode des ajouts dosés et des dilutions - Optimiser la méthode de traitement de l’échantillon analytique • APPLICATION : ERIL + méthode validée => mise en place d’un contrôle interne de la qualité des mesures, en construisant une carte de contrôle et en utilisant l’échantillon ERIL CHAPITRE 1 : Rappels Bibliographiques I. Généralités sur la méthode analytique 1. Définition de la méthode analytique : La méthode d’analyse consiste à décrire chacune de ses étapes, indissociables les unes des autres, en précisant pour chacune d’elles les opérations élémentaires qu’il faut réaliser. La description de méthode soumise doit comprendre les points suivants : ✓ La définition de l’analyse ✓ L’appareillage ✓ Les réactifs ✓ La procédure analytique y compris le traitement des échantillons, la purification… ✓ La procédure pour le calcul des résultats à partir des données brutes 2. Description d’une méthode d’analyse : Une analyse chimique peut être définie comme une suite d’opérations élémentaires, statistiquement indépendantes les unes des autres, qui commencent au moment de la prise d’essai (prélèvement d’un échantillon analytique sur l’échantillon de laboratoire) et aboutissent à l’expression d’un résultat d’analyse qu’il faudra valider pour pouvoir disposer enfin d’une donnée analytique. On a pour habitude de regrouper ces opérations élémentaires en quelques étapes principales, telles qu’elles sont représentées sur la figure 1 où il est rappelé que l’analyse chimique s’insère dans une procédure analytique et que celle-ci devra être également validée pour atteindre l’information chimique recherchée. Pour la mesure, on dispose d’un très grand nombre de méthodes qu’on trouvera décrites dans des ouvrages généraux, des ouvrages consacrés à un domaine d’application particulier ou dans les très nombreux ouvrages, plus spécialisés, qui permettent d’approfondir l’étude de telle ou telle méthode. Mais il est important de remarquer ici que la méthode d’analyse correspond à une combinaison choisie des différentes étapes, que ces étapes sont interdépendantes et qu’il faut les prendre globalement en compte, s’il s’agit par exemple de valider la méthode. La méthode choisie pour l’étape de traitement de l’échantillon analytique est en particulier étroitement liée au choix qui aura été fait pour la méthode de mesure et, si l’on est confronté au choix d’une méthode d’analyse, la réflexion devra donc simultanément porter sur ces 2 étapes, en ayant bien conscience du verrou que l’étape de traitement de l’échantillon constitue pour l’analyse. Figure 1 : Les différentes étapes d’une analyse chimique Structures des données chimiques 3. Cycle de vie d’une méthode d’analyse : On a trop souvent tendance à décrire les méthodes d’analyse comme des procédures immuables et figées. C’est un peu l’impression que donnent les manuels et autres recueils de normes techniques. Or, comme tout procédé de production, les méthodes d’analyse naissent, évoluent et meurent. Pour clairement comprendre le rôle et la place de la validation dans la vie d’une méthode d’analyse, il est intéressant de décrire son cycle de vie depuis le moment où elle est choisie jusqu’au moment où on l’abandonne. ● D’abord on va sélectionner la méthode, c’est-à-dire de choisir parmi toutes les méthodes physico-chimiques connues ou maîtrisées par le laboratoire celle qui doit permettre de déterminer un ou plusieurs analytes représentatifs du problème analytique à traiter. ● Ensuite, il convient de développer la méthode, c’est-à-dire mettre au point le mode opératoire et adapter la méthode aux conditions pratiques où elle va être utilisée. Exemple : il peut être nécessaire d’automatiser une méthode manuelle ou bien d’améliorer ses performances pour qu’elles soient compatibles avec le problème analytique à traiter. En général, le développement d’une méthode est synonyme d’optimisation. Lorsque la mise au point est terminée, on dispose de ce que l’on appelle dans le cadre BPL un mode opératoire normalisé ou Stan- dard Operating Procédure (SOP). En particulier, il faut préciser le domaine d’application de la méthode, c’est-à-dire l’ensemble des matrices auxquelles elle s’applique ainsi que la gamme de concentrations utilisables. C’est à ce moment, et seulement à ce moment, que doit intervenir la validation. On a aujourd’hui pris l’habitude de distinguer la validation intra-laboratoire de la validation inter- laboratoires. La première est universelle et obligatoire pour toutes les méthodes. La seconde – souvent plus lourde – n’intéresse en principe que les méthodes qui seront utilisées par plusieurs laboratoires ou dont les résultats peuvent servir à des décisions économiques. Figure 2 – Cycle de vie d’une méthode d’analyse ➢ Exemple : dans l’industrie pharmaceutique, il sera inutile (voire impossible) de procéder à la validation inter-laboratoires d’une méthode qui sert, en interne, à l’étude d’une molécule non encore mise sur le marché. Par contre, dans les industries agroalimentaires, il faudra toujours procéder à une validation inter-laboratoire pour une méthode qui servira à mesurer la conformité d’une denrée. Dans ce cas, il peut y avoir une contre-expertise et, pour interpréter son résultat, il importe de savoir selon quelle amplitude deux résultats fournis par deux laboratoires indépendants peuvent « normalement » différer Si la validation se révèle conforme, le cycle de vie va se poursuivre par une utilisation de la méthode en routine. Au bout d’un certain temps, on peut être amené à abandonner la méthode et à entamer un autre cycle car elle est devenue obsolescente. Dans d’autres cas, on peut simplement faire des modifications et, selon leur importance, appliquer une procédure plus ou moins complète de revalidation de la méthode. En effet, on doit effectuer une revalidation toutes les fois où l’on introduit une modification « mineure » de la méthode. Par contre, si l’on fait une modification « majeure », il faut appliquer à nouveau la procédure complète de validation. Il est délicat de définir une échelle exacte d’importance des modifications : cette appréciation peut être laissée au savoir- faire de l’analyste. Toutefois, les organismes d’accréditation ont-ils tendance à juger mineur un changement de réglage, comme laisser « 20 min au bain-Marie » au lieu de « 15 min », et majeure toute modification qui affecte le principe de la méthode. Mais la question peut être délicate. Ainsi, un changement de solvant d’extraction doit-il être considéré comme mineur ou majeur ? C’est selon le contexte. 4. Objectif et moyen de la validation d’une méthode d’analyse : Il est assez facile de se mettre d’accord sur une définition de la validation d’une méthode d’analyse. Comme l’indique la norme ISO/IEC 17025 : « Le laboratoire doit valider des méthodes […] pour confirmer [qu’elles] conviennent à l’emploi prévu. La validation doit être aussi étendue que l’impose la réponse aux besoins dans l’application ou le domaine d’application donné ». Valider, c’est apporter des preuves que la méthode est adaptée à ses objectifs. En fait, on ne va pas s’intéresser à la validation en tant que telle mais à la procédure qui permettra de conduire cette démonstration. Comme l’indique le même texte « le laboratoire doit enregistrer les résultats obtenus et la procédure utilisée pour la validation ». Et c’est là que les désaccords vont apparaître car on confond souvent validation et procédure de validation. Cette confusion apparaît dans une définition de la Pharmacopée américaine : « La validation d’une méthode d’analyse est une procédure permettant d’établir, par des études expérimentales, que les critères de performance de la méthode satisfont aux exigences prévues par les applications analytiques de la méthode. Les critères de performance sont exprimés en termes de caractéristiques analytiques. Les caractéristiques classiques qui devraient être prises en compte pour la validation des types d’essais décrits uploads/Management/ la-validation-de-la-methode-analytique.pdf
Documents similaires






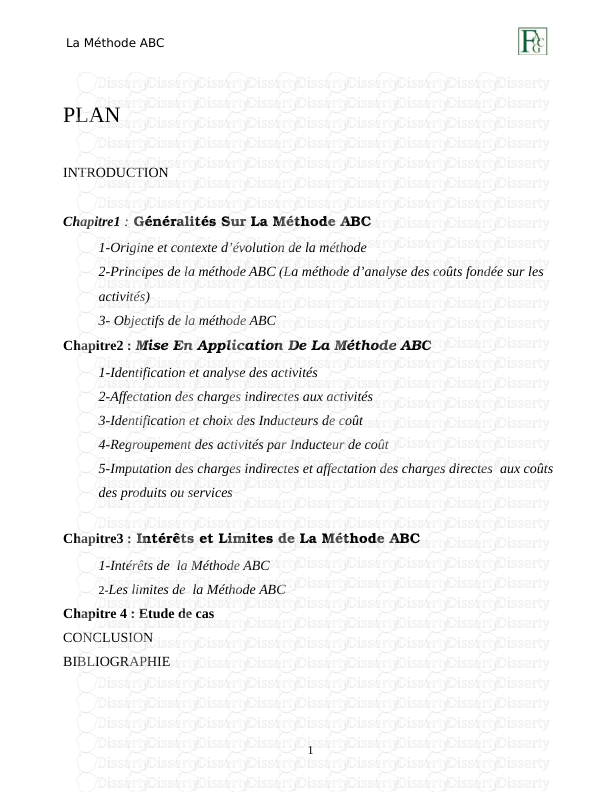



-
83
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 25, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.1209MB


