LE CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL Page d’accueil : http://controlegestion.p
LE CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL Page d’accueil : http://controlegestion.pagesperso-orange.fr/ Introduction Ce site se compose de plusieurs pages dédiées aux méthodes de contrôle de gestion opérationnel Au préalable nous vous proposons un bref développement relatif aux moyens et conditions qu’il convient de mettre en œuvre pour mener à bien la mission de contrôle de gestion. Beaucoup de littérature existe sur le sujet et c’est pourquoi nous nous limiterons à en rappeler les principaux thèmes. 1. Principes généraux (réalisé) 2. L'organisation des référentiels (réalisé) 3. Analyse des marges (réalisé) 4. Comptes d'exploitation produits / clients (réalisé) 5. Gestion industrielle (réalisé) 6. Suivi des coûts de structures, (réalisé) 7. Rentabilité des investissements (réalisé) 8. Cash flow opérationnel (réalisé) 9. Les outils du contrôle de gestion (réalisé) 10. Reporting et tableaux de bord (réalisé) 11. Gestion de la complexité (à venir) 12. Positionnement stratégique de l'entreprise (réalisé) 13. Budget et rolling forecast (en cours) 0 Introduction Les missions du contrôle de gestion Pour mener à bien ses missions, un contrôle de gestion doit pouvoir s’appuyer sur : Des moyens informatiques / systèmes : - Comptabilité analytique - Gestion industrielle - Système de données statistiques - En amont, des référentiels bien organisés (fichiers articles, clients, comptes, axes). Une équipe de collaborateurs spécialisés par domaine (dimensionnée selon la taille de l’entreprise ou de la division) Une culture d’entreprise tournée vers la gestion : la culture vient souvent du haut et en particulier de la direction générale. Un langage commun dans les suivis de gestion des différents services et une bonne organisation des axes d’analyses (référentiels) Un pilotage du relationnel souvent difficile à moduler entre la nécessaire rigueur, l’esprit de méthode et d’organisation, la diplomatie et le sens critique. Nous reviendrons sur ces notions dans les chapitres suivants. Parmi les missions qui incombent au contrôle de gestion, nous pouvons citer : Mettre en place un système d’information de gestion ; il ne peut exister de contrôle de gestion sans outils d’information fiables. Le contrôle de gestion doit être étroitement lié aux services informatiques. Mettre en place un suivi par rapport à un référent : un budget, mais ce n’est pas une fatalité et on pourra avantageusement lui préférer l’exercice précédent. Assurer le Reporting, c’est-à-dire permettre la remontée d’informations formatées (tableau de bord) à une direction et/ou à un groupe. Effectuer les contrôles et analyses d’écarts Construire le budget (le cas échéant) et/ou le rolling forecast (prévisions tournantes) Chiffrer les objectifs stratégiques sous forme de plan à moyen terme (ou business plan). Conseiller les responsables opérationnels dans les domaines de la gestion Fournir des outils et analyses d’aide à la décision … Le contrôleur de gestion n’est pas le décideur, mais il doit aider les services décideurs en étant garant d’une certaine objectivité et transparence. Il existe aujourd’hui un débat relatif à l’appauvrissement de la fonction de contrôleur de gestion. Il est vrai que l’augmentation de la pression du reporting focalise de plus en plus cette activité sur le ‘Pourquoi’ au lieu de l’orienter sur la gestion de l’avenir, c'est-à-dire le ‘Comment’ et le ‘Quand’. Il est vrai également que le contrôle de gestion peut être considéré par certains dirigeants comme un service permettant d’expliquer les écarts afin de corriger la trajectoire à court terme. Pour donner une image simple, le contrôle de gestion semble devenir le rétroviseur et le tableau de bord de l’entreprise alors même que cette fonction était surtout destinée, à l’origine, à regarder au loin comme une aide à la décision stratégique. Pour autant il est difficile d’opposer la dimension opérationnelle à la dimension stratégique du contrôle de gestion. L’une doit nécessairement compléter l’autre. En effet la connaissance approfondie du ‘Business Model’ d’une entreprise ou d’une division permet d’élaborer une stratégie sur des bases bien maîtrisées. Il en va de même pour les autres domaines d’une ‘business unit’ : la créativité, puisqu’il s’agit bien de cela, ne doit plus être l’apanage de quelques personnes ; toutes les ressources doivent être mobilisées vers cette nécessaire recherche. En ce qui concerne le rattachement du Contrôle de Gestion Opérationnel (CdGO), il semble préférable que la fonction soit directement associée à une direction générale plutôt qu’à une direction financière ce qui va de soi dans une organisation matricielle. En effet le CdGO, au travers de ses différents domaines d’interventions, est connecté à l’ensemble des services d’une entité comme à celui de la finance. En définitive il intervient comme un support d’aide à la décision et se positionne en quelque sorte en généraliste de l’entreprise. C’est en cela que l’adjectif ‘Opérationnel’ revêt toute son importance. SITES REFERENTS : http://www.leblogdesfinanciers.fr/author/cselmer/ http://www.manager-go.com/finance/ http://www.vernimmen.net/Lire/Sites_favoris.php 1. Principes généraux Le plus souvent, les comptabilités générales et analytiques ne donnent pas la possibilité de réaliser un suivi précis des marges par activités, et particulièrement si l'on souhaite isoler le détail de comptes d'exploitation clients, de références vendues, de réseaux ou encore de pays... Par contre les comptabilités permettent d'assurer un calage des charges et produits associés sur des agrégats globaux. De plus le contrôle budgétaire, issu de la comptabilité analytique, constitue un outil efficace de suivi des coûts de structures. Sur la base des mêmes flux, deux systèmes d'analyses doivent s'organiser et se compléter pour construire le modèle de suivi des marges d'une entité. On distingue ainsi : 1. les informations comptables et analytiques (agrégats globaux) 2. les informations de gestion, issues des statistiques et des systèmes amont qui les alimentent. Nous reviendrons un peu plus tard sur ces notions, mais au préalable nous devons définir une méthode de gestion qui peut être mise en œuvre pour suivre les performances d’une entreprise. Nous développerons également par la suite le suivi du Cash flow qui de financier devient de plus en plus opérationnel. En effet dans un contexte d’argent rare, les entreprises prennent du recul par rapport à cette substance qui les fait vivre : le Cash. 1.1. Le choix de la méthode de gestion Le suivi de la gestion doit être effectué en scindant l'analyse en deux parties, nous distinguerons ainsi : la partie haute du compte de résultat, du chiffre d'affaires comptable jusqu'à la marge sur coûts directs la partie basse du compte de résultat qui regroupe l'ensemble des frais fixes indirects Cela nous amène, dès à présent, à définir une première structure de compte de résultat de gestion qui remplacera avantageusement les présentations comptables ou les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) associés. Cette première version est adaptée à la gestion d’une entité dans son ensemble et englobe ainsi les domaines industriel, commercial/marketing et le back office (administratif). Une autre organisation, dite ‘matricielle’, correspond à une gestion par secteur d’activité ou métier. C’est ce que l’on rencontre dans les grands Groupes qui ont besoin de souplesse stratégique, structurelle et opérationnelle. Les flux s’en trouvent modifiés et les prises de décisions centralisées et optimisées par secteur. Pour autant les principes de contrôle de gestion restent les mêmes et s’adaptent simplement aux flux physiques et décisionnels. 1.1.1. Le compte de résultat de gestion Le compte de résultat est produit par la comptabilité analytique mais peut être également obtenu, pour les petites entités, en adaptant le plan de comptes général. Il n’existe pas à proprement parler de définition universelle, elle peut varier légèrement d’une société (ou groupe) à l’autre mais on retrouve toujours les mêmes principes de base. Nous en proposons un premier modèle possible adapté aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) : Les lignes de ce compte de résultat de gestion sont définies de la façon suivante : NET SALES (CA comptable net de ristournes) Chiffre d'affaires net de remises sur facture et de ristournes, inclus également les avoirs à établir. Correspond à la définition du CA net comptable ; inclus la totalité des activités y compris les produits annexes (Commissions reçues, redevances de marque hors Groupe… etc) - JOINT MARKETING EFFORTS (Participations pub. ou Actions commerciales) a) Ce sont des budgets correspondants aux accords passés avec les clients ainsi que l’ensemble des moyens promotionnels mis en œuvre dans les points de vente ; ils correspondent en particulier aux factures de PP émises par les distributeurs b) on y trouve également les BRI (Bons de Réductions Immédiats) et autres NIP (Nouveaux Instruments Promotionnels). c) Sont intégrés a ce niveau les coûts de locations de meubles (bacs, présentoirs), ainsi que les frais d'animations faisant souvent partie des accords commerciaux. d) Les reprises de provisions sur millésimes antérieurs ne sont pas intégrées sur cette ligne. Elles sont imputées en 'Other Operating Items (OOI)' (cf. ci-dessous). De même, les pénalités des audits distributeurs sur périodes antérieures sont intégrées en OOI. A l'inverse les dépassements sur millésimes restent affectés à cette ligne afin d'éviter tout risque de dérapage dans les méthodes de provisions. = NET REVENUES (Chiffres d'affaires 3xnet) Différence entre net sales et actions commerciales - VARIABLE COSTS : COGS = coûts des produits vendus composés des : 1 - couts des matières premières et emballages, regroupe : les uploads/Management/ le-controle-de-gestion-operationnel.pdf
Documents similaires
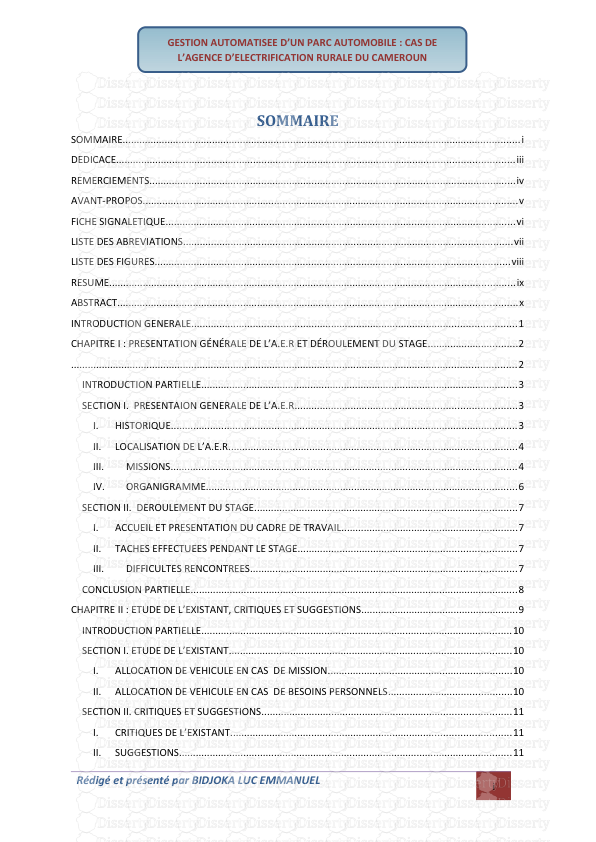









-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 08, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 3.6396MB


