Le mal nrf NOUVELLE REVUE DE PSYCHANALYSE Numéro 38, automne 1988 © Éditions Ga
Le mal nrf NOUVELLE REVUE DE PSYCHANALYSE Numéro 38, automne 1988 © Éditions Gallimard, 1988. Argument Michel de M'Uzan Jean-Michel Labadie Jenny Renaud François Gantheret Jean Ménéchal Jean Clair Muriel Djéribi André Godin Alain Boureau Geneviève Pichon Maurice Bellet Edmundo Gômez Mango Monique David-Ménard Jean Pouillon Bertrand d'Astorg Max Milner André Green Claude Lanzmann TABLE L'extermination des rats 9 La pensée mise à mal par le crime 17 La mauvaise graine 37 KHabemus papam! 47 suivi de Quelques fragments « caviardés » de lettres de Freud à Fliess 67 Une femme est brûlée 73 La vision de Méduse 87 Œil d'amour, œil d'envie 99 « Délivre-nous du mal » 111 La chute comme gravitation restreinte 129 La lèpre et le péché 147 Le Dieu-monstre 159 La mauvaise langue 169 L'atteinte de l'autre 181 Consoler Job 189 Variation sur l'interdit majeur 193 Le ciel en creux. 221 Pourquoi le mal? 239 Hier ist kein Warum 263 VARIA 5 ARGUMENT Si l'interrogation sur le Mal a été pendant des siècles au cœur de la réflexion philosophique, religieuse et morale, si elle a nourri et nourrit encore toutes sortes de mythes, si elle assure le succès des sectes, elle n'est guère présente dans la pensée contemporaine. Est-ce la « banalité du mal » selon la formule de Hanna Arendt, qui nous empêche de le penser? Nous n'imputons plus les « basses œuvres » à la figure de Satan. Ne croyant plus aux possédés, nous ne faisons plus appel aux exorcistes mais aux psychologues, aux sociologues, aux historiens pour chercher les motifs de l'horrible, pour saisir le contexte familial, social, du crime, qui serait susceptible de le faire comprendre et même de le justifier aucune aberration, individuelle ou collective, qui n'ait sa logique propre. Quand nos juges condamnent (il le faut bien.), ils ont de plus en plus conscience d'exercer une tâche de régulation sociale (la « machine judiciaire ») et de l'exercer trop tard, quand le mal est fait, alors qu'il eût fallu en prévenir les manifestations. Le présupposé n'est-il pas alors que dans une « société saine», il n'y aurait plus ni délinquants, ni criminels, ni tortionnaires? Que, dans une démocratie enfin accomplie, toute violence serait absente? Ce serait oublier que ce sont précisément les sociétés et les régimes politiques fondés sur le culte de la santé et de la pureté, c'est-à-dire les plus acharnés à dénoncer et à extirper le mal, qui font preuve de la cruauté la plus extrême en sachant donner à l'irrationnel déchaîné le masque de la froide raison. Ce serait oublier aussi que l'humanisme peut engendrer la terreur. Schématiquement, on pourrait donc, en ce qui concerne le mal, définir deux positions contraires. Ou bien on le relativise jusqu'à en nier l'existence il n'y a plus de Mal (avec une majuscule), tout au plus des maux des maladies, des souffrances, des nuisances qu'il convient de gérer et de traiter, socialement ou individuellement; à la limite, au regard d'une telle idéologie techniciste, chômage et criminalité, accidents de la route et toxicomanie, pollution de l'air et prostitution sont équivalents. Nul n'est méchant volontairement; nous ne connaîtrions jamais que des défauts de fonctionnement auxquels une meilleure technique de gestion sociale, assistée d'un peu de bonne volonté, porterait remède. Ou bien on pose l'existence d'un Mal absolu, mais c'est pour pouvoir LE MAL l'exclure de soi et anéantir ceux qui sont censés l'incarner: bouc émissaire, inquisition et paranoïa. Deux manières de ne pas reconnaître que le mal est immanent à la nature humaine, qu'il en est, écrivait Freud, un « trait indestructible ». Freud, là-dessus en effet, est sans illusion le mal est en l'homme cette tentation de « satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer ». Est ici pleinement reconnue « la tendance native de l'homme à la méchanceté, à l'agression, à la destruction et donc aussi à la cruauté ». On peut, bien sûr, ne voir dans la lucidité d'un tel constat qu'une reprise de l'énoncé classique homo homini lupus que seule viendrait contrebalancer la confiance, également sans cesse réaffirmée, dans la tâche civilisatrice indéfinie visant à réprimer, à dompter l'« hostilité primaire », à maîtriser l'animalité humaine. À ceci près que Freud, à jamais marqué comme la plupart de ses contemporains par l'épreuve de la Grande Guerre, a pu reconnaître ce qui est devenu pour nous, marqués par d'autres expériences encore plus impensables, une évidence aveuglante, à savoir que l'opposition entre barbarie et civilisation n'est plus de mise quand la barbarie et non plus seulement le « malaise » est, sous mille formes, présente dans la civilisation, quand elle exerce ses ravages au nom de la civilisation et là où celle-ci est la plus « raffinée ». Tout comme le cancer cet autre mal qui ronge le corps est moins une maladie qui affecterait le vivant désordre intérieur ou dysfonctionnement que la malignité du vivant transformant la loi qui le régit en son contraire (prolifération cellulaire anarchique), le Mal serait à comprendre comme l'inhumain dans l'homme, monde de l'inhumain produit par l'homme. Pas de manichéisme chez Freud, opposant deux principes également souverains; pas de Thanatos ou de puissance destructrice substan- tifiée qui serait en lutte permanente contre un Éros créateur; mais bien plutôt Éros se retournant contre lui-même la mort dans la vie, la haine dans l'amour, la douleur dans la jouissance. Si la pulsion de mort est dite sans figure et sans voix, c'est qu'elle défigure et fait taire. Si nous ne pouvons la penser mais seulement en subir les effets, c'est qu'elle est l'anti-pensée. V anti-pensée aussi bien que l'anti-instinct (l'instinct, ce qui tient lieu de « pensée » au vivant). La question du Mal peut, nous semble-t-il, être envisagée en psychanalyse selon deux perspectives. Une première conception, topique, fait jouer l'opposition du « bon » et du « mauvais ». On se référera alors à des textes comme « La négation » ou « Pulsions et destins des pulsions ». Le moi, pour se constituer, se fonde sur le rejet, l'exclusion hors de ses frontières, de l'étranger. Il absorbe et il crache, vomit, éjecte, projette le ARGUMENT mauvais. Melanie Klein, en concevant dès le départ le sujet comme une scène d'affrontement entre objets partiels, le mauvais et le bon étant l'un et l'autre incorporés, a radicalisé cette façon de voir. On notera toutefois que c'est finalement le bon qui, de dépassement des clivages en réparations, sort victorieux. Une cure réussie est celle qui assure l'intégration du bon sein, de la bonne mère. et de la bonne interprétation. On pourrait dire que l'enfant kleinien, s'il est d'abord voué au péché originel, tout animé qu'il est de pulsions destructrices, finit par être « délivré du Mal ». Question le Mal peut-il être assimilé au mauvais? Le Kakon suffit-il à le définir? Une dialectique de l'inclusion et de l'exclusion suffit-elle à l'appréhender? Freud et l'expérience analytique rendent possible une autre approche. Déjà dans les Trois Essais c'est bien ce quifit scandale Freud avait montré que les productions les plus nobles de l'esprit humain et les dépravations les plus répugnantes proviennent de la même source, que le criminel et l'artiste, la monstruosité et le génie sont frères. La pulsion sexuelle ignore l'opposition du bien et du mal, l'Abirrung (le mot n'a pas le sens péjoratif de notre « aberration ») est ce qui la caractérise. Et si elle est au-delà du bien et du mal, c'est qu'elle est elle-même, pourrait-on dire, le mal du vital: sa perversion, sa toxine, son cancer. L'invention des démons, supposés personnifier et incarner le mal, et celle du démoniaque, sa figure culturelle en Occident, ne vise- t-elle pas à confondre mal et sexe, ce qui laisserait la place libre à un pur amour d'où tout risque de perversion serait exclu ? Certains analystes (Robert Stoller notamment) ont cru pouvoir désigner la présence réalisée du Mal dans la perversion et le pacte délibéré du pervers avec lui haine, avilissement, anéantissement de l'autre, déguisés en érotisme. Mais une telle prise de position qui fait un sort réaliste à l'intuition du poète (« La volupté unique et suprême de l'amour gît dans la certitude de faire le mal ») ne conduit-elle pas à idéaliser une bonne sexualité, comme d'autres se font les apôtres d'une « bonne société » ? Toute dénonciation du Mal ne soutient-elle pas un retour subreptice du Mal dans la férocité surmoique? On voit que c'est tout le champ de la psychopathologie qui pourrait être abordé à partir d'une réflexion psychanalytique sur le Mal: la perversion que n'épuisent pas ses formes sadiques et masochistes et qui n'est pas seulement transgression de la Loi mais profanation (voir Bataille); la paranoïa et la persécution; la névrose obsessionnelle et la faute, la dette à payer; mais aussi la méchanceté (« le méchant, disait Sartre, est celui qui a besoin de la souffrance des autres pour se sentir uploads/Management/ le-mal-gallimard.pdf
Documents similaires





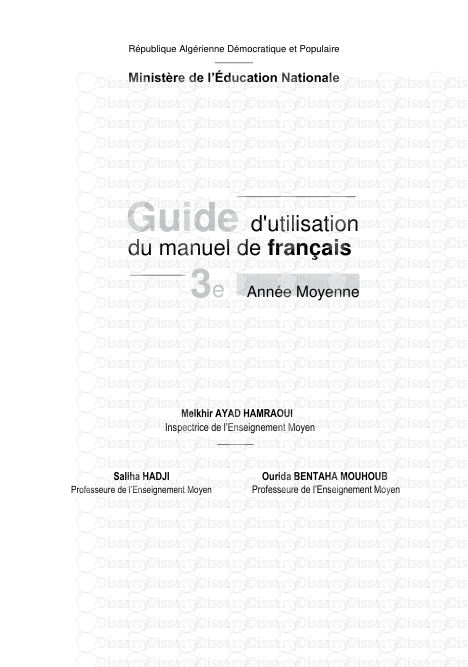




-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 30, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 15.8416MB


