MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE DIRECTION DE L'EDUCATION DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU M. BOUZAR, M. BARA et M. KAIS, IEN de français Document soumis à débat Prise en charge de la production de l’écrit MISE EN PLACE D'UNE DEMARCHE La compétence de production de l’écrit est une des principales compétences de base de l’enseignement de la langue française au secondaire. En effet, la majorité des séquences visent un objectif de production écrit. A cet effet, l’apprentissage de l’écriture est pris en charge durant toute la durée de la séquence. (Cf. Document sur la production de l’écrit). Prise en charge de la production de l’écrit dans la séquence : Lors de l’élaboration de son plan de formation, l’enseignant inventorie les aspects du discours à étudier, autrement dit, les caractéristiques spécifiques du genre discursif attendu à la fin de la séquence. Ces aspects, ou ces caractéristiques, deviennent autant d’objectifs d’apprentissage qui seront pris en charge durant les diverses séances de compréhension de l’écrit durant lesquelles ils seront mis en exergue à travers des activités de métacognition. Certains de ces objectifs, notamment les faits de langue jugés importants, feront l’objet de manipulations et d’un réemploi partiel, sous forme de situations d’intégration. Ils constituent des moments d’évaluation formative. L’enseignant inscrira également, dans son plan de formation (canevas de séquence), les quatre séances dédiées à la production de l’écrit et qui se déclinent comme suit : 1. Première séance : Sa place dans la séquence A début de la séquence, après le lancement du projet et de l’évaluation diagnostique pour l’objet d’étude. Exceptionnellement pour l’année en cours, la négociation du projet est supprimée. Objectifs de la séance Il s’agit de mettre l’apprenant face à une situation problème durant laquelle il mobilisera ses acquis antérieurs. Ces acquis n’étant pas suffisants pour résoudre le problème, on provoquera chez-lui un conflit cognitif qui permet de mettre en place des conditions favorables à l’apprentissage. (Cf. Guide d’accompagnement du programme de 1e AS, p.4). Cette production de départ, ou pré-test, servira à l’enseignant pour récolter des informations qui lui permettront d’opérer des régulations adéquates à son plan de formation initial, sous forme de dosages ou de régulations. Il évaluera également la capacité de l’apprenant à comprendre la consigne et s’y conformer comme il évaluera le degré de précision de ses propres consignes. Comment préparer la séance ? Dans son plan de formation, l’enseignant élabore le sujet inducteur sous forme d’une situation d’intégration. Il veillera à préciser de façon claire à toutes les composantes de la situation de communication. Celle-ci doit répondre sans équivoque aux questions : Qui ? A qui ? De quoi ? Comment ? Pourquoi ? (Cf. Guide d’élaboration des sujets du baccalauréat) Comment se déroule la séance ? L’enseignant fixer au tableau les intitulés de la séance dont l’objectif. Il donne oralement les orientations nécessaires : gestion de la double feuille, mode d’organisation, durée de l’activité… Puis, il porte au tableau le sujet inducteur, sans aucune autre forme d’explication. Enfin, il ramasse les copies des élèves à la fin du temps imparti et ce, même si l’élève n’a pas terminé. Que faire des copies des élèves L’enseignant, chez-lui, procède à une lecture ciblée de quelques copies pour : - Identifier les acquis des élèves. - Identifier les lacunes récurrentes de tout ordre. - Préparer des activités de remédiation pour résoudre les problèmes identifiés et les insérer dans son plan de formation. Les copies des élèves seront gardées chez-lui, elles leur seront resituées ultérieurement. 1 2. Deuxième séance : Sa place dans la séquence Cette séance intervient à la fin de la phase de compréhension de l’écrit. Objectifs de la séance Cette séance qui constitue un bilan de la phase précédente, dans la mesure où elle s’inscrit dans la logique de rappel de tout ce qui aura été réalisé, vise à élaborer, avec les élèves, une grille d’évaluation efficace. Cette grille critériée sera déclinée en indicateurs pertinents, accessibles à tous et suffisant pour déceler les lacunes de tout genre dans une production. Cette grille contiendra donc des critères et indicateurs généraux, propres à tout type d’écrits (forme, langue…) et des critères spécifiques, propres au type d’écrit attendu (Organisation, ressources…) La réussite de cette grille est primordiale dans la mesure où elle détermine, à elle seule, la réussite des séances à venir. En effet, une grille réussie permet à l’élève de jauger ses acquis, comme elle permet à l’enseignant de fixer des objectifs de remédiation pertinents. Comment préparer la séance ? L’enseignant ayant inventorié tous les aspects du discours attendu lors de l’élaboration de son plan de formation peut les résumer sous forme d’une grille ou d’un aide-mémoire. Il formulera également de façon claire les objectifs de la séance qu’il déclinera pour l’élève sous forme de consignes. Comment se déroule la séance ? L’enseignant reprend le sujet inducteur qu’il analyse avec ses élèves. Ensuite, il leur propose des critères (Forme ou mise en page, organisation ou structure et contenu, langue…) qu’il demande aux apprenants de décliner sous forme d’indicateurs, en se basant sur ce qui a été réalisé précédemment, lors des différentes séances de compréhension de l’écrit. Il complète la grille au fur et à mesure des réponses obtenues. Au cours de la mise en commun, il s’assurera de la lisibilité de la formulation des indicateurs proposés, de leur pertinence et de leur globalité. Il doit veiller à l’emploi de termes usuels et à ne pas recourir aux termes savants. A la fin de la séance, les élèves recopieront la grille sur leur cahier. Que faire de cette grille ? Elle sera reprise lors de la séance suivante. 3. Troisième séance : Sa place dans la séquence Elle s’inscrit dans la suite logique de la séance précédente sauf si l’enseignant choisit de la faire précéder d’une séance de remédiation qui prend en charge des besoins recensés et qui peuvent s’avérer importants. Objectifs de la séance Permettre à l’apprenant d’appréhender ses nouveaux progrès à travers l’identification de ses lacunes de départ, grâce au travail de son enseignant ; lui donner l’opportunité d’améliorer sa production initiale en y intégrant ses nouveaux apprentissages. Comment préparer la séance ? L’enseignant, dans son activité prépédagogique, formulera de façon claire les objectifs de la séance qu’il déclinera, pour l’élève, sous forme de consignes. Il s’agit pour l’élève d’appliquer la grille d’évaluation à sa production de départ, d’y souligner les passages lacunaires et de procéder à sa réécriture en l’améliorant. Que faire des copies obtenues ? Les productions obtenues feront l’objet d’une évaluation par l’enseignant, à l’aide de la même grille. Il y mentionnera ses observations en positivant les efforts entrepris et en mettant en relief les 2 éventuels progrès à faire. Il y choisira, également, la copie qui fera l’objet d’une évaluation collective et d’une amélioration lors de la séance ultérieure. 4. Quatrième séance : Sa place dans la séquence Cette séance clôt la séquence. Elle constitue l’une des deux séances observées lors de l’examen du CAPES. Objectifs de la séance - Coévaluer une production d’un tiers à l’aide d’une grille d’évaluation. - Réécrire et améliorer la production en ciblant les passages lacunaires retenus. Comment préparer la séance ? L’enseignant, après avoir évalué les copies des élèves à l’aide de la grille d’évaluation, choisit celle qui présente des lacunes au niveau des critères spécifiques. Ces lacunes retenues, qui doivent être partagées par l’ensemble, sinon, par la majorité des apprenants, sont soumises au critère de faisabilité lui-même déterminé par : Le niveau des apprenants. La difficulté de la tâche à accomplir. Le temps imparti à la séance. Elles deviennent ainsi des objectifs pour la séance. Enfin, l’enseignant réécrit la production choisie qu’il expurgera de toutes les autres erreurs, notamment les erreurs de langue qui feront l’objet d’une remédiation ultérieurement. C’est ce texte, expurgé de certaines erreurs qui fera l’objet d’une co-évaluation et d’une co-amélioration. Comment se déroule la séance ? L’enseignant fixe au tableau l’objectif de la séance et procède à un bref rappel du sujet. Il propose ensuite aux apprenants des activités qui permettent d’atteindre progressivement cet objectif. Quelles activités proposer ? Activité 1 : (Indiquer le mode d’organisation et la durée) Objectifs : - Lire la copie, à l’aide de la grille, pour identifier les erreurs qu’elle contient. - Souligner les erreurs ou passages lacunaires et les mettre en relation avec le numéro de l’indicateur concerné sur la grille. Mise en commun : Mettre en commun rapidement les réponses pour arrêter collectivement les indicateurs défaillants. Activité 2 : (Indiquer le mode d’organisation et la durée) Objectif : - Procéder à l’amélioration des passages lacunaires en proposant des corrections adéquates. Mise en commun : Ecouter les propositions des différents groupes, négocier les réponses et valider celles qui auront recueilli le « consentement » des autres groupes et celui de l’enseignant, en les portant progressivement au tableau. Remarques : 1. Si des erreurs persistent, l’enseignant, par le truchement de questions pertinentes, guidera uploads/Management/ mise-en-place-d-x27-une-demarche-en-production-de-l-x27-ecrit.pdf
Documents similaires








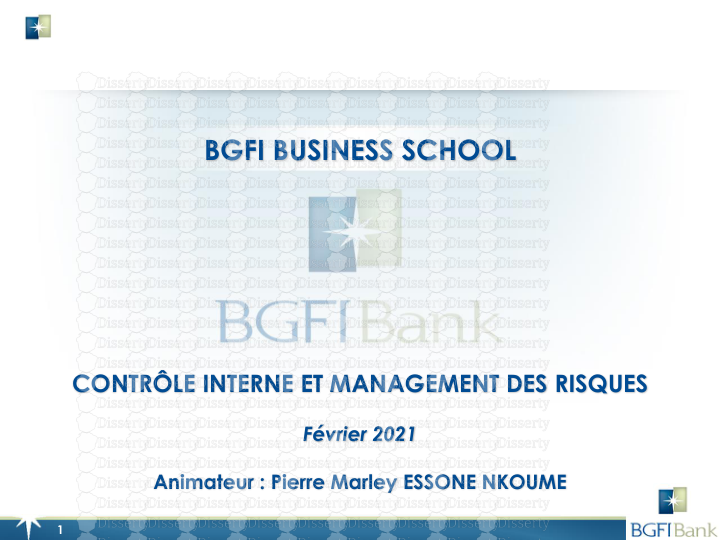

-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.1759MB


