Cahiers de l'APLIUT Pour une sociolinguistique de l’emprunt lexical : l’exemple
Cahiers de l'APLIUT Pour une sociolinguistique de l’emprunt lexical : l’exemple des emprunts français en anglais Jean-Marc Chadelat Résumé L’objet de cette contribution est d’illustrer un point de vue sociolinguistique sur des emprunts. Contrairement aux conceptions classiques de l’emprunt linguistique qui n’accordent au processus qu’une place périphérique, on espère montrer que l’optique sociolinguistique permet d’éclairer différemment le fonctionnement du signe en parole et dans le discours. On s’appuiera sur quelques emprunts français en anglais afin de montrer que la valeur linguistique de ces signes étrangers au sein du système emprunteur est subordonnée aux fonctions secondaires de communication qui dessinent une différenciation sociolinguistique des groupes sociaux et des locuteurs. Abstract Plea for a sociolinguistic approach of lexical borrowing : french loanwords in english The object of this article is to illustrate a sociolinguistic viewpoint on foreign loanwords. As opposed to common conceptions of linguistic borrowing according to which this process plays only a secondary role, this contribution aims at showing a different functioning of loanwords in speech and discourse through a sociolinguistic approach. A few French loanwords in English are mentioned as examples of the subordination of the linguistic value of such foreign signs within the borrowing language to secondary functions of communication. These functions outline a sociolinguistic differentiation of social groups as well as individual speakers. Citer ce document / Cite this document : Chadelat Jean-Marc. Pour une sociolinguistique de l’emprunt lexical : l’exemple des emprunts français en anglais. In: Cahiers de l'APLIUT, volume 15, numéro 4, 1996. pp. 16-27; doi : https://doi.org/10.3406/apliu.1996.985 https://www.persee.fr/doc/apliu_0248-9430_1996_num_15_4_985 Fichier pdf généré le 22/03/2019 16 Les Cahiers de l’APLIUT volume XV • n° 4 • juin 1996 ISSN 0248-9430 POUR UNE SOCIOLINGUISTIQUE DE L’EMPRUNT LEXICAL : L’EXEMPLE DES EMPRUNTS FRANÇAIS EN ANGLAIS Jean-Marc CHADELAT ENS de Cachan / IUFM de Créteil Mots-clés : Emprunt lexical, valeur d’usage, valeur d’échange, prestige sociolinguistique, fonction expressive, fonction poétique, fonction métalinguistique, métanorme, code, communication. Résumé : L’objet de cette contribution est d’illustrer un point de vue sociolinguistique sur des emprunts. Contrairement aux conceptions classiques de l’emprunt linguistique qui n’accordent au processus qu’une place périphérique, on espère montrer que l’optique sociolinguistique permet d’éclairer différemment le fonctionnement du signe en parole et dans le discours. On s’appuiera sur quelques emprunts français en anglais afin de montrer que la valeur linguistique de ces signes étrangers au sein du système emprunteur est subordonnée aux fonctions secondaires de communication qui dessinent une différenciation sociolinguistique des groupes sociaux et des locuteurs. PLEA FOR A SOCIOLINGUISTIC APPROACH OF LEXICAL BORROWING : FRENCH LOANWORDS IN ENGLISH Jean-Marc CHADELAT ENS de Cachan / IUFM de Créteil Key words : Lexical borrowing, value of employment, exchange value, sociolinguistic prestige, expressive function, poetic function, metalinguistic function, metanorm, code, communication. Abstract : The object of this article is to illustrate a sociolinguistic viewpoint on foreign loanwords. As opposed to common conceptions of linguistic borrowing according to which this process plays only a secondary role, this contribution aims at showing a different functioning of loanwords in speech and discourse through a sociolinguistic approach. A few French loanwords in English are mentioned as examples of the subordination of the linguistic value of such foreign signs within the borrowing language to secondary functions of communication. These functions outline a sociolinguistic differentiation of social groups as well as individual speakers. Les Cahiers de l’APLIUT volume XV • n° 4 • juin 1996 ISSN 0248-9430 17 Les Cahiers de l’APLIUT volume XV • n° 4 • juin 1996 ISSN 0248-9430 POUR UNE SOCIOLINGUISTIQUE DE L’EMPRUNT LEXICAL : L’EXEMPLE DES EMPRUNTS FRANÇAIS EN ANGLAIS Jean-Marc CHADELAT ENS de Cachan / IUFM de Créteil * Le problème de la valeur linguistique des emprunts lexicaux L’emprunt lexical a traditionnellement une triple valeur au sein du système récepteur : une valeur d’usage (il comble une lacune), une valeur linguistique (la valeur oppositive saussurienne) et une valeur stylistique (il offre un choix expressif). Ainsi chauffeur en anglais désigne-t-il un type d’employé, s’oppose-t-il à driver à peu près de la même manière qu’il s’oppose à conducteur en français et exprime-t-il enfin des connotations et des effets de sens sociaux. On pourrait ainsi conclure à un équilibre de l’utilisation de l’emprunt étranger par un acte de parole individuel entre son insertion dans le système et sa désignation d’un référent. C’est la conception qu’a notamment exprimée MEILLET tandis que MACKENZIE, compilateur de plus de 3 000 emprunts français et anglais, a voulu montrer l’histoire des contacts matériels et culturels entre les deux notions, et que L. CHIROL a vu dans les 2 400 emprunts français en anglais contemporain l’expression d’un mythe de la francité. Cette double conception mythique et référentielle des emprunts français en anglais nous semble insuffisante pour plusieurs raisons et l’on peut se demander quelles sont la valeur et les fonctions de ces mots étrangers en répondant aux questions qui se posent à leur sujet : 1. Les emprunts français sont-ils les marqueurs sociolinguistiques d’appartenance à tel ou tel groupe de la société anglaise selon leur utilisation et leur usage, leur degré d’assimilation et la conscience que les locuteurs en ont ? * ENS, 61 avenue du Président Wilson, 94230 Cachan. 18 2. Quelle est l’attitude des locuteurs anglais face aux emprunts français et la situation linguistique des mots français vis-à-vis de la norme formalisée par les dictionnaires ? 3. Comment, enfin, articuler la valeur linguistique de ces emprunts à leur impact sociolinguistique en réconciliant distinctions sémantiques et stylistiques et différenciations sociales ? L’approche sociolinguistique de l’interférence lexicale Contrairement à une idée fort répandue, le monde est globalement plurilingue et de très nombreux locuteurs parlent deux, trois ou davantage de langues qui s’influencent réciproquement. Ce plurilinguisme se traduit par le fait que les langues sont constamment en contact, que le point d’application en soit l’individu, le groupe ou bien la communauté toute entière. Or le résultat de ces contacts est un objet d’étude qui fait intervenir d’autres critères que les facteurs purement linguistiques dans la mesure où il postule l’utilisation plus ou moins consciente d’éléments étrangers par des locuteurs divers. L’interférence lexicale, que l’on peut définir comme le remaniement de certains domaines du vocabulaire d’une langue emprunteuse par introduction d’éléments étrangers, est le type de contact le plus fréquent et le plus significatif socialement. L’emprunt de mots varie d’autre part de la simple captation d’un signifié étranger facilitée par la ressemblance entre signifiants (par exemple générer au lieu d’engendrer pour produire des résultats, ou bien introduire un sujet pour aborder un sujet) à l’emprunt d’un signe étranger à proprement parler comme surf en français ou chauffeur en anglais. L’emprunt de mots étrangers, que l’on attribue souvent au désir de combler une lacune linguistique en important à la fois la chose et le mot nouveaux, ou bien au fait de négliger la recherche parfois difficile d’un équivalent dans la langue emprunteuse, n’est d’ailleurs pas un processus homogène. Un terme étranger emprunté peut, avec l’usage, être plus ou moins assimilé au système phonologique ainsi qu’aux paradigmes morphologiques de la langue emprunteuse. Mais il peut au contraire comme dans le cas des mots français en anglais, conserver son caractère étranger. Le mot anglais voyage est un ancien emprunt français assimilé au plan phonologique tandis que l’expression française voyage à Cythère conserve toutes les marques (graphiques et phonologique) de sa francité. Les divers degrés d’intégration phonologique et sémantique des emprunts étrangers ne sont pas d’autre part liés au seul critère linguistique du moment d’introduction. Le mot français contemporain garage introduit au début du 20e siècle en anglais est ainsi en passe d’être totalement intégré notamment dans certains dialectes (General American par exemple) tandis que l’emprunt moyenâgeux bon voyage n’a pas subi la moindre assimilation après six siècles d’utilisation au sein du système emprunteur. Le degré d’assimilation d’un emprunt étranger n’est cependant pas laissé à l’arbitraire et à la fantaisie des locuteurs. Car à la différence de l’interférence lexicale qui est un fait de 19 parole individuelle ayant pour résultat l’introduction de mots au destin incertain, l’emprunt est un fait de langue qui met en jeu la collectivité linguistique tout entière. Les emprunts assimilés sont ainsi adoptés par l’ensemble de la communauté de locuteurs tandis que les mots étrangers restent l’apanage de certains groupes. L’usage de mode est tout autre que celui de fashion, synonyme anglais du premier, lui aussi d’origine française (façon) mais non perçu comme tel. Les raisons collectives de l’assimilation d’un emprunt intégré ou de la marginalisation d’un emprunt étranger, de même que les domaines lexicaux affectés principalement par l’interférence ne sont pas uniquement justiciables d’une approche linguistique. La fonction référentielle de communication traditionnellement attribuée au code linguistique néglige trop souvent des fonctions diverses liées aux conditions de production du discours et à la stratégie des locuteurs. Les emprunts étrangers illustrent d’autant mieux cette stratégie énonciative de la part des locuteurs qu’ils font souvent double emploi avec des termes du fonds lexical de la langue receveuse et qu’ils ont une signification sociale tout autant que linguistique. Les fondements socioculturels de la valeur des emprunts français en anglais L’usage des emprunts français en anglais se uploads/Management/ pour-une-sociolinguistique-de-l-x27-emprunt-lexical-l-x27-exemple-des-emprunts-francais-en-anglais.pdf
Documents similaires



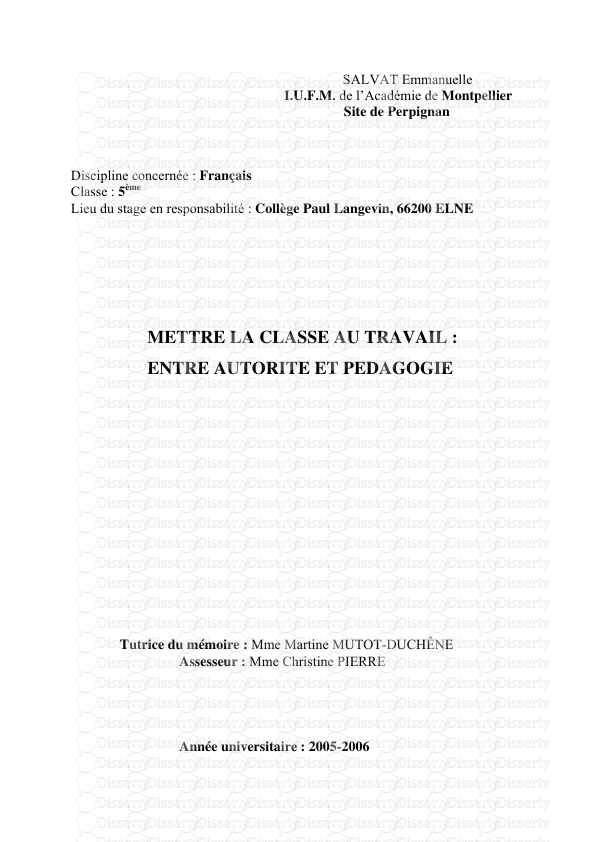






-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 30, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.2002MB


