١ INTRODUCTION Comme, nous avons lancé dans l'introduction générale de notre re
١ INTRODUCTION Comme, nous avons lancé dans l'introduction générale de notre recherche nous allons parler dans ce premier chapitre de conceptions comme la linguistique textuelle, le texte, le discours, la cohérence, la cohésion et la progression thématique. Cette démarche est justifiée par le fait qu'il nous faut une assise théorique qui sert de base pour notre étude. 1-1- Linguistique textuelle L'un des travaux le plus important est l'oeuvre de Jean Michel Adam qui constitue de ses propres travaux un dossier complexe de génétique textuelle dont un point de départ serait la linguistique textuelle, il l'a définis comme une théorie de la production co-textuelle de sens qu'il est nécessaire de fonder sur l'analyse des textes concrets, démarches que J. M. Adam nomme «analyse textuelle des discours». La linguistique textuelle étudie une langue non pas mot à mot ou sur des phrases séparées, mais dans un contexte sémantique étendue de plus en plus, Adam situe résolument la linguistique textuelle dans le domaine plus vaste de l'analyse du discours. Mais tournant tous (autour de l'étude de production transphrastique orale ou écrite dont nous cherchons à comprendre la signification sociale. J. M. Adam renonce à la décontextualisation et à la dissociation entre (texte) et (discours). C'est pourquoi la linguistique textuelle au croisement de la grammaire des textes, de l'analyse du discours et de la stylistique, entre science du langage et stylistique littéraire et entre science du langage et science littéraire et entre science du langage et science de l'information et de la communication. La linguistique textuelle ( depuis son émergence dans les années 1950) et l'analyse du discours se sont développées de façon autonome sans se situer l'une par rapport à l'autre souligne Jean Michel Adam, postulant à la fois une séparation et une complémentarité des tâches et des objets de la linguistique textuelle comme un sous-domaine du champ plus vaste de l'analyse de la pratique discursive. J. M. Adam propose de placer son approche sous double parrainage : ٢ La translinguistique des textes, des oeuvres d'E. Benveniste et la métanlinguistique de M. Bakhtine. Contrairement à la grammaire de texte, la linguistique textuelle ne se revendique pas de l'épistémologie générativiste. Elle ne se présente pas comme une théorie de la phrase étendue au texte, mais comme une translinguistique qui, à côté de la linguistique de la langue rend compte de la cohésion et de la cohérence des textes (voir Adam : 2005, 345-346). Dans l'archéologie du savoir (Foucault 69) M. Foucault montre qu'une phrase ne devient unité de discours (énoncé) que on relie cet énoncé à l'autre au sein de l'inter discours d'une formation sociale, puisque l'inter discours déstabilise l'opposition entre le contexte, J. M. Adam estime qu'une redéfinition de cette notion est indispensable, car elle n'est convoquée en linguistique que lever les ambiguîtés l'auteur souligne que le contexte n'est pas externe mais partie prenant de toute interprétation et qu'il implique une mémoire discursive dont font partie de propositions énoncées dans une autre partie du texte (cotexte ou dans un texte antérieur. 1-2- texte et discours L'analyse grammaticale s'effectue le plus souvent dans le cadre de la phrase. Or, divers phénomènes linguistiques ne peuvent pas être complètement expliqués si l'on reste dans ces limites. Il est nécessaire d'élargir la perspective et de se placer dans le cadre du texte, défini comme un ensemble organisé de phrases. Ainsi, l'emploi et la concordance des temps concernent souvent l'ensemble du texte, rarement des phrases isolées. La référence des pronoms anaphoriques dépend aussi du contexte large: pour interpréter il dans il chante, le récepteur doit se reporter à un segment de texte antérieur ou parfois ultérieur (MarƟn Riegel : 2009 : 1017). Le texte, unité de base de la grammaire transphrastique est un objet empirique oral ou écrit. Il est distingué du discours produit d'un acte d'énonciation dans une situation d'interlocution orale ou écrite. Le texte et le discours ont été longtemps traités séparément : alors que la grammaire de texte se limitait au départ à la structuration interne du texte, l'analyse du discours prenait en compte les conditions de ٣ production du texte, c'est-à-dire la situation d'énonciation et les interactions sociales. Cependant, il est difficile d'analyser le fonctionnement d'un texte sans tenir compte des traces linguistiques de sa producƟon ( Van Dijk : 1977: 177-207). Par exemple, les pronoms déictiques (comme je dans J'accuse de Zola) ne peuvent s'interpréter qu'en fonction de la situation d'énonciation. Et, inversement, l'analyse des textes peut servir d'appui à l'analyse des discours, notamment, quand il s'agit de construire une typologie des discours. Au fond, la grammaire de texte et l'analyse du discours traitent le même objet, d'une manière complémentaire : la linguistique textuelle est un sous domaine du champ plus vaste de l'analyse des pratiques discursives Adam ( 2005 : 19). On peut maintenir aujourd'hui la disƟncƟon entre texte et discours pour des raisons d'ordre méthodologique. L'analyse du texte s'attache alors à son organisation sémantique globale : d'une part, aux relations de continuité et rupture entre les propositions pour rendre compte de son unification et, d'autre part, à sa segmentation en différentes séquences textuelle, dans une perspecƟve typologique (Adam 2005). L'analyse du discours intérgre cette approche dans un cadre plus vaste en mettant le texte en rapport avec ses conditions de productions et en le traitant dans le cadre des interactions sociales et des formations socio – discursives ( Adam 2005 : 31). En somme, c'est sur le contexte que s'appuie pour une grande part la disƟncƟon texte/discours. A la suite de D. Slakta (1975), J. M. Adam (1990: 23), pose une distinction de la façon suivante: Discours = texte +condition de production. Texte = discours – condition de production. Il circule une polysémie sur la notion du texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus sur sa définition. En effet, certains limitent son application au discours écrit, c'est un (ensemble fini d'énoncé écrits, qui constituent un discours suivi et un tout spécifique, correspondant à une constante dans la situation de leur production) ( R. Galisson : 1976 : 562) D'autre linguistes conçoit le texte comme une série de ٤ phrase, alors que certains y voient un synonyme de discours, comment nous pouvons l'entendre dans ''le sens de texte aquivaut à celui de ''corpus'' de ''discours'' (ibid, p. 5633). Ainsi, nous allons préciser l'acception dans laquelle nous employons la notion de texte. Celle-ci sera envisagée sous deux dimension qui sont: 1-2-1- Une dimension communicative Le texte comme le précise J. P. Cup (2003 : 236) est considéré comme une unité de communication qui véhicule un message organisé (oral ou écrit). C'est l'ensemble des énoncés parlés ou écrits produits par un sujet dans le but de constituer une unité de communication. Cependant M. A. K. Halliday & R. Hassan (1976: 236) empruntent Cependant M.A.K. Halliday une autre orientation en définissant le texte non seulement comme unité grammaticale et occurrence communicationnelle mais aussi comme une unité sémantique ils avancent que : un texte n'est pas simplement un enchaînement de phrases. Il est préférable de le considérer non pas comme une unité grammaticale de grande taille, mais plutôt comme unité d'une autre nature : une unité sémantqiue. L'unité qu'il a une unité de sens dans un contexte donné, une texture qui exprime le fait qu'il appartient dans son ensemble à l'environnement dans lequel il est placée. En ce sens, nous remarquons que le texte, en tant qu'unité sémantique a une relation d'interdépendance avec son contexte ou (la situation de sa production). C'est précisement ce qu'explique D. Ahmed Hamid Mohammed (2009 : 63) en citant la définiƟon de J.P. Bronckart (1996 : 73 -74) : « La notion de texte peut s'appliquer à toute production verbale située, qu'elle soit orale ou écrite. Un dialogue familier, un exposé pédagogique, un mode d'emploi, un article de quotidien, un roman, etc., constituent autant de textes, de tailles éventuellement différentes, mais qui sont néanmoins dotés de caractéristiques communes: chaque texte est en relation d'interdépendance avec les propriétés du contexte dans lequel il est produit: chaque texte exhibe un mode déterminé d'organisation de son contenu ٥ référentiel: chaque texte est composé de phrases articulées les unes aux autres selon des règles compositionnelles plus ou moins strictes: chaque texte enfin met en oeuvre des mécanismes de textualisation et de prise en charge énonciative destinés à lui assurer sa cohérence». Selon cette explication, le texte se définit non seulement en décrivant ses caractéristiques de la situation de production et de l'effet qu'il exerce éventuellement sur ses lectures ou interprétations. Dans ceƩe perspecƟve et comme le note J. M. Adam (1990 : 23) n'existe pas de texte qui peut être produit par un seul système fonctionnel de la langue ( au sein restreint de mise en linguistique ). En d'autres termes, la langue n'est jamais le seul système sémiotique à l'oeuvre dans une suite linguistique car d'autres codifications sociales, le genre notamment, sont à mise en jeu dans toute communication verbale. En somme, le fait qu'un texte est composé d'unités linguistiques articulées les unes aux autres n'implique pas sa signification soit la somme des uploads/Management/ research.pdf
Documents similaires

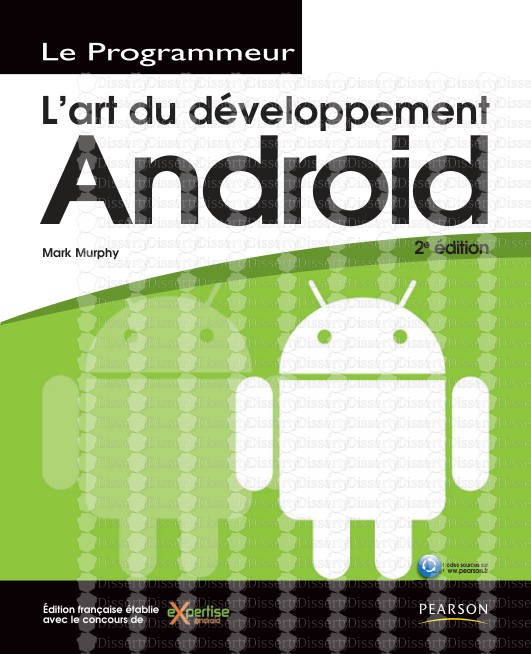








-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 25, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.3788MB


