1 LA CONCURRENCE Master I Droit des Affaires 2018/2019 Droit Economique Réalisé
1 LA CONCURRENCE Master I Droit des Affaires 2018/2019 Droit Economique Réalisé par : SERRAFI Salma ZEMRAN Othmane BENCHEQROUN Moncef Encadré par : Mme BOUIRI Bouchra 2 la concurrence: SOMMAIRE : INTRODUCTION: A. Les principes généraux de la concurrence: 1) Principe de la liberté des prix: a) De la liberté des prix au niveau national. b) De la liberté des prix au niveau international. 2) Les pratiques anticoncurrentiel : a) La lutte contre les cartels et les ententes. b) La repression des abus de position dominante. 3) Les operations de concentration. B. Le conseil de la concurrence : 1) Les pouvoirs et mission du conseil de la concurrence : a) Les pouvoirs consultative et contentieuse. b) Les mission du conseil de la concurrence. 2) Les procédures devant de conseil de la concurrence : a) La saisine du conseil de la concurrence et ses effets. b) Le déroulement de la procédure contentieuse. 3) les rapports entre le conseil de la concurrence et le juge. 3 INTRODUCTION : Dès qu’on évoque des agents économiques, entreprises ou autres qui offrent des qualités différentes de biens ou de services prêts à être consommables, on évoquera systématiquement la notion de la concurrence. En effet celle-ci, en tant qu’un facteur stimulant l’économie du marché, favorise la satisfaction du consommateur ainsi que ses besoins renouvelables et ceci en créant la compétitivité, élément primordial pour un marché qui bouge vers le meilleur et le bien du consommateur. La notion de concurrence telle que reconnue par le droit est avant tout l’expression d’une liberté. En matière d’économie, c’est une forme d’organisation sociale des relations où domine un problème d’égalité des positions dans la relation économique entre celui qui offre et celui qui demande. En dépit de ce qu’elle offre au consommateur, la concurrence peut dans certains cas être de la théorie. Par cette définition, les opérateurs économiques sont donc libres de définir leur politique de prix en fonction de leur stratégie commerciale. L'objectif est de laisser le marché réguler de lui-même le niveau des prix des produits et services, via le jeu de l’offre et de la demande. La concurrence permettant d'offrir au consommateur le plus grand choix de produits et de services au meilleur prix possible. Selon Montesquieu « c’est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises et qui établit les vrais rapports entre elles ».1 Dans la suite d’Adam Smith et Montesquieu, la concurrence « nouvelle discipline » est un concept fondamental de la tradition libérale, elle contribue à stimuler l’esprit d’entreprise et la productivité en favorisant l’adaptation permanente entre l’offre et la demande, à faire baisser les prix et à améliorer la qualité des biens et services, l’efficience économique et l’innovation. Le droit de la concurrence regroupe l’ensemble des règles qui ont pour finalité la préservation de la liberté effective concurrence entre agents économiques sur le marché, et fixe l’ensemble des dispositions visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce droit n’est pas juvénile au contraire il a vu le jour bien longtemps, le pionnier de la politique de la concurrence est la France par l’apparition de la notion de la concurrence en droit français grâce au : ➢ décret d’Allard des 2 et 17 mars 1791 portant sur la liberté du commerce et de l’industrie. Il assure aux entrepreneurs l’exercice individuel, et de ce fait libre, de leur activité. ➢ la loi de chapelier du 14 et 17 juin 1791 qui interdit le retour des corporations c’est-à- dire la constitution de tout groupement, susceptible d’entraver cette liberté de l’individu. Ensuite les Etats Unies par l’adoption du texte législatif « Sherman Act »en juillet 1890 relatif aux comportements d’entente et de position dominante, car le continent Américain est marqué à la fin du XIX siècle par concentration industrielle donnant naissance à des véritables géants dans 1 De l'esprit des lois (édition 1871) – Montesquieu. 4 les secteurs tels que les pétroles, la sidérurgie ou l’industrie électrique. Le même mouvement se produit beaucoup plus tard en France puisqu’il fallut attendre le décret du 09 Aout 1953 pour voir apparaitre un premier dispositif, encore très limité, de maintien et de rétablissement de la concurrence. Ensuite la reconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté de la concurrence par le droit français, et au 19ème siècle l’apparition des règles juridiques pour encoder la liberté de la concurrence. C’est ainsi que le droit de concurrence a émergé au niveau international et a pris place primordiale au niveau mondial et surtout à l’échèle européen par l’évocation de différents traités, il s’agit du traité de Rome du 25 mars 1957 a donné naissance au droit communautaire de la concurrence , l’objectif premier du traité est l’institution d’un marché commun avec une politique qui implique la suppression des obstacles aux échanges économiques entre les Etats membres ,la libre circulation des marchandises et des personnes, et le libre échange vient avant la concurrence. Notamment au Maroc, le droit de concurrence a subi un progrès extravagant et énorme, se caractérisant par un caractère spécifique et original, sa genèse a été influencée par différentes sources de droit. D’un coté l’influence du droit musulman dont le Maroc reste particulièrement marqué, les deux sources fondamentales de la charia n’ont pas manqué de se prononcer sur le sujet : le coran a mis en exergue l’obligation de loyauté qui pèse sur le commerçant au bénéfice du consommateur dans plusieurs sourates. La sunna est également riche de renseignement dans la mesure où le prophète Mohammed a donné des directives précises dans ses hadits, il a interdit le monopole car il conduit à la hausse des prix et à la dégradation du pouvoir d’achat. Il a interdit de s’accaparer les denrées dont les gens ont besoin pour entrainer des pénuries sur le marché et imposer un prix injuste qui a des répercussions néfaste sur les membres de la société. ➢ D’un autre coté l’influence du droit occidental. L’acte d’Algésiras de 1906 institue dans ce sens le régime de la liberté du commerce au Maroc au profit des ressortissants des pays signataires. Pendant le protectorat, le législateur n’a pas fait référence au principe de libre concurrence, il se limitait à réprimer par quelques dispositions dans des textes éparpillés les atteintes à la concurrence déloyale. A l’indépendance, le Maroc adapte sa réglementation en fonction de son contexte économique, la loi 008-71 du 21 Chaabane 1391 (12.10.1971) représente la phase dirigiste et ne traite ni du monopole, ni des concentrations économiques, le mouvement des concentrations économiques suivait les mesures de régulation de l’économie nationale. En effet, la loi 008-71 sur la réglementation, le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises est une loi qui pose la réglementation des prix comme étant la règle. Ainsi, l’art. 1er et 3 de cette loi dispose que : « les prix de tout service, marchandise ou produit peuvent être réglementés à tous les échelons de la commercialisation, ils sont fixés par le Premier ministre ou les autorités déléguées à cet effet sur proposition du ministre de la compétence duquel relève la marchandise, produit ou service et après avis du comité économique inter ministériel »2. 2 Article 1er et 3 de la loi 08-71 relative au droit de la concurrence et la liberté des prix. 5 Indépendamment de la réglementation des prix, la loi impose leur publicité pour informer le consommateur et non pour le contrôle qu’effectue l’Etat. Toutefois, l’art 5 de la même loi3 impose l’affichage des produits réglementés ou non des marchandises ou produits exposés ou mis en vente. Par ailleurs, elle prévoit trois sortes d’infractions, on cite tout d’abord l’infraction de majoration illicite des prix (Donner de fausses informations pour troubler l’ordre public économique) qui sont des infractions qui varient selon que le prix est réglementé ou non, ensuite l’infraction assimilée à la majoration illicite des prix et enfin l’infraction de stockage clandestin (sous la loi 06-99). En 1973 lors du processus de modernisation du droit marocain des affaires, certaines activités incitaient les sociétés marocaines à la concentration dans ces secteurs, en 1989 le secteur public cède aussi certaines activités dont il détenait le monopole, sauf que là, on incite les marocains comme les étrangers à la concentration économique dans ces secteurs cédés. La constitution de 1996 a posé le principe de la liberté d’entreprendre (art 15)4, ainsi le nouveau code de commerce de 1996 a constitué l’un des piliers fondamentaux de la réforme du droit des affaires et a annoncé, puis a été suivi par la loi de 1997 instituant des juridictions de commerce. Les lois sur les sociétés de 1996 et 1997 ont également adopté un cadre juridique plus adapté à l’économie avec notamment de nouveaux organes de direction. Le législateur marocain manifestait ainsi sa confiance dans les vertus du marché, sans exclure cependant toute régulation volontariste de celui-ci, il a donc mis en place la loi n° 06-99 du 5 juin 2000, ayant posé un nouveau cadre juridique organisant la liberté des prix et uploads/Marketing/ droit-de-la-concurrence 6 .pdf
Documents similaires
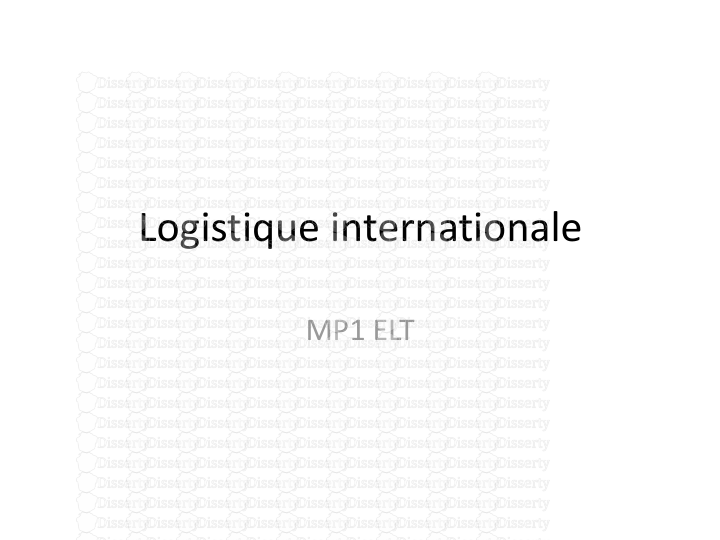









-
45
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 16, 2022
- Catégorie Marketing
- Langue French
- Taille du fichier 0.5477MB


