ARISTOTE EN NOUVELLE PERSPÉCTIVE NOTE INTRODUTOIRE ET CHAPITRE I Traduit du Por
ARISTOTE EN NOUVELLE PERSPÉCTIVE NOTE INTRODUTOIRE ET CHAPITRE I Traduit du Portugais (Brésilien) par Denise Faure NOTE PRÉLIMINAIRE À LA PREMIÈRE ÉDITION DE UNE PHILOSOPHIE ARISTOTÉLICIENNE DE LA CULTURE Le premier des textes qui composent ce petit ouvrage circule entre mes élèves sous forme de polycopié depuis 1990 et le second depuis 1992. Ensemble, ils résument une idée que je développe dans mes cours depuis 1987 : l'idée que, dans la philosophie d'Aristote, la Poétique, la Rhétorique, la Dialectique et la Logique (Analytique), fondées sur des principes communs, forment une science unique. Présenter au grand public en format de livre, si petit et si modeste soit-il, une opinion tellement contraire aux tendances qui dominent, depuis des siècles, l'interprétation de l'oeuvre d'un grand philosophe exigerait un exposé complet, précis et accompagné d'une démonstration exhaustive. Ce n'est pas le cas du présent ouvrage. L'idée est ici présentée en condensé, étayée uniquement par une indication très générale des lignes de démonstration qui conviennent (1). Non que cette idée soit encore en germe dans l'esprit de l'auteur : elle a été exposée dans son intégralité et dûment démontrée dans mes cours, enregistrée sur bandes magnétiques et transcrite sous forme de textes polycopiés (2). Une vie anormalement agitée, qui ne rappelle en rien l'image idéalisée du paisible chercheur (3) entouré de ses livres, que le sujet de ce livre pourrait suggérer au lecteur, ne m'a pas permis de donner à ce matériel une forme adéquate et définitive. Voilà pourquoi je me suis vu un jour devant l'obligation de choisir entre publier en abrégé provisoire mon interprétation de la philosophie d'Aristote ou bien attendre qu'un esprit futé, de ceux qui forment un bon tiers ou un quart de notre population lettrée, l'ayant entendue dans l'un de mes cours ou l'une de mes conférences, ou peut-être même la tenant de la bouche de quelqu'un qui en aurait vaguement entendu parler, s'empresse de la présenter comme sa très personnelle et très originale découverte. Car je n'ai pas fait que découvrir cette chose, je lui ai aussi consacré, par la suite, quelques années supplémentaires de ma vie, lui donnant d'amples applications pratiques dans le domaine de la pédagogie et de la méthodologie philosophique, applications que, s'il pouvait les voir, le maître Stagirite ne renierait point, du moins me plaît-il de le croire. Et, sans vouloir garder la couvée au nid, je ne vais tout de même pas l'abandonner au premier épervier venu. Voilà pourquoi, simplement pour en sauvegarder la primauté, j'ai pris la décision de publier ce condensé qui, si de par sa brièveté n'est pas entièrement satisfaisant, ne pèche pas - me semble-t-il - par défaut d'imprécision ou quelque grave lacune et sert d'introduction à un développement ultérieur qui ne saurait tarder, avec l'aide de Dieu Rio de Janeiro, août 1994. CHAPITRE I. LES QUATRE DISCOURS (4) Il y a, encastrée dans l'œuvre d'Aristote, une idée médullaire qui a échappé à presque tous ses lecteurs et commentateurs, de l'Antiquité à nos jours. Ceux qui l'ont perçue - et que je sache ils n'ont été que deux au cours des millénaires (5) - se sont limités à la noter en passant, sans lui attribuer explicitement une importance décisive pour la compréhension de la philosophie d'Aristote. Elle est pourtant la clef de cette compréhension, si par compréhension s'entend l'acte d'appréhender l'unité de pensée d'un individu à partir de ses intentions et de ses valeurs personnelles au lieu de le juger de l'extérieur ; acte qui demande que l'on respecte scrupuleusement tout le non-dit et le sous-entendu au lieu de l'étouffer dans l'idolâtrie du texte-objet, tombeau de l'esprit. C'est à cette idée que je donne le nom de Théorie des Quatre Discours. On peut la résumer en une seule phrase : le discours humain est une puissance unique qui s'actualise de quatre façons différentes : poétique, rhétorique, dialectique et analytique (logique). Exprimée ainsi, l'idée ne semble pas digne de remarque. Mais s'il nous vient à l'esprit que les noms de ces quatre modalités de discours sont aussi les noms de quatre sciences, nous serons en mesure de voir que, dans cette perspective, la Poétique, la Rhétorique, la Dialectique et la Logique, qui étudient les modalités d'une puissance unique, constituent également les variantes d'une science unique. La diversification en quatre sciences subordonnées doit elle-même se fonder nécessairement sur la raison de l'unité de l'objet qu'elles étudient, sous peine de manquer à la règle aristotélicienne des divisions. Et cela signifie que les principes de chacune d'elles présupposent l'existence de principes communs qui les subordonnent, c'est à dire qui s'appliquent de la même manière à des domaines aussi différents que la démonstration scientifique et la construction de la trame d'une pièce tragique. C'est alors que l'idée que je viens d'attribuer à Aristote commence déjà à nous sembler bizarre, surprenante, extravagante. Et deux questions nous viennent immédiatement à l'esprit : est-ce qu'Aristote a réellement pensé ainsi ? Et, s'il l'a fait, avait-il raison de le faire ? La démarche se dédouble donc en une recherche historico-philologique et en une critique philosophique. Je ne pourrai, dans le cadre de cet ouvrage, réaliser ni l'une, ni l'autre. En revanche, je peux chercher à comprendre les raisons de l'étonnement que cette idée provoque. Si l'idée des quatre discours peut choquer, au premier abord, c'est qu'il existe dans notre culture l'habitude invétérée de considérer le langage poétique et le langage logique ou scientifique comme deux univers séparés et éloignés, régis par des ensembles de lois incommensurables entre eux. Depuis qu'un décret de Louis XIV est venu séparer "Lettres" et "Sciences" (6) en deux édifices différents, le fossé entre imagination poétique et raison mathématique n'a pas cessé de se creuser, jusqu'à devenir une espèce de sacro-sainte loi constitutive de l'esprit humain. Ces deux cultures, comme les a appelées C. P. Snow, évoluant comme des parallèles qui s'attirent ou se repoussent mais jamais ne se rencontrent, se sont établies en deux univers étanches, incompréhensibles l'un pour l'autre. Gaston Bachelard, poète doublé de mathématicien, a cru pouvoir décrire ces deux ensembles de lois comme les contenus de sphères radicalement séparées, chacun également valable à l'intérieur de ses propres limites et dans ses propres termes, entre lesquels l'être humain transite comme de l'état de sommeil à l'état de veille, s'abstrayant de l'un pour entrer dans l'autre et vice versa (7) : le langage du rêve ne conteste pas celui des équations, ni celui-ci ne pénètre dans le monde de celui-là. La séparation a été si profonde que d'aucuns ont voulu lui trouver un fondement anatomique dans la théorie des deux hémisphères cérébraux, l'un créatif et poétique, l'autre rationnel et ordonnateur, et ont voulu voir une correspondance entre cette division et le couple yin-yang de la cosmologie chinoise (8). Allant plus avant, ils ont pensé découvrir, dans la prédominance exclusive de l'un de ces hémisphères, la cause des maux de l'homme occidental. Une version un tant soit peu mystifiée de l'idéographie chinoise, divulguée dans les milieux pédants par Ezra Pound (9), a donné à cette théorie une respectabilité littéraire plus que suffisante pour compenser son manque de fondement scientifique. L'idéologie du "Nouvel Âge" l'a finalement consacrée comme l'un des piliers de la sagesse (10). Dans ce tableau, le vieil Aristote représentait, en compagnie de l'exécrable Descartes, le prototype du bedeau rationaliste qui, règle en main, maintenait sous sévère répression notre chinois intérieur. Un public imprégné de ce genre d'opinions ne peut que se récrier d'indignation devant l'idée que j'attribue à Aristote. En effet, elle présente comme apôtre de l'unité celui que l'on avait accoutumé de considérer comme le gardien de la schizophrénie. Elle conteste une image stéréotypée que le temps et une culture d'almanach ont érigée en vérité achevée et vient fouiller d'anciennes blessures cicatrisées par une longue sédimentation de préjugés. La résistance à l'idée est, donc, un fait accompli. Reste à l'affronter en apportant la preuve, en premier lieu, que l'idée est bien d'Aristote et, en second lieu, que c'est une excellente idée qui mérite d'être reprise, avec humilité, par une civilisation qui, avant que de les avoir bien examinées, a un peu trop vite mis au rancart les leçons de son vieux maître. Je ne pourrai, dans le cadre de cet ouvrage, qu'indiquer brièvement dans quelles directions rechercher ces preuves. Aristote a écrit une Poétique, une Rhétorique, un livre de Dialectique (les Topiques) et deux traités de Logique (les Premiers et les Seconds Analytiques), ainsi que deux oeuvres d'introduction sur le langage et la pensée en général (les Catégories et De l'Interprétation). Toutes ces oeuvres, ainsi que les autres oeuvres d'Aristote ont pratiquement disparu de circulation jusqu'au I° siècle avant Jésus- Christ, époque où un certain Andronicus de Rhodes organisa une édition d'ensemble qui constitue jusqu'à aujourd'hui la base de notre connaissance d'Aristote. Comme tout éditeur d'oeuvres posthumes, Andronicus s'est vu dans l'obligation de donner un certain ordre aux manuscrits. Il décida d'adopter, comme base de cet ordre, le critère de la division des sciences en sciences introductrices (ou logiques), théorétiques, pratiques et techniques (ou poïetiques, comme certains préfèrent les appeler). Cette uploads/Philosophie/ aristote-en-nouvelle-perspective-frances.pdf
Documents similaires








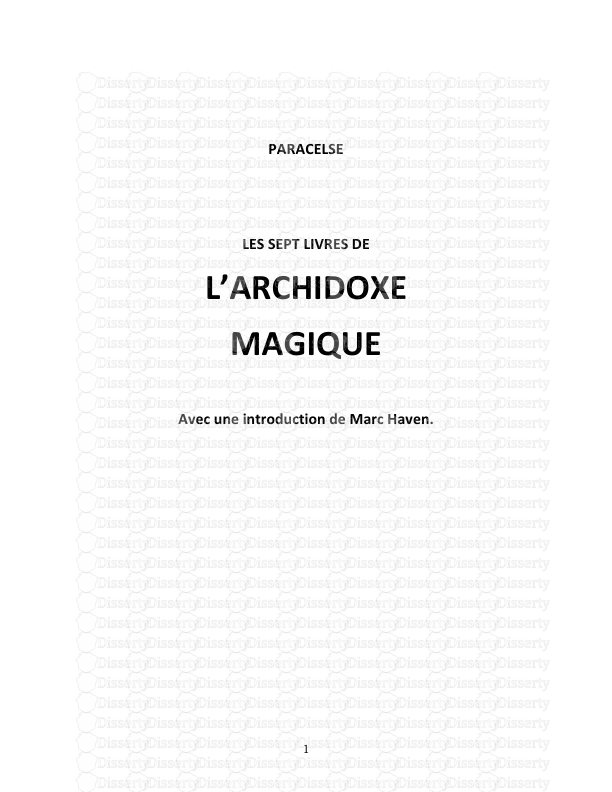

-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 13, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0927MB


