SOCIOLOGIE Lire le texte de GUY BAJOIT du recueil pour le 25/09. A. INTRODUCTIO
SOCIOLOGIE Lire le texte de GUY BAJOIT du recueil pour le 25/09. A. INTRODUCTION: Qu'est-ce que la sociologie, et... "A quoi sert-elle? La sociologie date du 19ème siècle mais tout le monde ne la conçoit pas de la même manière. Robert Nizbet a réfléchi aux conditions de sa naissance. Elle est née dans le sillage de 2 révolutions à savoir les révolutions démocratiques et les révolutions industrielles. Ces 2 mouvements ne sont pas étrangers à la possibilité même qu'émergent les sciences sociales. La vérité nous est donnée dans les sociétés traditionnelles. Cette conception de la connaissance se transforme avec les lumières. Avant cela, il y a des représentations de la société mais le mot "société" n'existe pas. Les lois changent et nous devons les voter. Celle-ci rentrent dans une logique d'auto- fondation. Nous faisons nos lois à partir de débats, de la démocratie et du vote. Michel Foucault parle d'une transformation du rapport à la connaissance. La thèse Nizbet est de dire que les sciences sociales ne pouvaient pas émerger sans ces grandes mutations qui sont liées à l'industrialisation et ces bouleversements sociaux. Les sociologues sont des conservateurs qui sont interpellés par la modernisation, l'individualisation,... Comment nos sociétés vont tenir avec ces grands bouleversements? Il y a eu des influences des sciences dures et des philosophes. Les sciences sociales émergent entre les deux. Les sociologues proposent des modèles de conception du monde. Aujourd'hui, on prend les phénomènes sociaux comme objet. Exemple: l'amour---> on étudie les ressorts sociaux de la mise en couple. Les gens se marient avec les personnes de leur origine sociale. Exemple: la déviance--->elle peut être point de vue psychologique. La sociologie va voir cela comme un phénomène social. B. LE TRAVAIL SOCIOLOGIQUE Concept = terme qui résume une idée synthétique et abstraite. Le but des concepts est de synthétiser un ensemble de phénomènes sous une boîte conceptuelle qui une fois définie permet aux sociologues de s'exprimer. Il faut être d'accord sur ce que l'on va mettre comme contenu dans cette boîte. Les sciences sociales sont validés car il y a un consensus dans la communauté scientifique. ex: concept de déviance---> ce concept est vu différemment d'un courant à l'autre. Paradigme = grande conception de la réalité sociale. Conception fondamentale de ce qu'est la réalité sociale. Théories = ensemble de raisonnements qui articulent plusieurs concepts pour expliquer un phénomène social. C. PRINCIPES DE LA DEMARCHE DE LA SOCIOLOGIE (Luc Van Campenhoudt) 1ère règle : expliquer le social par le social---> on s'intéresse aux couples, la famille par exemple via le social. 2ème règle : la rupture épistémologique---> c'est l'idée que l'on a tous nos idées sur la vie sociale pour construire l'explication sociale. Il faut faire rupture avec les idées que l'on a de la vie sociale. Ne pas avoir de préjugés. Il faut se donner des connaissances sur le type de garanties que l'on produit. 3ème règle : expliquer et comprendre les phénomènes sociaux--->phénomène de causalité et de compréhension. 4ème règle : la connaissance de soi (connaître, c'est se connaître). La position sociale que l'on occupe fait que l'on est un acteur social positionné avec une histoire. Il faut apprendre à relativisé par rapport à ses propres conceptions. Tous sociologues est situé quelque part et donc la démarche scientifique est de sortir de l'ethnocentrisme (=chaque groupe social partage un certain nombre de valeurs). Sinon, on risque de parler par rapport à nos propres histoires. Il faut prendre de la distance par rapport aux jugements moraux. 5ème règle : le sociologue doit considérer toute manière de vivre comme "normale". Tout acteur social qui fait quelque chose a une raison de le faire. Il faut comprendre les raisons d'agir des individus. Il faut mettre entre parenthèse les jugements quels qu'ils soient. Il y a des significations sociales qui permettent de comprendre les phénomènes. 6ème règle : le but du sociologue est de comprendre les phénomènes sociaux. 7ème règle : il faut s'affranchir des catégories de pensée instituées. ex: catégories politiques--->le décrochage scolaire est un phénomène social. Il est lié au fait qu'on est institué l'obligation scolaire jusque 18 ans. Avant, l'Etat ne s'en préoccupait pas. D'où actuellement, il y a une préoccupation de l'Etat de comment ré- accrocher les élèves à l'école---> construction de catégories instituées. ex: statistiques nationales---> dans certains pays, on doit cocher notre groupe ethnique afin d'avoir des données sur les ménages---> construction de catégories instituées. 8ème règle : idée d'historiciser les évolutions sociales. Les phénomènes sont construits différemment au fil des époques. Avoir un regard historique permet de mieux comprendre le présent. Il y a 3 usages de la sociologie: - sciences pour les sciences (produire des connaissances); - expertise (liée au pouvoir politique); - critique sociale (action de légitimation). La sociologie et les sciences sociales sont souvent convoquées par le Politique pour faire des études sociologiques. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être sociologue et les usages que l'on va en faire vont être différents. Guy BAJOIT : "Pour une sociologie relationnelle" Bajoit fait l'hypothèse que les conceptions du social sont associées aux idéologies politiques de notre société. L'objectivité absolue n'existe pas. Il faut être conscient des présupposés que l'on défend, ne pas être naïf. C'est une sorte d'honnêteté intellectuelle. Les 4 paradigmes sont le fruit de 2 grandes questions: - Comment l'ordre social se maintient-il? *ordre social harmonieux; *ordre social traversé par des conflits, des grosse tensions. - Comment s'opère le changement social dans les sociétés? *le changement se fait par de grands basculements-->sociologie structurelle (1ère colonne); *le changement se fait pas à pas au fil des négociations-->sociologie centrée sur les acteurs individuels et collectifs (2ème colonne). Le paradigme de l'aliénation (EUX) Marx-->théorie de la révolution (le communisme) Le Marxisme repose sur la domination des classes sociales par la bourgeoisie sur la classe dominée qui sont les ouvriers. Le mode de production détermines les classes sociales. Dominants<--------------->Dominés (Bourgeoisie) (Ouvriers) Pour le Marxisme, il n'y a pas de changement sans révolution. L'ordre social est une macro structure organisée en lien avec le système de production qui crée les classes sociales. L'ordre social tient par l'aliénation (processus d'idéologie), à savoir la manipulation des classes. Pour Marx, il faut une élite éclairée pour faire prendre conscience au peuple qu'il est manipulé et qu'il doit se révolter. Le principe essentiel est que les classes sociales ont leur place dans le système de production. Les dominants ont le monopole des moyens de production. Dans sa vision, l'histoire est faite par des grandes ruptures de modèles de production. Chaque fois qu'il y a un changement de mode de production, il y a un changement d'époque. L'ordre social est verrouillé-->dominants et dominés. Le paradigme du fonctionnalisme (ON) Durkheim E.-->théorie de la modernisation (le nationalisme) L'acteur social est conformiste. La vision de la société est harmonieuse et tout s'enchaîne. Tout élément de la société (famille, école, entreprise, partis politiques) jouent un rôle. Exemple : fonction de la famille-->inculquer les valeurs qui sont le ciment de notre société. Ce paradigme insiste sur l'ordre. Dans ce cas-ci, on partage tous les mêmes valeurs qui se traduisent par des normes (ex: éducation, comportement, modèles d'autorité). Ces normes vont socialiser la société. Si on ne respecte pas les normes, on devient déviant. Pour les fonctionnalistes, chaque position sociales à sa place. Ce courant est défendu par des sociologues conservateurs qui insistaient sur l'ordre et l'harmonie. Le paradigme du conflit (NOUS) A. Touraine-->théorie des mouvements sociaux (le socialisme) Ce paradigme est centré sur les acteurs sociaux. Il reconnaît la conflictualité sociale liée à des intérêts dans le système de production, des valeurs. Il y a une insistance sur la capacité de changement et la capacité collective des acteurs. Touraine met l'accent sur le fait que l'on peut se battre pour défendre de nouvelles valeurs. Il dit que l'ordre sociale tient car il y a des conflits. Il a travaillé sur le mouvement ouvrier qui sont des acteurs qui organisent leurs conflits de classes. Les dominants ont aussi leurs visions de la société. Le modèle industriel oppose des acteurs sociaux qui définissent le bien dans cette société industrielle. Pour Touraine, il y a dans chaque société un conflit pour les enjeux de la société industrielle. Il se demande : aujourd'hui, qui sont les acteurs collectifs qui s'opposent? Le modèle de Touraine est le conflit entre acteurs collectifs. Sa vision du monde est une société conflictuelle qui lutte pour la définition d'enjeux sociaux. (ex: qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de mouvements de chômeurs?) NOUS = symbolise les significations collectives. Les paradigmes de la 2ème colonne sont nés de la critique des paradigmes de la 1ère colonne. Le paradigme du MOI de R. Boudon-->théorie de la compétition (le libéralisme économique) Pour Boudon, il n'y a que des acteurs individuels qui vont se mettre dans un espace social qui est un jeu où l'on négocie. La vie sociale est le fruit de cette négociation entre acteurs. L'acteur est vu individuellement et pas collectif. Il agit selon son propre intérêt. C'est une sociologie du consensus, l'ordre social va uploads/Philosophie/ cours-de-sociologie.pdf
Documents similaires
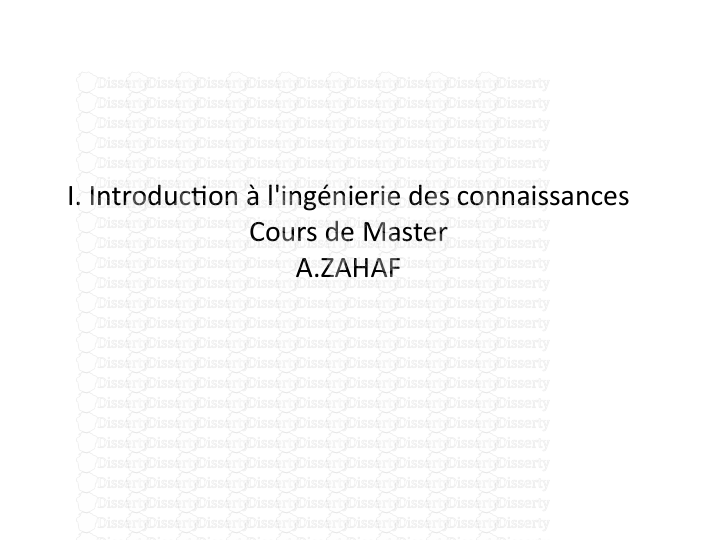









-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 23, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1447MB


