Tous droits réservés © Anthropologie et Sociétés, Université Laval, 2016 Ce doc
Tous droits réservés © Anthropologie et Sociétés, Université Laval, 2016 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 10 avr. 2021 15:49 Anthropologie et Sociétés De résonances phénoménologiques dans le monde chinois Corps, personne, monde et mouvement dans des expériences taoïstes et du qìgōng About Phenomenological Resonances in the Chinese World Body, Person, World and Movement in Taoist and Qìgōng Experiences Resonancias fenomenológicas en el mundo chino Cuerpo, persona y movimiento en las experiencias taoístas y del qìgōng Évelyne Micollier Phénoménologies en anthropologie Phenomenologies in Anthropology Fenomenologías en antropología Volume 40, numéro 3, 2016 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1038639ar DOI : https://doi.org/10.7202/1038639ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Département d’anthropologie de l’Université Laval ISSN 0702-8997 (imprimé) 1703-7921 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Micollier, É. (2016). De résonances phénoménologiques dans le monde chinois : corps, personne, monde et mouvement dans des expériences taoïstes et du qìgōng. Anthropologie et Sociétés, 40(3), 161–185. https://doi.org/10.7202/1038639ar Résumé de l'article Des expériences taoïstes et du qìgōng (氣功, maîtrise, art du qì) – expériences du corps, du développement de la personne et de cultivation de soi, religieuses et thérapeutiques – résonnent avec des approches phénoménologiques, plus particulièrement avec la phénoménologie de la perception. Hérité de connaissances et de techniques à la croisée des chemins des arts martiaux, thérapeutiques et religieux dans le monde chinois, le qìgōng est une constellation d’expériences modernes (il a émergé au début XXe siècle) et contemporaines (se situant à l’ère de la réforme économique post-1979). Ses formes multiples aux variantes infinies dessinent une configuration complexe aux implications sociales et politicoreligieuses qui permettent de le définir aussi comme une pratique sociale. Situées entre théories de la connaissance et études d’expériences, comment les phénoménologies en anthropologie peuvent-elles nourrir la discussion sur les phénoménologies locales dans un échange réciproque transdisciplinaire entre philosophie, ethnologie et études aréales ? L’article est organisé en deux parties : l’une porte sur des aspects de la phénoménologie en philosophie et en anthropologie en lien avec des résonances dans le monde chinois ; l’autre se focalise sur ces résonances avec l’exemple d’expériences du qìgōng entrelacées à des expériences taoïstes. Anthropologie et Sociétés, vol. 40, no 3, 2016 : 161-185 DE RÉSONANCES PHÉNOMÉNOLOGIQUES DANS LE MONDE CHINOIS Corps, personne, monde et mouvement dans des expériences taoïstes et du qìgōng Évelyne Micollier Introduction Dans ce travail anthropologique, les approches phénoménologiques ouvrent sur deux horizons qui s’éclairent l’un l’autre : l’un interroge l’existence et la légitimité d’autres « phénoménologies » du monde et les points de rencontre empiriques et intellectuels avec la phénoménologie, philosophie ancrée dans l’Europe moderne ; l’autre nous plonge dans le monde taoïste et du qìgōng (氣功). L’un se reflète dans le miroir de l’autre avec des thèmes noués entre eux qui estompent les lignes : le mouvement, le corps, la personne et le monde. Sous le terme générique de qìgōng sont réunies des pratiques religieuses, martiales, thérapeutiques et sociales du corps, nous donnant à voir le corps vécu, au rythme des transformations à l’œuvre dans la société chinoise et lui donnant chair. Le qìgōng tel qu’il était pratiqué en Chine dans les années 1990 dévoilait une configuration complexe entre héritages et innovations qui n’entrait pas dans des modèles d’analyse pré-construits : il se donnait à découvrir par l’expérience du corps et l’observation participante, et transportait dans le monde chinois passé et présent (Micollier 1995)1. Expérience subjective, collective et sociale, il s’est ouvert simultanément aux institutions étatiques par son insertion dans celles du sport et de la santé, et à une sphère publique non-étatique – semi-officielle, informelle ou clandestine. Il s’est aussi immiscé dans la sphère privée, devenant alors une expérience individuelle, familiale, clanique, locale (Micollier 2004 : 107). Les enquêtes ethnographiques (observations, entretiens, récits de vie, usage et recueil de sources écrites, sonores et visuelles) ont eu lieu dans les années 1990 en Chine du sud (Canton, 1991-1992). Cependant, la circulation des maîtres et d’un certain nombre de pratiquants qui les suivaient dans leurs pérégrinations 1. Deux autres études ethnologiques conduites à la même période informent sur ce phénomène aux multiples facettes (Hsu 1999 ; Chen 2003) ; un peu plus tardivement, Palmer (2005) a évoqué la « fièvre » du qìgōng selon une lecture sociohistorique. 162 ÉVELYNE MICOLLIER invitait toujours, quel que soit le point d’origine du travail de terrain de l’ethnologue, à un voyage en Chine et parfois à l’étranger. Les matériaux ont été actualisés en 1997, 1999 et 2005. Les enquêtes à Taipei se sont déroulées en 1995, 1996, 1997 et 2005, dans une perspective comparative Chine-Taiwan. J’ai eu la chance de mener des études ethnologiques en Chine en période de « boom » du qìgōng, un succès qui a pris la forme d’un mouvement social dans les décennies 1980 et 1990. En effet, la répression sévère de la fin des années 1990, initiée en 1999 par le gouvernement chinois contre le mouvement Fǎlúngōng (法輪功), forme de qìgōng bouddhique, a mis fin à l’expérience collective, visible et médiatisée des groupes de qìgōng en Chine et a abouti à une restructuration de leurs ramifications institutionnelles. Dans les années 1980, l’engouement populaire pour les myriades de formes de qìgōng qui avaient fleuri dans les villes chinoises peut être partiellement expliqué par les déficiences préoccupantes du système de santé à la suite du démantèlement du système maoiste de médecine communautaire2, et par le mouvement de Tiān’ānmén de 1989, porteur d’immenses aspirations finalement déçues. En effet, ce mouvement avait été écrasé brutalement par les autorités chinoises. Un volet de mes recherches au long cours en anthropologie et en études chinoises porte sur les connaissances et les pratiques du corps et de la personne, un champ de recherche qui, dans mon parcours, croise, entre en synergie et interagit avec celui de la santé, de la religion et du genre de manière implicite, explicite, parfois inattendue et toujours imprévisible. La préoccupation phénoménologique n’est pas étrangère à ces points d’attachement thématiques dans la mesure où la vie quotidienne est un enchaînement d’expériences immédiates qui ne peuvent être vécues qu’à travers les sens (Merleau-Ponty 1945) révélant et produisant simultanément et de manière processuelle notre corporéité (embodiment). L’embodiment réfère aux « dimensions corporelles des êtres humains et de leur subjectivité » (Desjarlais et Throop 2011 : S9). Csordas (1990) propose la notion d’embodiment comme un paradigme pour l’anthropologie, le corps étant une entité vivante, par lequel et à travers lequel nous faisons l’expérience du monde. Avec un souci programmatique d’une anthropologie de la santé en mouvement vers l’anthropologie générale, Scheper-Hugues et Lock (1987) évoquent le corps-un en corps multiples en le déclinant en corps individuel, corps social et corps politique reliés entre eux par des émotions. Puis Lock (1993) intègre l’embodiment, dénouant et tissant à nouveau les liens, un processus qui estompe graduellement les lignes intermédiaires, esquisses de limites. Enfin, elle entremêle biologies, cultures et expériences qui vont produire ensemble les discours du corps et sur le corps (Lock 2001). La phénoménologie merleau- pontienne sous-tend à sa manière les nouvelles orientations de l’anthropologie de la santé à partir des années 1990 (Lock et Nichter 2002). 2. Les médecins aux pieds-nus mettent leurs chaussures dans les années 1980 : cette médecine rudimentaire qui assurait le minimum en soins de santé primaire dans les campagnes chinoises se privatise. De résonances phénoménologiques dans le monde chinois 163 Latour, pourtant plus inspiré dans ses travaux par Heidegger que par Merleau-Ponty, s’est aussi intéressé au corps : il propose une définition non préconstruite, ouverte et fluide de ce que signifie avoir un corps, qui permet de dépasser une « nature » du corps en essences et substances. Le corps est en perpétuel devenir, comme une interface qui devient tangible à l’épreuve de sa (re) connaissance de nombre d’éléments (humains et non-humains), et donc du temps (Latour 2004). Une telle orientation nous aide à mieux comprendre ce qu’est l’expérience fondamentale du corps : le corps est mis en mouvement par des flux d’entités qui voyagent entre intérieur et extérieur grâce à une enveloppe poreuse, interstitielle ; ce corps-interfaces influe à son tour sur ces flux, produisant ainsi un corps en perpétuel devenir parce que mu par un processus continuel de co-constitution avec l’environnement. Cette orientation donne aussi des clés pour comprendre les expériences du corps, comme la « mise en mouvements » par d’autres entités (humaines et non-humaines). Enfin, ajoutons à l’horizon la qualité d’agencéité (agency) de tous les existants ou « étants » dans une perspective holistique : Descola (2005) s’attache à analyser les relations entre les humains et les non-humains en termes d’interaction et d’interrelations plutôt que de présence ensemble dans le monde. Dans ce sens, toutes les entités partagent la qualité uploads/Philosophie/ de-resonances-phenomenologiques-dans-le-monde-chinois.pdf
Documents similaires



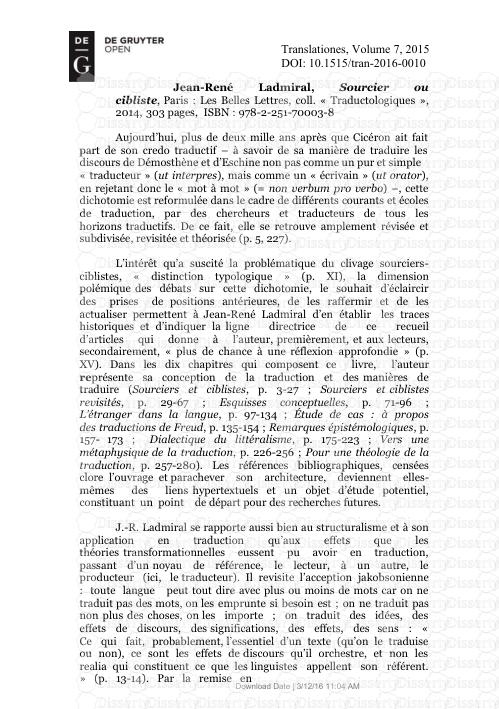






-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 25, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.9980MB


