La construction logique du texte: réflexions sur les micro-analyses de Michel C
La construction logique du texte: réflexions sur les micro-analyses de Michel Charles, par Christine Noille- Clauzade (Université Stendhal Grenoble 3) La construction logique du texte: réflexions sur les micro-analyses de Michel Charles. Dans l'éventail des micro-lectures inventées par notre modernité critique, Michel Charles a ceci de particulier qu'il a progressivement mis au point des expériences de micro-analyse textuelle qui sont, aujourd'hui encore, sans équivalent. Les propositions et les pratiques novatrices dont il a été l'instigateur ont été construites, rappelons-le, dans le séminaire E.N.S. des années 1990-1993, reprises et structurées dans l'ouvrage paru en 1995 aux Editions du Seuil, Introduction à l'étude des textes. Pour présenter en un mot ce qui fait à la fois la singularité et la force de ce travail, nous dirons que ce que Michel Charles et à sa suite, dans une moindre mesure, les participants du séminaire ont mis en place et mobilisé, c'est essayer, nous semble-t-il, de penser une logique du langage textuel. · Problème de lisibilité, problème de situation. Reconnaissons d'emblée que cette proposition ne va pas de soi, qu'elle n'a rien d'évident: d'abord parce qu'il n'existe pas de cercle, d'école, de disciples institués; ensuite parce que les acquis de la théorie de Charles publiée en 1995 sont loin d'être aisément manipulables, dominables. Théorie difficilement maîtrisable, disions-nous: nous revenons sur cette idée pour expliciter quels buts nous poursuivons en opérant sur elle une opération de clarification. Ces buts ne sont pas uniquement «communautaro-biographiques» [1] : ils visent à estimer, structurer, spécifier, valider, dans la mouvance de la philosophie du langage ordinaire, un champ de recherches, un champ de la critique littéraire, qui empiriquement nous paraît à la fois erratique (ressurgissant dans les travaux des uns ou des autres au hasard des rencontres, avec un «air de familiarité» troublant par-delà la diversité des objets) et illisible – au sens épistémologique du terme, bien évidemment [2]. Cette illisibilité peut s'appréhender à trois niveaux. 1. Récupération difficile par l'histoire littéraire. Lisibilité complexe de l'ouvrage Introduction à l'étude des textes tout d'abord: il s'agit d'un objet curieux, insituable, incité. Sans doute y a-t-il là trop d'hypothèses, des idées très élaborées, difficilement articulables. Cette difficulté, on peut mieux l'analyser si on se reporte au niveau des travaux ultérieurs que les participants du séminaire ont produits. En quoi consiste, partagée à des degrés divers, cette non-lisibilité / cette impossibilité de lire et de mémoriser ce qui est proposé? Ce sont effectivement des travaux peu cités, ou cités aléatoirement, pour d'autres raisons que liées à leurs problématiques (par exemple, il leur arrive d'être convoqués pour établir un point d'histoire littéraire, d'interprétation d'un auteur, d'histoire des genres ou des formes, etc.). Bref, ils sont citables en tant qu'ils recoupent les préoccupations de l'histoire littéraire telle qu'elle s'est empiriquement focalisée sur les questions d'auteurs, de genres, d'histoires des idées (et en particulier des idées esthétiques, des formes). Mais leur problématique générale échappe ordinairement à l'attention et au débat. 2. Contre-lisibilité idéologique. Autre façon d'appréhender cette illisibilité, on peut aussi parler d'une illisibilité doctrinale, idéologique, herméneutique. Certaines propositions émanant de ces années de séminaire et martelées dans l'ouvrage de 1995, sont en effet comme un socle commun de connaissance, communément partagé: nous pensons ici à la contestation de l'autorité du texte, de sa monumentalité, de sa cohérence d'une part, à la remise en question de la prépondérance de l'auteur et de sa situation d'autre part. Et ces propositions, reprises et répandues, ont pu être évaluées par d'autres comme une contestation idéologique des données objectives du travail critique (le texte, l'auteur, l'époque), dans la mouvance des poéticiens des années 1960-1980. Les tenants de ces positions-là seraient en quelque sorte à la traîne d'un système, des «épigones». Une telle «clef» est ainsi doublement improductive, renforçant doublement l'illisibilité, en ce qu'elle replie sur de l'idéologique des positionnements méthodologiques, et en ce qu'elle referme sur une ligne de lecture politique et institutionnelle plus ancienne (des années 1970) une constellation nouvelle d'idées et d'intérêts, qui dépassent en grande partie les débats néo- et post- structuralistes. On peut ainsi établir le diagnostic d'une faible lisibilité historique et d'une contre-lisibilité herméneutique. 3. Déception méthodologique Or, ces reproches sont à la fois connus, pris en charge par Michel Charles lui-même, et en même temps réfutés par un argument à double tranchant. En effet, la réponse voulue comme «forte» par Charles, et totalement comprise, banalisée dans les travaux ultérieurs des uns ou des autres, peut être décrite ainsi: l'«air de famille», la cohérence entre tous ces travaux se situent à un niveau méthodologique, puisque c'est une problématique méthodologique (sur laquelle nous revenons à l'instant) qui a été revendiquée et assurée par les acteurs de ce séminaire et par son responsable. L'intérêt de cette voie critique n'a pas de pertinence forte dans le domaine de l'histoire littéraire ni dans les débats structuralistes: il est dans la façon d'établir et de penser une certaine méthodologie de questionnement sur le texte. Mais c'est précisément là une ultime raison d'illisibilité. Pour qui comprend et prend au sérieux ce travail sur la méthodologie de la micro-lecture, l'impression se fait jour d'une lourdeur des pré-requis, d'un artifice digressif dans le démarrage de la lecture critique. A quoi bon autant de mises au point pour se lancer dans l'aventure d'une lecture «collée-serrée»? A l'illisibilité historique et herméneutique s'ajoute ainsi une illisibilité méthodologique. Il nous semble que ces diverses réticences pointent avec justesse et sérieux une lacune, un manque, qui prive les propositions de Michel Charles et de quelques autres d'une pleine validité: à savoir la spécification du lieu d'où elles sont «pensées». Il y a là en jeu un véritable problème de champ. Constituer, créer le champ épistémologique de cette démarche critique, c'est d'abord et en même temps permettre une lisibilité de ce champ pour tous les pôles de la critique (historique, herméneutique, textuelle…), c'est «clarifier» cette «méthodologie» critique qui a été mise en place avec Michel Charles. · Clarifier: analyse littéraire et philosophie analytique Le terme que nous employons ici est philosophiquement connoté: il renvoie globalement au mouvement intellectuel de la philosophie analytique, telle qu'elle est apparue dans les milieux autrichiens des années 1910-20 et telle s'est déployée en de multiples ramifications aux Etats-Unis, avant de revenir en force dans le champ de la pensée française. Une question est en effet au centre de l'investigation philosophique analytique: «Qu'est-ce que tu signifies avec tes énoncés?» (Manifeste du Cercle de Vienne, 1929 ). L'intérêt ici ne porte pas sur ce qu'un énoncé pris en lui-même signifie mais sur «les conditions que l'on doit reconnaître comme nécessaires pour qu'un énoncé soit doué de sens» (E. Nagel, 1938-1939 [Bibliographie]). A la question de la signification des énoncés est donc subordonnée celle des voies de la connaissance: «Comment le sais-tu?» (H. Feigl, 1931) C'est précisément cette articulation de la connaissance et du langage qui caractérise ce qu'on appelle le «tournant linguistique» [3]. Connaître et signifier sont ici les deux faces d'un problème unique, un problème de théorie de la connaissance dont la tâche demeure essentiellement clarificatrice. Ce lien entre analytique et linguistique s'est trouvé à la fois renforcé et complexifié avec un courant de la philosophie analytique, la philosophie (ou analyse) du langage ordinaire, dans la mouvance du Wittgenstein des Investigations philosophiques [Bibliographie]. Abandonnant la conceptualisation du langage «idéal» (du langage logique), les philosophes du langage «ordinaire» adoptent le présupposé suivant: il n'y a rien à corriger dans le langage ordinaire, qui est fait de nombreux usages différents, des jeux de langage aux règles adaptées à différentes circonstances. C'est cette logique du langage ordinaire qu'il convient d'approfondir (cf. les travaux de Austin ou Grice). Dans la mouvance de cette «seconde analytique», les philosophes sont conviés à réfléchir à ce lien entre logique et langage «ordinaire», à travailler sur «la dureté du mou» (Sandra Laugier, d'après Wittgenstein), c'est-à-dire sur la rigueur qui organise nos façons de parler. Les philosophes, mais aussi les littéraires. Redisons-le, c'est sur cet arrière-plan d'une analytique du langage ordinaire que prend sens notre formule selon laquelle L'Introduction à l'étude des textes nous aide à penser une logique du travail textuel et que s'inscrit notre ambition de clarifier la méthodologie commentatrice à l'œuvre dans les micro-analyses charliennes. Comment allons-nous procéder pour cette clarification? Par application de la méthodologie même qui est ici en question, nous allons opérer par dislocation du système de Charles en quelques propositions, et par construction d'un modèle de fonctionnement logique pour articuler entre elles ces propositions. Autrement dit, en mettant au point un tableau logique des hypothèses théoriques de M. Charles, nous espérons pouvoir à terme spécifier «le propre de notre critique.» · Propositions pour l'analyse des textes: une logique de formalisation. 1. Du textuel à l'énoncé: le «tournant logique». Le postulat fondamental dans la micro-lecture rhétorique selon Michel Charles est de procéder à une description raisonnée (qui est à proprement parler une construction) de la difficulté du texte [4]. Pour ce faire, Michel Charles opère en manipulant et donc en découpant préalablement des unités textuelles petites (voire très petites: nous reviendrons sur la question de la «longueur» uploads/Philosophie/ la-construction-logique-du-texte.pdf
Documents similaires








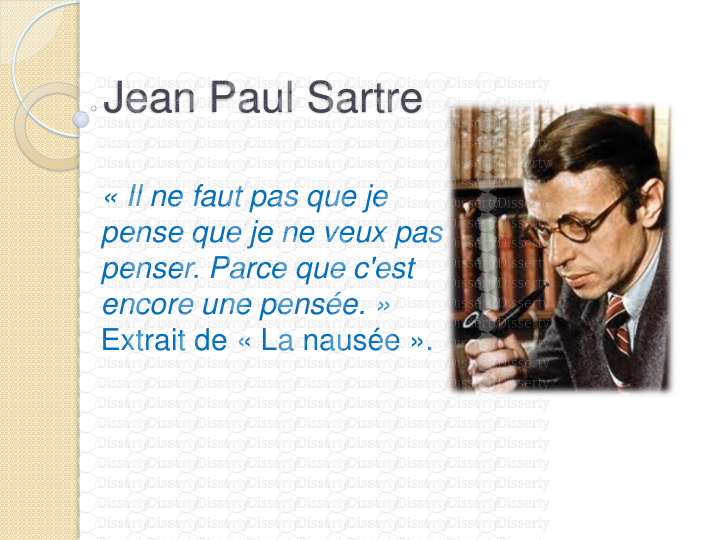

-
123
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 14, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1238MB


