GUENAIS Baptiste GUEB09058809 Bac. études cinématographiques - Platon chasse l'
GUENAIS Baptiste GUEB09058809 Bac. études cinématographiques - Platon chasse l'art imitatif en dehors de sa cité idéale. Expliquez au moins deux raisons qui motivent sa décision. Expliquez en quoi c'est l'amour qui pourra sauver l'art. Platon établit le principe de l'immortalité mais aussi de la « causa sui » de l'âme, faisant du « mouvement » son essence. Toute âme est immortelle car elle est toujours en mouvement. L'être qui se meut lui-même ne peut se manquer à lui-même, il est principe du mouvement et ne peut mourir ni renaitre, puisque dans ce cas, il ne serait plus principe. Dans le mythe du Phèdre, les âmes, après avoir contemplés la sphère des idées parfaites, retombent dans le monde matériel et s'incarnent dans les corps humains à disposition. Ainsi s'établit une hiérarchie des vies humaines en fonction de leur degré de perfection. L'âme qui n'aurait pu aller assez haut pour se « nourrir » convenablement sera ramenée dans une catégorie inférieure, alors que celle repue de vérité, de sagesse ou de beauté accédera à une existence meilleure. La nature de l'âme est décrite par une allégorie : celle d'un attelage conduit par deux chevaux, l'un bon et de bonne race (l'intellect), l'autre est le contraire du premier (le sensitif). Il est intéressant de remarquer que l'artiste (l'imitateur) et l'artisan font partie de la septième catégorie, loin derrière les philosophes, et proche des sophistes et des tyrans. Dans le Phèdre, Socrate développe l'argument de l'âne et du cheval, ou comment une supercherie visant à convaincre quelqu'un en partant de ses préjugés, de ce qu'il croit vraisemblable, peut être dangereux. Les sophistes eux-aussi utilisent ses principes en se basant sur le vraisemblable et aboutir sur des conclusions fallacieuses bien loin de la vérité. On peut mettre cet argument en parallèle avec le discours sur l'artiste, l'artisan et le dieu dans la République. En effet selon Platon, le dieu crée une forme unique par nature, que les artisans incarneront dans le monde sensible et dont les artistes imiterons un aspect particulier. L'intelligibilité de l'idée (la faculté de l'esprit par laquelle nous pouvons percevoir la sphère des idées parfaites) ne se trouve pas à l'intérieur de la chose même, elle est une règle, un patron (comme on l'entendrait en couture) car en s'inscrivant dans la matière, l'idée se voit imposer une certaine finitude. L'artiste, les yeux rivés sur le modèle sensible ne saisit que l'apparence de cet objet fini sans se rapporter à l'essence intelligible du modèle. Il imite du sensible la part qui n'est pas celle du modèle intelligible. L'artiste représente la différence d'un objet, qui apparaît différent (selon l'angle par lequel il est perçu par exemple) mais ne l'est en rien le poète, ou le peintre, ne sait rien des choses qu'il peint, ou qu'il décrit, mis à part leur apparence (ou leur vraisemblance) et manque ainsi d'aptitudes à la dialectique. Il s'éloigne de plusieurs degrés de la forme, sans qu'il y ai moyen de passer du dernier degré (imitation de l'apparence sensible) au premier (la forme intelligible). Si la vraie beauté fait partie du monde intelligible, dans la réalité sensible, et selon un principe de convenance, le bel objet est celui qui convient le mieux à son utilisation (selon un principe de convenance, seul l'utilisateur de l'objet le connaît assez bien pour permettre à l'artisan de l'améliorer). On ne peut pas remonter de l'objet de l'artiste à l'idée première, et c'est parce qu'il est vide de toute essence que l'art nous égarerait dans notre recherche de la vérité. Il est d'ailleurs bien plus facile de persuader de la vraisemblance que de faire admettre la vérité. L'art adopterait donc une position proche de la sophistique; elle serait supercherie, fausse apparence, puisque la réalité intelligible est une imitation de la réalité sensible, l'art ne serait qu'une imitation d'imitation. De plus, si l'art (du discours mais on peu effectuer le glissement pour l'art en général) n'a pas pour vocation d'instruire la jeunesse, de l'éduquer en faisant l'éloge de la vertu, mais bien la séduction de la partie « basse » de l'âme, alors il ne peut aucunement revendiquer sa place dans la cité. La seconde raison de bannir l'art de la cité prend la forme de l'argument suivant : l'art s'adresse avant tout à la partie sensible de notre esprit. Si les contradictions tiraillent l'esprit humain, elles ne peuvent venir du même mode, rationnel ou sensitif (chacun ayant sa logique interne, un mode ne peut vouloir une chose et son contraire). C'est le principe de raison dans l'âme qui préside le jugement du vrai. Si l'impératif premier est de conduire sa vie de façon rationnelle, par l'intelligence (on retrouve la volonté éducatrice des textes de Platon), l'art s'adresse d'abord à la sensibilité en jouant sur des illusions perceptives. Les sensations « décrites » au théâtre ou sur la toile ne nous touchent que parce qu'il répondent d'une certaine manière à des émotions déjà contenues en nous (par la mimésis). La sensibilité a des désirs, c'est un principe actif de l'âme, même si ces désirs ne sont pas « rationnels », et ne nourrissent pas l'âme de manière convenable. Ainsi, des comportements que nous devrions mépriser dans la vie courante, voir condamner se trouvent exaltés sur la scène ou la toile pour le plus grand plaisir de notre sensibilité. Or, aimer ce qui frappe les sens enferme le sujet dans une certaine répétition : la sensation naît, puis s'efface et il faut la réitérer. On est bien loin de la dialectique ascendante qu'entraîne l'amour du beau. Socrate, dans le Phèdre, alors qu'il prononce un discours concluant que le délire amoureux est un mal (en fait un exercice de style face à un texte de Lysias que Phèdre tient caché sous son manteau), est lui même touché par un signal divin qui lui somme de revenir sur ses propos. Car si la « maniké » contient en elle une forme de la démesure sauvage du Tyran, il en existe cependant une forme particulière qui, inspirée par le délire divin, transcende l'âme et se situe au delà de toute sagesse humaine. Si les dieux sont bons - et chez Platon ils le sont - alors ils ne peuvent également nous communiquer quelque chose de mauvais. Dans la République, il est établit que Dieu n'est pas la cause de toute chose, mais uniquement de ce qui est bon. Le délire amoureux ne s'exprime plus par la possessions de l'autre ou la jouissance des corps, c'est un désir qui cherche, par la dialectique, à s'élever au delà de la connaissance, par la contemplation, la béatitude. « Le don qui vient de dieu l'emporte sur le don qui vient de l'homme ». Il faut revenir à la nature de l'âme et à son immortalité pour mieux comprendre cet argument. Les âmes les mieux entrainées, les plus légères et les meilleures chez les hommes, lorsqu'elles remontent du monde sensible au monde intelligible peuvent parfois apercevoir incomplètement l'« Être en soi » avant d'êtres ramenées vers les corps. Ceci justifie les réminiscences de l'âme quand elle aperçoit dans le monde certaines choses qui lui rappelle ces idées immuables, des « images de la beauté divine ». Comme le sens le plus performant de l'homme est la vue, il lui est beaucoup plus facile de reconnaître la beauté que la sagesse ou la vérité. Platon ne fait pas vraiment de différenciation entre le beau et le bon (qu'il soit moral ou utilitaire comme nous l'avons déjà remarqué). L'âme, les yeux littéralement rivés sur le divin, est affranchit de ses occupations quotidiennes (même de toutes « préoccupations humaines ») en même temps qu'elle semble frappée de folie aux yeux du reste de la communauté. Ce « transport », ce délire est pourtant bon de toutes les façon. L'amant et l'aimé en arrivent à dépasser leurs personnalités propres pour accoucher ensembles de leur être intérieur (n'est-ce pas la fonction de la maïeutique ?). L'autre n'existe plus pour lui même, mais en tant qu'inspirateur de beaux gestes et de belles paroles. Un tel amour nous rapproche de la perfection divine, lui seul peut avoir pour objet le sensible et l'intelligible, et s'élever du premier au deuxième, bien qu'il ne soit perçu que par la partie rationnelle de l'âme. L'objet d'art n'est pas un accès direct au vrai. La beauté ne peut se saisir directement par la sensation immédiate que l'on fait du bel objet, et il nous faut nous en détacher. Ce n'est qu'au termes d'une longue remontée dialectique (et discursive) qu'elle se laisse entrevoir comme un attribut des idées. Puisque l'art ne possède pas de valeur par lui-même, il peut donc être instrumentalisé, au service des valeurs supérieures dans la cité (l'éducation et la loi). L'art serait jugé selon son utilité à la cité, comme n'importe quel autre objet, et doit prendre modèle sur les dieux pour ce qu'il représente, et les dieux servent de modèles aux hommes (puisqu'ils sont à l'origine de ce qui est bon). Ainsi l'art du poète ou du peintre ne peut uploads/Philosophie/ quot-platon-chasse-l-x27-art-imitatif-en-dehors-de-sa-cite-ideale-expliquez-en-quoi-c-x27-est-l-x27-amour-qui-pourra-sauver-l-x27-art-quot-philosophie-de-l-x27-art.pdf
Documents similaires






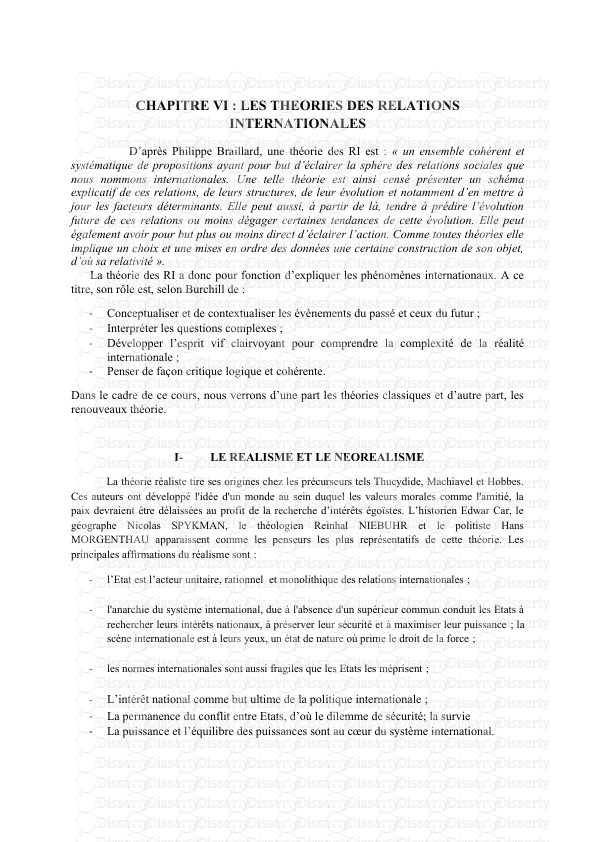



-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 04, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0592MB


