Éléments de méthodologie pour la dissertation I . L'introduction. A .L'entame.
Éléments de méthodologie pour la dissertation I . L'introduction. A .L'entame. Ce qu'il est bien de faire citation un exemple issu de l'actualité une anecdote historique à éviter «de tous temps les Hommes ... » « certains (tous les) philosophes pensent … tandis que d'autres « Le sujet nous demande si ... » quoi cela sert il s'agit d'introduire le sujet d'en montrer la pertinence de manière fluide, comme si ce sujet devenait une question nécessaire. B .La problématique La problématique ne s'arrête pas au sujet elle va structurer l'ensemble de votre réflexion dans la suite du devoir elle permet de montrer au correcteur que vous vous posez les bonnes questions elle donne un sens au sujet posé, en cherchant à dépasser son apparente évidence à faire / ne pas faire Ne pas faire 10 lignes de questions 2-3 bonnes questions valent mieux qu'un long paragraphe interrogatif les enchainer de manière logique : une question appelle la suivante Pour une dissertation, ne pas faire de plan interrogatif (réservé au commentaire) C. L'annonce du plan Montrer de manière évidente son intention Consacrer une phrase à chaque partie Ne pas hésiter à utiliser des marqueurs (chrono)logiques : « dans une premier temps ...» Détailler un minimum sans dévoiler le coeur du développement. D . En règle générale Une bonne introduction correspond à entre 1/4 et 1/10 de la taille de la copie Elle ne doit pas présenter d’éléments propres au développement. Elle doit être lisible : soit 1 seul paragraphe, soit 3 paragraphes avec alinéas qui se succèdent immédiatement Ne pas hésiter à marquer la fin de son introduction par un signe discret : * II . Le corps du texte. A .Le type de plan et le nombre de parties Pas de discrimination entre 2 ou 3 parties Il est souvent préférable d'opter pour un plan en trois parties car cela permet de sortir d'un dualisme trop apparent et de développer des idées originales. Un plan en 2 parties (type droit) n'est pas très différent, au sens où chaque sous-partie corre spond en fait à une partie sauf la dernière qui vient conclure. - Les parties doivent être explicites . découpage selon un type de question progressif . découpage selon les réponses apportées à la question (type dialectique) . découpage selon les argumen ts participant d'une même réponse (bancal). B . Les sous - parties . - Pas de nombre fixe . généralement entre 2 et 4 par partie. - 1 idée / paragraphe . pas plus, pas moins . 1 idée s'accompagne toujours d'une illustration . exemple concret et / ou théo rique - Elles s'enchainent en faisant progresser la logique de la partie globale . du plus simple au plus complexe . si même plan d'exemplification, du plus évident au moins visible . éviter les tautologies (dire 2 fois la même chose) à l'aide d'auteurs différents. Un bon choix d'auteur sera toujours plus pertinent qu'un déballage d'érudition, pour le coup souvent rapide et incomplet. - Chaque paragraphe commence par un alinéa. . on va ensuite à la ligne, sans saut de ligne, pour passer au suivant. . es t généralement construit de la manière suivante : annonce d'une idée . illustration ou recours théorique . développement . phrase rapportant l'idée à la problématique C . Les transitions . - Il faut des transitions . sans transitions, on court le risque de la juxtaposition d'idées . la transition permet de faire un bilan provisoire vis - à - vis de la problématique . elle fait ressurgir votre pensée personnelle au milieu du raisonnement - Construction d'une transition . est intégrée à la partie qu'elle achè ve . se présente comme un court paragraphe . En quelques lignes : aboutissement et conclusion partielle à laquelle aboutit la partie . problèmes et limites de cette partie . question principale soulevée, qui sera celle sous - tendant la partie suivante. - Pas de transition pour la dernière partie de la copie (se fait en conclusion générale) D . Règles générales - Plan visible dans la copie : pas obligatoire, mais souvent utile pour structurer ses idées et les rendre visibles au correcteur - Saut de lig ne entre les parties - Introduction de chaque partie : pas nécessaire (ne doit pas être redondant avec la transition) mais suit les mêmes règles de mise en forme que la transition. - La copie doit être équilibrée : entre les sous - parties, entre les par ties. E . La conclusion . - Est une introduction inversée . ne doit pas contenir d'éléments nouveaux pour le raisonnement . doit permettre de clore (temporairement) la discussion - Mise en forme . Bref retour sur les idées développées successivement vi s - à - vis de la problématique initiale . phrase de transition . ouverture vers un prolongement ou un déplacement du sujet (question indirecte, citation, fait d'actualité) - Doit correspondre à la taille d'un paragraphe de la copie. III . Règles et défauts stylistiques. - Trop de fautes = 1 point en moins. . la langue écrite est le reflet d'une pensée . agace le correcteur, q ui finit par se focaliser sur la fo rme plutôt que sur le fond - La majuscule est de rigueur pour les concepts . l'Homme, en tant que concept, n'est pas le mari de la femme... . de même pour Etat, Raison … - Ne pas faire de citations approxima tives . Toujours préciser l'auteur et l'ouvrage (voire le chapitre) . Les titres des ouvra ges se présentent soulignés (ou en italique) tandis que ceux des articles ou des chapitres doivent être entre guillemets (pas de titre de chapitre sans titre de l'ouvrage) . Le nom d'un auteur ne vaut pas citation … - Les illustrations . théoriques . art istiques . expérientielles . personnelles . Le m ieux reste de savoir jongler entre les différents registres. - L'usage des guillemets est réservé aux citations . Pour son usage personnel, il s'agit soit d'affirmer ce que l'on dit, soit de changer de terminologie. * * * Schéma - type de dissertation Introduction - Entame - Problématique - Annonce du plan I . Grande idée A. Développement 1 Idée + exemple ou théorie + analyse B. Développement 2 Idée + exemple ou théorie + analyse C. Développement 3 Idée + exemple ou théorie + analyse Transition Apport de la Grande idée au questionnement problématique du sujet + Questions sur les limites de la Grande idée + amorce de la partie suivante II . Autre grande idée A. Développement 1 Idée + exemple ou théorie + analyse B. Développement 2 Idée + exemple ou théorie + analyse C. Développement 3 Idée + exemple ou théorie + analyse Transition Apport de l ’ Autre g rande idée au questionnement problématique du sujet + Q uestions sur les limites de l ’ Autre g rande idée + amorce de la partie suivante III . Dernière grande idée A. Développement 1 Idée + exemple ou théorie + analyse B. Développement 2 Idée + exemple ou théorie + analyse C. Développement 3 Idée + exemple ou théorie + analyse Conclusion - R eprise des 3 grandes idées Nous avons vu, en définitive, … Néanmoins … Car c'est finalement … - Réponse apportée à la question initiale - Ouverture uploads/Philosophie/ renier-samuel-methodologie-de-la-dissertation.pdf
Documents similaires
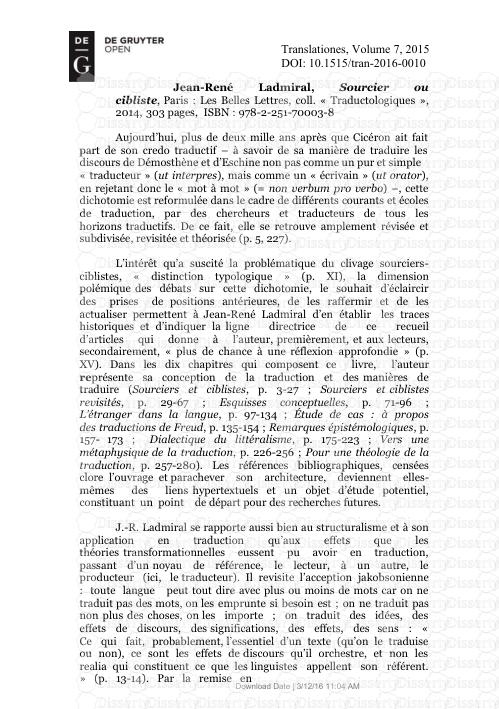









-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 18, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0623MB


