L’enfance – Prépa Scientifiques Synthèse Cinquième Partie : Méthodologie Épreuv
L’enfance – Prépa Scientifiques Synthèse Cinquième Partie : Méthodologie Épreuves d’écrit et d’oral aux concours d’entrée des Grandes Ecoles Scientifiques I. Généralités concernant les épreuves écrites Les grandes écoles publient chaque année une notice sur le fonctionnement et le contenu de chaque épreuve, mais aussi les rapports sur les épreuves des années précédentes sur le site http://www.scei-concours.fr Les épreuves durent de 3 à 4 heures, avec sur une dissertation et/ou un résumé, pour un coefficient de 4 à 17. II. Le résumé à l’écrit des concours Centrale-Supélec et CCINP A. Quels textes pour quels résumés ? Les textes sont généralement argumentatifs organisés autour d’une thèse, parfois explicatifs ou descriptifs. Votre premier travail consistera donc à qualifier l’enjeu du texte, son énonciation globale et son lien avec le thème de l’année : la structure du résumé en dépend, avec une tolérance de +/- 10% sur le nombre de mots. B. Les enjeux de l’exercice 1. Un exercice technique Grâce au résumé, le jury mesure votre aptitude à rendre compte de la pensée d’autrui, à formuler celle-ci de manière personnelle, sans modifier ni interpréter le texte, sans le tronquer ni le compléter. Le jury examine ainsi votre capacité de reproduire l’esprit du texte, mais aussi sa progression et son équilibre. 2. Un exercice de communication L’épreuve consiste aussi à savoir parfaitement manier la langue pour restituer correctement et brièvement un texte écrit par un autre que soi, et ainsi veiller à rendre compte précisément des idées développées par l’auteur. Le jury est très attentif à vos compétences en matière d’expression et de syntaxe, de lexique dense et précis. C. Méthode de travail 1. La première lecture - La première lecture se fait sans prise de notes afin de se concentrer sur le propos, le contenu et l’enjeu global. - Reformuler ensuite un résumé d’1 ou 2 phrases au brouillon afin de reconstituer une structure de référence. 2. Étapes de travail Les deux points de départ (texte et résumé synthétique) vous aideront à construire votre propre résumé. - Lire une 2nde fois pour cerner les étapes de la pensée, les logiques d’enchaînement, la dynamique du propos. - Analyser la place de chaque étape dans le cheminement des idées afin de dessiner le plan du résumé. - Reformuler ainsi les idées de manière fidèle en se basant sur le schéma obtenu et le résumé synthétique. 3. Quelques décisions à prendre - La subjectivité : se substituer à l’auteur, respecter ses choix énonciatifs (narratif, temps verbaux, lexique, …). - L’équilibre : reproduire exactement le mouvement du texte initial (répétitions, digressions, allusions, …) - Les exemples : filtrer les exemples et citations selon leur intérêt et leur importance dans le propos général - La reformulation : guidée par le bon sens et utilisée à bon escient (homonyme, synonyme, hyperonyme, …) D. Rédaction et vérification Après le travail au brouillon, recopier le résumé en choisissant une progression en plusieurs paragraphes selon la structure du texte initial avec un maximum de 3 ou 4, en veillant à reporter sur la copie le nombre exact de mots. III. La dissertation A. Enjeux de l’exercice 1. Une dissertation sur programme Vous devez montrer ici que vous avez compris les enjeux soulevés par le thème général étudié en classe), ses liens avec les œuvres, et les éléments de convergence entre ces ouvrages du programme. Par conséquent, la dissertation doit être envisagée comme l’art d’organiser vos connaissances à partir d’un problème donné. 2. Une dissertation de philosophie Le thème convoque des concepts précis à maîtriser et reconnaître dans le sujet proposé. Leur connaissance conduit à interroger correctement le sujet, à en trouver les nuances, les limites mais aussi les prolongements. 3. Une dissertation de français Les points valorisés en composition française sont : « rigueur de la conceptualisation et de la réflexion, justesse de l’argumentation, précision des exemples, correction et clarté de la langue française, goût de la culture générale » B. Le travail au brouillon : du sujet au problème Le brouillon est essentiel pour vérifier l’équilibre de vote propos et du recours aux œuvres, comme la logique progressive de la démonstration mise en place. Un tiers du temps de travail au moins doit donc y être consacré. 1. Le sujet Le sujet se compose d’une citation suivie d’une consigne. Ce sont les concepts soulevés par la citation qu’il faut mettre au service de la réflexion menée à partir du programme ; et la consigne vous demande généralement d’examiner en quoi la citation éclaire votre lecture des œuvres. Pour mieux cerner le contenu et l’enjeu de ce sujet, procédez par étapes successives, avec rigueur : - Exploration : repérer les mots clés importants structurant la citation et renvoyant au thème de l’année - Analyse : examiner les liens logiques et conceptuels articulant ces termes clés les uns par rapport aux autres - Synthèse : reformuler le sujet en 1 ou 2 phrases, montrer l’enjeu principal et les relations entre les termes clés. 2. La problématisation À partir de la citation et de sa reformulation, trouver ce qui pose problème dans le sujet, i.e. : ce que l’auteur considère comme évident mais ne correspond pas nécessairement à votre lecture des œuvres au programme. La dissertation est avant tout la mise en mouvement d’une pensée visant à élucider un problème et à donner du sens aux mots et aux concepts présents dans l’énoncé d’un sujet par une lecture complète et détaillée préalables. C. Le plan La phase de reformulation du sujet débouche sur un problème à résoudre selon un plan construit à partir d’arguments issus des textes étudiés au programme, de la connaissance du thème et exemples tirés des œuvres. Le développement est une démonstration et une argumentation visant à résoudre le problème défini au cours de l’analyse, dans un ordre logique d’exposition afin de convaincre le lecteur : énoncer les apports évidents du sujet puis les nuancer ensuite les critiquer au cours d’une analyse toujours plus approfondie des textes au programme. En fin de compte, il faut considérer que le sujet pose un problème que le développement de la dissertation résout. Le développement est donc une démonstration cohérente qui, d’argument en argument et d’exemple en exemple, conduit d’un problème posé en introduction à sa résolution présentée en conclusion. D. Rédaction de la dissertation 1. Un préalable indispensable : bien écrire L’expression étant révélatrice d’une maîtrise de la pensée, une dissertation est entièrement rédigée, sans aucun titre destiné à mettre le plan en évidence, et nécessite de maîtriser la langue française et les subtilités des termes liés au programme pour proposer un travail efficace avec un soin particulier porté à la calligraphie et l’orthographe. 2. L’introduction L’introduction est une accroche mettant en valeur le développement à venir, avec des étapes à respecter, à savoir, amorce, sujet et sa reformulation, problématique, rappel des œuvres et annonce des parties du développement : - L’amorce générale : brève (2-3 lignes) et précise, elle permet d’introduire le thème et la citation - L’énoncé intégral : reproduire la citation avec sa source, puis proposez sa reformulation - La problématique : présentée sous forme de phrase affirmative ou interrogative indirecte. - Les œuvres au programme : énumération dans l’ordre chronologique ou logique si mise en relation avec le sujet - L’annonce du plan : indication claire des pistes à explorer sans entrer toutefois dans le détail des sous-parties. 3. La conclusion La conclusion répond clairement au problème posé en introduction, elle reprend les résultats intermédiaires de la démonstration, sans résumer longuement le développement ni reproduire les titres des grandes parties, s’achève par 1 ou 2 phrases générales énonçant la réponse apportée par le programme à la question soulevée par le sujet. Elle doit permettre, après un bilan de la démonstration, de répondre à la problématique dégagée en introduction. 4. Le développement Le développement est une démonstration et une argumentation progressive avec un enchainement clair de idées. Il doit être bien rédigé et construit, alliant étroitement les arguments et les exemples, généralement comme suit : - Chapitre 1 : annonce rapide du thème développé (et non des sous-parties) - Chapitre 2 : sous-partie 1 : un argument, un ensemble d’exemples (tirés d’au moins deux œuvres), un bilan partiel - Chapitre 3 : sous-partie 2 : transition avec la sous-partie précédente, puis construction identique au chapitre2 ; - Chapitre 4 (s’il y a trois sous-parties) ; - Chapitre final : bilan intermédiaire et transition vers la grande partie suivante développant le problème posé. Chaque étape doit être travaillée selon 3 niveaux : elle doit être complète, permettre de faire progresser la réflexion à l’intérieur d’une grande partie, et faire référence au sujet que traite l’ensemble de la dissertation. Les arguments proposés doivent être précisément induits par le sujet et le thème au programme, illustrés par des exemples, suivis de références aux textes, constituées de citations commentées et reliées dans un ordre logique. IV. Préparer les épreuves de l’oral De nombreux concours ne proposent pas d’oral de « français », avec toutefois trois formes d’épreuves à préparer. A. Concours Mines-Télécom De nombreux uploads/Philosophie/ synthese-partie-5-enfance-cpge.pdf
Documents similaires




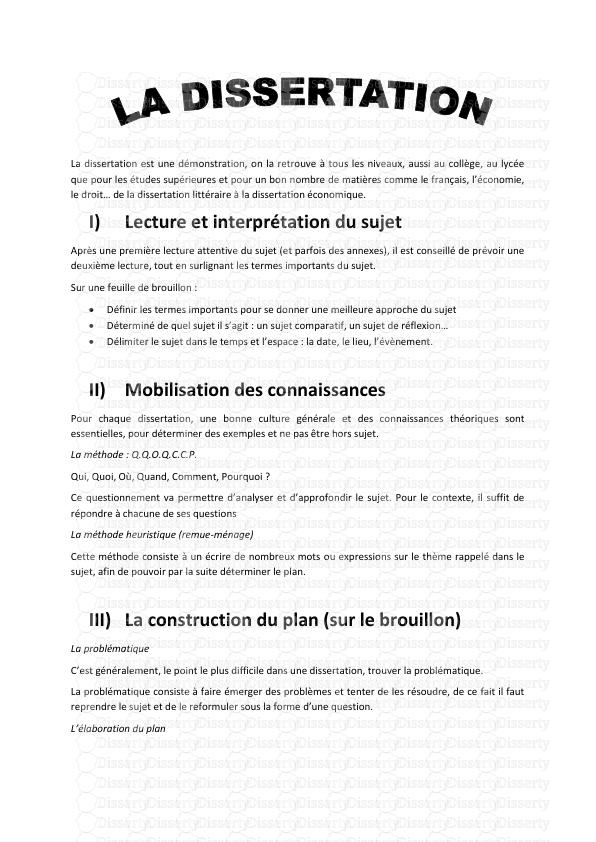





-
109
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 04, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3378MB


