ARCHIVES DE PHILOSOPHIE 14 rue d’Assas – F-75006 PARIS ( 33-(0)1.44.39.48.23 –
ARCHIVES DE PHILOSOPHIE 14 rue d’Assas – F-75006 PARIS ( 33-(0)1.44.39.48.23 – Æ 33-(0)1.44.39.48.17 * archivesdephilo@wanadoo.fr : http://www.archivesdephilo.com BULLETIN D’ÉTUDES HOBBESIENNES II (XXX) Archives de Philosophie, cahier 2019/2, tome 82, Été, p. 417-448. © Centre Sèvres. Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction interdite. « hobbisme et démocratie », pour reprendre une expression de Justine bindedou- yoman (auteure de Hobbisme et féminisme, vers une fluctuation de l’identité fémi- nine, PAF, 2015 et du Procès de la démocratie en Afrique (ed.), L’Harmattan Côte d’ivoire, 2016). Dans l’histoire des démocraties occidentales, le spectre du Léviathan a souvent été interprété comme une figure menaçante, limitant les libertés indivi- duelles, en particulier chez les adversaires de l’État. il est frappant de voir que l’idée d’un pouvoir absolu comme condition de l’expression publique de la parole trouve, dans un contexte de crise, des échos favorables, et en un sens bien plus proches du texte de Hobbes que dans les réactions inquiètes de ceux qui l’ont condamné au nom des libertés individuelles. il ne s’agit pas de considérer la sécurité comme le premier des biens, mais de voir dans l’État les conditions même de l’existence politique. Dans sa conclusion, l’auteur propose une synthèse claire des « trois dimensions [qui] concou- rent à la science civile: la logique par la rigueur et la cohérence des propositions, les mathématiques dans leur critère de définitions des termes et la physique en référence aux phénomènes à partir desquels se construit le calcul de la raison » (p. 181). Éric MArqUer 2.3. Lilian TrUCHoN, Hobbes et la nature de l’État. Matière et dialectique de la souveraineté politique, Paris, Éditions Delga, 2018, 213 p. L’introduction propose de « repenser le matérialisme hobbésien dans sa cohé- rence ». Après être revenu « sur quelques idées reçues sur [...] Hobbes », en rappelant notamment la distinction existant entre un philosophe « prôn[ant] l’absolutisme poli- tique » et « un idéologue de la monarchie absolue », l’auteur nous invite à considérer Hobbes comme « un précurseur de la modernité politique, comme le montre sa défi- nition du peuple ». Parce qu’il a montré qu’« un peuple est souverain ou il n’est rien », Hobbes « annonce en quelque sorte la séquence historique de la révolution française et des Constituantes de 1789 et 1792 » (p. 5). Dans un ouvrage d’introduction à la phi- losophie de Hobbes, il faut reconnaître que cette présentation a quelque mérite, et saura certainement aiguiser l’intérêt du lecteur, dont l’attention aura d’ailleurs déjà été attirée par la citation de Marx mise en exergue. il ne faut d’ailleurs pas s’y trom- per: bien qu’il s’agisse d’un ouvrage destiné au grand public, l’auteur n’entend pas remplacer les idées reçues par d’autres idées reçues, et c’est bien la pensée de Hobbes dans sa complexité et ses contradictions apparentes qui est présentée dans la suite de l’introduction. « Hobbes n’était pas un penseur du changement social » (p. 6), comme nous le confirme une citation, donnée en note, de l’ouvrage de Patrick Tort, Physique de l’État (Vrin, 1978), ouvrage dont un compte rendu historique par y veline Leroy est reproduit en annexe (p. 194-195). Le ton est donné: les recherches sur le matéria- lisme de Hobbes et sa théorie de l’État se trouvent d’emblée encadrées par Marx et Darwin, ce qui n’est guère surprenant puisque Lilian Truchon est par ailleurs l’au- teur d’une thèse sur « Le Darwinisme dans la culture politique chinoise » (2017). Mais là encore, le lecteur qui craindrait de voir dans le livre de Lilian Truchon un nouvel épisode de « Hobbes chez les darwiniens » sera vite rassuré en constatant que les ana- lyses développées dans l’ouvrage se fondent sur une lecture précise des recherches récentes sur le matérialisme de Hobbes (en particulier Jean Terrel, Arnaud Milanèse et Jauffrey berthier). Si l’ombre de Darwin et de ses commentateurs plane parfois dans l’ouvrage, c’est pour mieux rappeler en quoi, malgré l’identité de leur logique dialectique, il se distingue de Hobbes, à tel point que toute hypothèse concernant une Bulletin d’études hobbesiennes ii (xxx) 429 éventuelle réminiscence de l’état de nature dans sa version hobbesienne chez le pen- seur de la sélection naturelle est à proscrire (p. 96), tout comme, par ailleurs, les inter- prétations non matérialistes de Hobbes. Mais reprenons le fil de l’introduction. Si Hobbes n’était donc pas un penseur du changement social, il reconnaissait néanmoins un droit de résistance aux esclaves. il fut matérialiste, mais non athée et « passable- ment théologien », tout en étant « ennemi déclaré de toutes les formes d’intégrismes religieux » (p. 6), adversaire du puritanisme religieux plutôt que de l’idéal républicain de liberté: restituer avec rigueur la pensée de Hobbes exige en effet de se défaire des idées reçues, et d’en rappeler certaines pour mieux les critiquer, comme celle qui consiste à réduire son anthropologie à l’état de nature et à la vision d’une humanité naturellement méchante, vision dont on apprend qu’elle fut paradoxalement perpé- tuée au XiXe siècle par un auteur comme Pierre Kropotkine, qui désigna l’état de guerre généralisée sous l’expression de « loi de Hobbes » (p. 9). L’introduction est dans l’ensemble éclairante et stimulante. L’idée d’une sortie de l’état de nature sur le mode dialectique, reprise à Patrick Tort, de nouveau cité, convaincra-t-il les spécialistes de Hobbes? Certainement, puisque l’idée d’une Aufhebung de la nature, abolie et conser- vée dans la politique, est « parfois » attestée par des commentateurs de Hobbes : François Tricaud, Pierre-François Moreau et Dominique Weber sont cités pour éclai- rer les relations complexes de la nature et de l’anti-nature. Au terme de cette présen- tation dynamique et salutaire, qui rappelle les « fondements matérialistes de la philo- sophie naturelle de Hobbes », le propos de l’ouvrage est énoncé : « réinstaurer la logique dialectique du système politique hobbésien dont “les lois de nature” consti- tuent le pivot » (p. 13). Contrairement à ce qu’affirmait ernst bloch, cité par l’auteur, il y a donc bien une dialectique dans la tradition empiriste anglaise. L’ouvrage se compose de trois chapitres : i. imaginer « l’anéantissement du monde ». ii. L’état de nature: une réalité anthropologique. iii. Continuité et effet de rupture dans le passage à l’état civil. La conclusion porte également un titre: « La nature de l’État de Hobbes à Marx ». La justification de l’ordre choisi pour l’exposi- tion n’est pas toujours explicite. Les remarques et explications sur l’histoire du concept de matérialisme et son usage pour rendre compte de la philosophie de Hobbes sont en général éclairantes et informées. Mais le rappel récurrent de l’hypothèse dia- lectique pour rendre compte des rapports entre nature et artifice, ainsi que les déve- loppements sur « l’efficience logique de la continuité réversive » (p. 153) risquent de décourager certains lecteurs. on trouvera néanmoins vers la fin de l’ouvrage un cha- pitre intéressant sur la question de savoir s’il faut considérer la philosophie de Hobbes comme « une géométrie politique ou une physique de l’État? » (p. 160), éclairée par une référence aux analyses de José Médina sur les rapports entre mathématiques et philosophie, ainsi qu’un développement suggestif sur le sens de la critique du « maté- rialisme mécaniste » (p. 167), à partir de références à Marx et engels, qui nous condui- sent naturellement vers la conclusion. L’idée d’un matérialisme politique de Hobbes semblait jusque-là affirmée de manière quelque peu dogmatique, et essentiellement garantie par la référence insistante à la figure tutélaire de Patrick Tort. La conclusion, qui présente « la nature de l’État de Hobbes à Marx », éclaire les bénéfices de la lec- ture matérialiste, à la fois pour la théorie de l’État et pour la compréhension de la théo- rie politique de Hobbes. en effet, le matérialisme bien compris permet de défendre Hobbes contre d’éventuelles critiques d’inspiration marxiste, qui verraient chez Hobbes un représentant du formalisme juridique: « Selon cette orientation critique 430 Archives de Philosophie marxiste, la pensée politique de Hobbes peut être considérée comme tributaire d’une illusion juridico-politique aveugle au fait que l’État ne naît pas soudainement d’une “volonté souveraine”, comme un champignon qui sortirait de terre à l’annonce de l’automne. Au contraire, c’est parce que l’institution étatique est née d’un mode d’existence matériel particulier des individus qu’elle prend ensuite la figure d’une volonté souveraine » (p. 187). L’ouvrage mérite donc d’être lu jusqu’à la fin. on pou- vait regretter de temps à autre un excès d’informations et de références à la littéra- ture critique, qui semblait prendre le pas sur une référence directe au texte de Hobbes. Mais la conclusion éclaire à la fois l’objet et la méthode, puisque le livre de Lilian Truchon cherche aussi à interpréter les interprétations, pour finalement mieux res- saisir la nature de l’entreprise hobbesienne. Le livre n’en conserve pas moins un carac- tère quelque peu singulier, puisqu’il est à la fois une introduction à la philosophie de Hobbes, souvent pédagogique, et un travail assez libre, souvent audacieux, dont l’am- bition n’est certainement pas de convaincre tous les experts (on regrettera d’ailleurs la quasi-absence de références uploads/Philosophie/ truchon-hobbes-bulletin-etudes-hobbesiennes-2019.pdf
Documents similaires
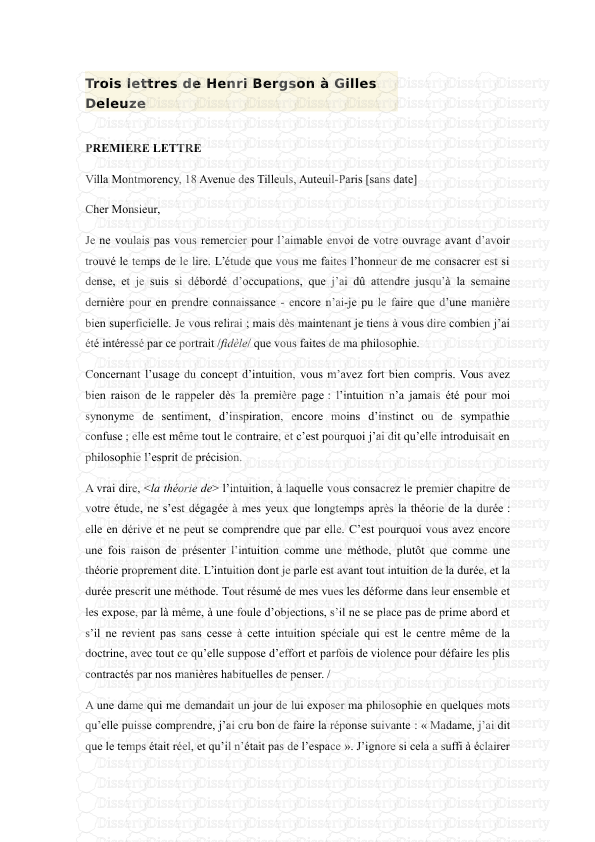









-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 30, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1558MB


