QSJ, Histoire constitutionnelle de la France L’émergence du régime parlementair
QSJ, Histoire constitutionnelle de la France L’émergence du régime parlementaire (1815-1870) par Pierre Bodineau et Michel Verpeaux Malgré la disparition d’une Constitution remplacée par une Charte, en dépit d’une restauration de la monarchie, une pratique politique se développe au gré des hommes et des circonstances sur le modèle anglais : le système parlementaire s’impose d’abord dans le cadre d’une monarchie volontairement limitée. 2 La révolution de 1848 marque une rupture avec cette évolution : elle introduit le suffrage universel et débouche paradoxalement sur une République sans républicains ; la constitution présidentielle de la IIe République servira les ambitions de Louis-Napoléon Bonaparte et conduira très rapidement à la disparition de la République et au rétablissement de l’Empire. 3 La relative stabilité du régime s’accompagne d’une évolution des institutions, réintroduisant progressivement des mécanismes parlementaires dans un système pourtant copié sur le modèle de l’an VIII et dont les principes étaient totalement différents. I. – Le temps des chartes (1815-1848) 4 Alors que la Restauration veut reprendre le cours d’une histoire, interrompue par la Révolution et l’Empire, la monarchie de Juillet ne se limite pas à un changement de dynastie et veut faire vivre une « monarchie plus démocratique ». 5 1. La Restauration : théorie et pratique de la monarchie limitée. – Si le roi Louis XVIII ne pouvait accepter de se voir imposer une constitution, totalement contraire à l’idée qu’il se faisait encore de la monarchie, il sentait l’attente générale d’un texte reconnaissant certaines garanties et dont il avait d’ailleurs admis le principe le 2 mai 1814. 6 (A) La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. – Une commission fut constituée de neuf membres de chacune des deux assemblées et de trois commissaires du roi (dont de Montesquiou, principal rédacteur du texte) sous la présidence du chancelier Dambray ; les débats y furent rapides ; de plus, le roi prenait son conseil mais tranchait seul en dernier ressort. 7 Le texte de la Charte comporte 74 articles ; on y retrouve une volonté de compromis, tant dans les principes généraux affirmés dans le Préambule que dans les institutions établies par la Charte constitutionnelle. 8 (a) Les principes généraux. – Ils sont précisés dans la première partie du texte intitulée « Droit public des Français » : prenant acte « des effets des progrès toujours croissants des Lumières, des rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, de la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle », la Charte reprend et consacre les grands principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : égalité des Français devant la loi, égale admissibilité aux emplois civils et militaires, libertés de religion (toutefois, l’État ne prend en charge que les ministres du culte catholique et des autres cultes chrétiens), d’opinion, mais « en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté ». 9 Afin de liquider le contentieux de la Révolution, l’article 9 affirme que « toutes les propriétés sont inviolables, sans exception de celles qu’on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles ». 10 (b) « Les formes du gouvernement du roi ». – Cette formulation souligne que c’est autour de la personne du roi, inviolable et sacrée, que s’organisent les institutions politiques. 11 « Le roi est le chef suprême de l’État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d’administration publique. » 12 Le roi « propose » la loi ; seul, il la sanctionne et la promulgue : aucun amendement ne peut être accepté s’il n’a été « proposé ou consenti » par lui. 13 Il convoque les chambres et peut dissoudre celle des députés des départements, sous la condition d’en convoquer une autre dans les trois mois. 14 Le roi désigne les ministres qui sont « responsables » et peuvent être membres d’une des deux chambres ; ils peuvent s’y faire entendre quand ils le demandent : le texte ne les évoque d’ailleurs que très brièvement et consacre beaucoup plus d’articles aux assemblées. 15 Le pouvoir législatif est partagé entre deux chambres, conformément au modèle anglais cher à Benjamin Constant : 16 la Chambre des pairs constitue la chambre haute, garante d’une certaine stabilité : le roi nomme les pairs soit à vie, soit à titre héréditaire et sans limitation de nombre ; ils doivent être âgés de 25 ans et n’ont voix délibérative qu’à 30. C’est elle qui connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l’État ; la Chambre des députés des départements constitue en théorie l’élément démocratique du pouvoir législatif : les députés sont élus pour cinq ans ; chaque année, un cinquième de l’assemblée est renouvelé. 17 Mais le système électoral ne permet que la participation d’une minorité de citoyens à la vie publique : pour être éligible, il faut être âgé de 40 ans et payer une contribution directe de 1 000 F. Quant aux électeurs, ils doivent avoir au moins 30 ans et payer une contribution de 300 F. 18 Ces règles limitaient le nombre des électeurs à 110 000 pour 30 millions d’habitants : d’autres mesures réduiront encore ce nombre. 19 Quant aux pouvoirs des chambres, ils demeurent limités par les prérogatives royales : la Charte ne reconnaît qu’une responsabilité pénale des ministres : « La Chambre des députés a le droit d’accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger. » 20 Pourtant, le roi va faciliter, dans la pratique, certaines habitudes du régime parlementaire. 21 (B) Une pratique évolutive. – Très rapidement, les parlementaires considèrent que les ministres ne peuvent se maintenir en fonction s’ils n’ont pas la confiance des chambres ; en conséquence, il leur appartient de démissionner volontairement, à moins que le roi ne les en persuade : c’est ce qui se passe en 1818 lorsque le duc de Richelieu ne peut faire adopter sa politique de réconciliation avec les ultras. 22 Decazes en 1820, Villèle en 1829 feront de même lorsque les chambres refusent systématiquement de voter leurs projets ou les crédits nécessaires à leur politique, ou encore pour assumer l’assassinat du duc de Berry, héritier du trône, mais ils n’étaient pas juridiquement obligés de le faire. 23 De même Louis XVIII puis Charles X désignent-ils clairement un président du Conseil, bien identifié comme le chef du gouvernement ; les conseils des ministres ne se déroulent d’ailleurs pas toujours en présence du roi et, même dans ce cas, les souverains laissent au gouvernement une large marge d’autonomie, comme le montrent les témoignages sur leur déroulement. 24 Ils aident ainsi à la reconnaissance d’une solidarité gouvernementale qu’illustre bien Chateaubriand dans cette formule : « Une fois formé, le gouvernement doit être un. » 25 Avec le roi Charles X qui succède à Louis XVIII en 1824, l’évolution du régime est pourtant remise en cause : en 1827, sur le conseil de Villèle, le roi dissout la Chambre, comme le lui permet l’article 50 de la Charte (« il peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois »). 26 Les élections sont défavorables aux ultras, et le roi nomme Martignac, plus libéral ; lorsque celui-ci démissionne à la suite d’un échec législatif, Charles X constitue un gouvernement particulièrement réactionnaire sous la présidence de Polignac ; en 1830, la Chambre réagit en utilisant l’adresse, réponse au discours du trône qui ouvrait la session parlementaire : ce texte, voté par les 221 députés libéraux, affirme que le roi ne peut gouverner qu’en désignant un gouvernement qui bénéficie de la confiance de la Chambre élue par le peuple. Le roi ajourne, puis dissout la Chambre ; les nouvelles élections renforcent les libéraux. 27 Devant ce nouveau désaveu, le roi utilise l’article 14 de la Charte qui lui permet de faire « les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État » : le 25 juillet sont promulguées quatre ordonnances : outre la dissolution de la Chambre, la fin de la liberté de la presse, la loi électorale est modifiée dans un sens encore plus restrictif. Ces décisions provoquent des émeutes à Paris qui entraînent l’effondrement du régime et la fuite du roi. 28 Pour éviter la République, les libéraux se tournent alors vers Louis-Philippe d’Orléans, avec la volonté d’instaurer une monarchie plus moderne ; cette mutation se traduira par la rédaction d’une nouvelle charte qui n’est plus octroyée par le roi. 29 2. La monarchie de Juillet : une monarchie républicaine. – L’urgence conduit à rédiger très rapidement une nouvelle charte qui ne modifie pas en profondeur le fonctionnement des institutions. 30 (A) La Charte constitutionnelle du 14 août 1830. Certains aspects de l’ancienne Charte, de son Préambule notamment, apparaissent totalement inadaptés à la nouvelle conjoncture : ils sont donc supprimés ; des innovations symboliques uploads/Politique/ histoire-constitutionnelle-de-la-france-1815-1958.pdf
Documents similaires







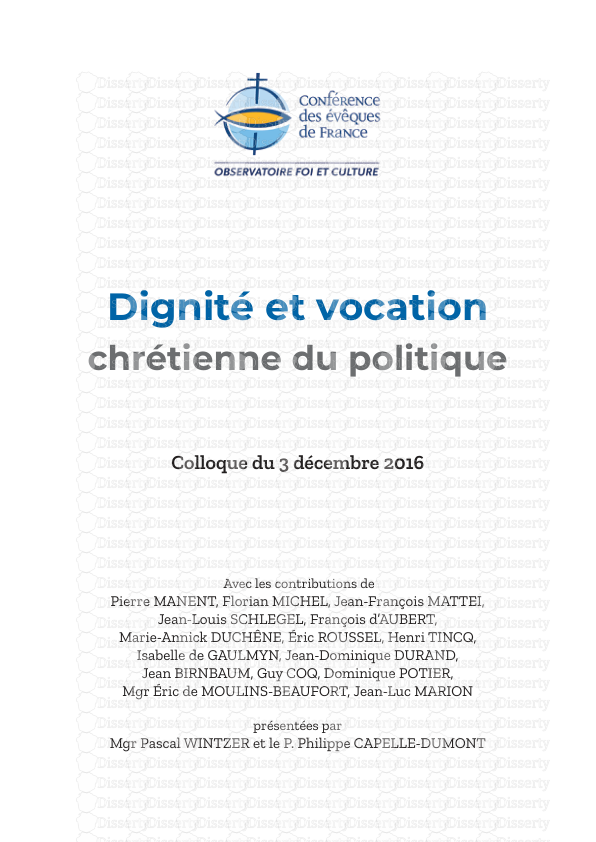


-
107
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 24, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6179MB


