1 « Vers le désir, sur l’éthique au sens de Lacan » Clotilde Leguil Cours 11 :
1 « Vers le désir, sur l’éthique au sens de Lacan » Clotilde Leguil Cours 11 : 13 février 2023 « Le nouveau champ de das Ding » Retranscription : Clotilde Scordia Relecture : Ivan Lampin Au second semestre, nous allons poursuivre notre élaboration autour de l’éthique de la psychanalyse. Le titre du cours est toujours « Vers le désir, sur l’éthique au sens de Lacan » et nous allons aborder la seconde partie notamment du Séminaire, « Le problème de la sublimation » et « Le paradoxe de la jouissance ». Je ne prends pas leçon par leçon, j’attrape plutôt les choses qui appartiennent au concept. Le titre que je vous propose pour le propos d’aujourd’hui et je poursuivrai la suite est le suivant, peut-être un peu énigmatique mais que je vais expliquer : « Le nouveau champ de das Ding ». On a déjà commencé à aborder ce concept de das Ding, au premier semestre, concept que Lacan introduit dans le Séminaire VII afin de renouveler son approche de la psychanalyse. Lacan va se servir de son concept de das Ding, terme allemand qu’on traduit en français par la Chose, va se servir de ce concept de das Ding pour redéfinir la question des pulsions en psychanalyse mais aussi la question éthique, c’est-à-dire que ce qui est nouveau c’est que Lacan va nous proposer une approche de la question du bien et du mal depuis cet étrange concept de das Ding, de la Chose. J’annonce, et nous y reviendrons ultérieurement, que ce concept bien qu’il le présente dans la première partie du Séminaire, à partir de phrase de « L’esquisse de la psychologie psychique » de Freud, ce concept, il l’emprunte et le développe essentiellement à partir d’Heidegger et à partir d’un article d’Heidegger que vous trouvez dans ce volume Essais et conférences, je ne sais pas s’il est facile à trouver mais vous pouvez toujours le consulter en bibliothèque, un article d’Heidegger qui s’intitule tout simplement « La Chose ». Vous allez voir que Lacan fait là une rencontre avec cet article, évidemment il en a fait autre chose comme toujours, mais néanmoins il emprunte un certain nombre de développements et de thèses à la philosophie d’Heidegger pour penser la Chose. Das Ding, le mal et le malaise Nous allons voir aussi en quel sens ce concept de das Ding est une façon pour Lacan de poser le problème du mal. Le problème du mal en plusieurs sens, relatifs à l’expérience de la psychanalyse, c’est-à-dire à la fois le mal que l’on peut se faire à soi-même, le mal que l’on peut faire à l’Autre, mais aussi la rencontre dans l’expérience de l’analyse de cette étrange pulsion de destruction que Freud a nommé dans le Malaise dans la civilisation, la « pulsion de mort ». Au fond, das Ding est le concept heideggérien à partir duquel Lacan va relire le Malaise dans la civilisation pour donner un statut à la question du mal. On va voir que cette question est posée par Lacan aussi bien à l’échelle de la civilisation dans une certaine critique du progrès, qu’on a déjà abordé au premier semestre et dans une certaine critique du discours de la science et aussi à l’échelle, là je dis de l’individu, l’individu au sens où Freud parle de l’individu dans le Malaise dans la civilisation, je veux dire aussi à l’échelle de l’existence du sujet lui-même. Et donc, dans ce Séminaire sur l’éthique de la psychanalyse, Lacan pose cette question de la pulsion de destruction depuis ce concept de das Ding dans la civilisation et dans l’individu. On va le voir das Ding est aussi une façon de repenser le statut de l’inconscient. J’y reviendrai par la suite. Ce concept de das Ding ne conduit pas 2 seulement Lacan à tenir un propos sur le Malaise dans la civilisation, ne conduit pas seulement à diagnostiquer le malaise présent, présent qui est pour lui dans les années 1950, mais cela le conduit à infléchir aussi l’enjeu d’une cure analytique, c’est-à-dire qu’il va aussi nous montrer ce qu’est ce champ de das Ding dans la cure analytique. J’emploie ce terme de champ, évidement d’abord parce que Lacan l’emploie lui-même dans le Séminaire VII, « champ de das Ding » mais si j’en fais ici un titre, c’est parce que l’écrit fondateur de l’enseignement de Lacan, 1953, s’intitule « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » et donc, le champ désigne une extension, un territoire au sein duquel une expérience se déroule. Philippe Soupault, à propos du surréalisme a écrit Les Champs magnétiques. Ce terme de « champ » était aussi à la mode dans le surréalisme. Lacan ne cherche plus seulement à délimiter le champ de l’expérience analytique depuis la parole et le langage mais il cherche à montrer que le champ de l’expérience analytique a aussi à voir avec l’extension et le territoire de das Ding, de la Chose, a aussi à voir avec le champ des pulsions. Le tout savoir de la science vs le désir de savoir dans l’analyse Alors, pour commencer en introduction pour faire voir aussi comment Lacan a l’idée de donner cette place à das Ding dans ce Séminaire sur l’éthique, je vais reprendre cette critique proposée par Lacan aussi bien au début du Séminaire qu’à la fin, critique à la fois du discours de la science et critique du progrès. Je reprends cela du point de vue de das Ding. Vous vous souvenez qu’au premier semestre, nous avions commencé à attraper cette question du désir, désir que Lacan en fait la finalité de l’expérience analytique, nous l’avons attrapé, c’est ce que je me suis proposé, en tenant ensemble le début du Séminaire et la fin du Séminaire, je n’avais pas envie de suivre de façon purement chronologique chaque leçon. J’avais envie aussi de partir de la fin, du point d’arrivée. Et nous avions vu que le point d’arrivée du Séminaire, bien sûr que c’est cette magnifique analyse que Lacan va proposer de la pièce de Sophocle, Antigone, mais c’est aussi la dernière leçon, une critique de la science, une critique du progrès que Lacan émet en parlant d’un « effondrement de la sagesse ». La question du désir en psychanalyse en tant qu’il prend une valeur éthique a à voir avec la recherche d’une nouvelle sagesse, une nouvelle sagesse que le discours de la science ne serait pas à même de nous désigner et à la fin de ce Séminaire, Lacan parle de la passion du savoir comme ce qui a contribué à une forme d’aveuglement. Ça peut surprendre. Cela surprend si on ne distingue la « passion du savoir » et le « désir de savoir ». C’est une distinction qui est très bien montrée par Éric Laurent dans l’article que je vous avais cité dans le dernier numéro de Mental, sur « Écologie lacanienne ». Éric Laurent propose un commentaire circonstancié de la dernière leçon du Séminaire VII, aussi la leçon dont je suis partie dans le cadre de ce cours et il montre très bien que pour comprendre ce que dit Lacan concernant cet effondrement de la sagesse qu’incarnerait le discours de la science, il faut distinguer la « passion du savoir » et le « désir de savoir ». Comme si la passion du savoir, la passion de tout savoir, de déployer un savoir sur tout, la passion du savoir absolu, cette passion-là faisait obstacle à un désir de savoir de chacun qui prend son élan de la rencontre d’un manque. Il faut à un moment rencontrer un manque qui est aussi un manque de savoir pour que s’éveille le désir de savoir. La passion du savoir serait, elle, du côté d’un savoir visant le tout et l’absolu et ne prenant en compte aucun manque, se déployant de façon à recouvrir tous les champs, tous les domaines. Cette critique du discours de la science est un invariant chez Lacan, elle n’est pas juste un développement propre à la fin des années 1950, c’est une critique qu’il va déployer jusqu’à la fin notamment en critiquant aussi ce qu’il appelle le « discours du maître » et le « discours de la science » dans le Séminaire XVII qu’il définit du côté d’un rapport au tout. Et de développer du côté de la science un savoir de tout, ce qui n’est pas encore su est considéré comme pouvant devenir savoir, tout peut se savoir. Or justement, l’expérience de la psychanalyse, c’est que « pas- tout » peut se savoir. Et qu’il faut faire une place à ce « pas-tout », à ce réel en tant qu’il ne peut pas se savoir. J’y reviendrai. Juste pour vous dire que cette critique de la science est là en 3 différents endroits. Il s’agit pour Lacan de critiquer dans la science une forme de point aveugle, le point aveugle c’est la question du but vers où se dirige-t-on avec le progrès du savoir scientifique. Cette question du uploads/Science et Technologie/ cl-13-fev-23-cours-11.pdf
Documents similaires



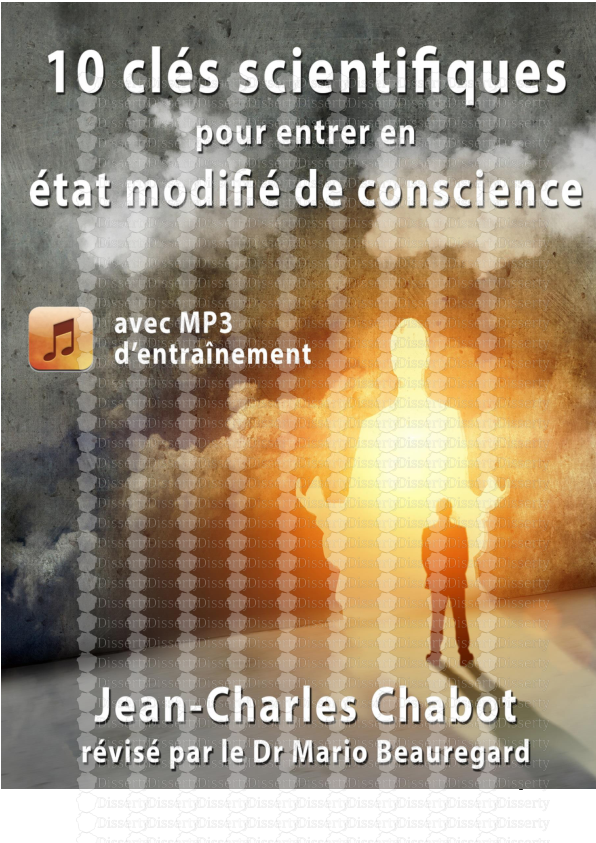






-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 05, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1738MB


