CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE REMARQUES GÉNÉRALES Le contrat de collabo
CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE REMARQUES GÉNÉRALES Le contrat de collaboration de recherche, instrument privilégié de la Recherche- Développement L’accord de collaboration scientifique et technique est l’instrument privilégié pour la réalisation de recherches dont les enjeux s’avèrent importants en termes de valorisation. M. Reboul définit le contrat de collaboration comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes se répartissent l’exécution et le financement de travaux scientifiques et techniques en vue d’obtenir les résultats qui en seront issus (« Contrats de recherche », Juris. Cl. Brevets, Fasc. 100, 2, 1983, n°76). Le contrat de collaboration de recherche, un contrat d’entreprise multilatéral Si le contrat de collaboration demeure un contrat d’entreprise, il ne présente plus, en revanche, le caractère unilatéral du contrat de prestation de services classique. Il contient, en effet, les dispositions nécessaires à la réalisation en commun d’une recherche, ce qui implique, le plus souvent, la mise en commun de ressources financières, humaines, techniques et logistiques. La comptabilisation de ces ressources permet d’évaluer les apports et ainsi, la participation de chaque partenaire et de prévoir, par la suite, lors d’une éventuelle exploitation du brevet issu des résultats de la recherche, la répartition des bénéfices entre eux. Lorsque le brevet est enfin pris sur l’invention, issue des résultats de la recherche, les partenaires peuvent également s’entendre sur une répartition des tâches pour mener à bonne fin son exploitation (Sur cette pratique, voir A. Cuer, « Copropriété et accords de recherche et de collaboration », La copropriété des brevets, 2ème rencontre de propriété industrielle, Lyon, 16 et 17 mai 1972, Litec, C.E.I.P.I., Paris, 1973, pp. 57-76). La mise en place d’une politique commune quant à la production du brevet permet alors, à l’instar de l’organisation de l’ancienne « indivision industrielle », de répartir les tâches de développement en fonction des compétences de chaque partenaire. La minimisation des coûts de production ainsi que la conservation d’une certaine autonomie sur le plan économique et juridique, est, en général, l’objectif assigné à une telle stratégie. La rédaction d’un programme de collaboration, sous la forme d’un accord de coproduction ou de consortium, sera alors un moyen efficace pour estimer les coûts et répartir les tâches de production, de commercialisation, de distribution, etc. CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE La SOCIETE (forme juridique) dont le siège social est …… (adresse du siège social), n° SIREN ……, code APE ……, représenté(e) par M ……, ci-après désigné(e) par la « SOCIETE », D’UNE PART, ET Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique, dont le siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16, n° SIREN 180 089 013, code APE 731Z, représenté par Monsieur Bernard JOLLANS, son Directeur, ci-après désigné « l’ORGANISME », agissant au nom et pour le compte du …… (code de l’Unité de recherche), dirigé par M. ou Mme …………………, ci-après désigné par le « LABORATOIRE », D’AUTRE PART, conjointement désignés par les « Parties » L’art. 1101 Code civil dispose que « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Aux termes de l’art. 1108 Code civil : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité à contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation ». Sur la capacité à contracter et s’agissant de personnes morales, une identification claire et complète permet de vérifier immédiatement que : le partenaire dispose de la capacité juridique, son représentant a le pouvoir de l’engager. Seule la présidence ou la direction de l’Organisme de recherche dispose de la personnalité juridique et donc de la capacité à contracter, même si le contrat intéresse un département scientifique, une délégation, un institut ou un laboratoire : seule la mention de l’Organisme et de son représentant importe. Le CNRS est en particulier représenté par son directeur général (art. 8, D. n°82-993 du 24 nov. 1982). Mais compte tenu de la taille de l’organisme, ce même décret l’autorise à déléguer sa signature. Toutefois, cette délégation est strictement limitée à la personne qui la reçoit dans l’aire géographique, matérielle et temporelle déterminée. Ainsi, un Délégué régional ne peut signer que des contrats de recherche intéressant les laboratoires de sa circonscription territoriale. Il peut arriver que le responsable scientifique propose de signer le contrat. Il faut absolument le refuser puisqu’il n’est pas habilité à représenter l’Organisme de recherche et ce, à peine de nullité du contrat. En revanche, il est possible de mentionner, à titre de renseignement, quel est le laboratoire et/ou la composante concernés. PRÉAMBULE Le LABORATOIRE est spécialisé dans …………………... La SOCIETE est spécialisée dans ……………………… et souhaite ………………………… Dans le cadre de ce projet, le CNRS et la SOCIETE ont signé le …………… un accord de secret afin d’engager des discussions sur la faisabilité du projet et ses modalités de mise en œuvre. Sur ces bases, la SOCIETE souhaite entreprendre en collaboration avec le LABORATOIRE la réalisation d’une recherche sur ……………………………………………………………… Le préambule permet de cerner précisément les motivations des Parties, les objectifs qu’elles poursuivent en s’échangeant des Informations Confidentielles. Le préambule est important et doit être soigné car il permet de permettre au juge (en cas de besoin) d’effectuer la meilleure interprétation du contrat en recherchant ce que l’on appelle la commune intention des Parties (art. 1156 Code civil : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes »). Les informations contenues dans le préambule ont la même valeur juridique que les dispositions principales : elles font partie intégrante du contrat. Toutefois, le préambule n’est pas le seul élément permettant l’interprétation du contrat : tous les documents composant le corpus contractuel peuvent permettre d’assurer cette interprétation (sur le corpus contractuel, cf. l’art. 9). Il est convenu ce qui suit : Article 1er – Objet du contrat L’ORGANISME (Laboratoire……………….) et la SOCIETE décident d’effectuer en commun une étude ci-après désignée, l’Etude, intitulée : ………………………………………………… L’existence d’un objet est la troisième condition de validité d’un contrat. Ainsi, l’art. 1126 Code civil dispose que : « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ». Toutefois, cet objet doit être licite et conforme à l’ordre public. L’art. 6 Code civil dispose en effet que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. » Ainsi, un contrat de recherche ne doit pas avoir par exemple pour objet l’atteinte à l’intégrité physique ou à l’indisponibilité du corps humain. Un programme détaillé de l’Etude est donné dans l’annexe scientifique et technique jointe. En matière de contrat de recherche, il convient de bien définir le domaine technique de l’Etude car l’accord peut s’avérer recouvrir un domaine beaucoup plus vaste que celui auquel pensaient initialement les Parties. En outre, les recherches menées dans ce domaine pourront conduire à la découverte de résultats qui devront être protégés. Il convient donc de bien distinguer les résultats issus du domaine de l’accord, sur lesquels toutes les Parties pourront revendiquer des droits et ceux qui sont hors du domaine. Une bonne définition du domaine technique de l’Etude permet au Laboratoire de garder les mains libres à l’égard d’autres partenaires dans des domaines connexes. Enfin, le domaine technique de l’Etude doit être clairement distingué du domaine d’application industrielle des résultats issus de la collaboration. Ainsi, une seule étude menée dans un domaine technique peut aboutir à des résultats exploitables dans différents domaines d’application industrielle et commerciale, chacun de ces dits domaines pouvant être exploités, dans la mesure où les droits de propriété de l’Organisme auront été préservés, par un industriel différent. Les annexes n’ont de valeur contractuelle qu’à la double condition que l’autre contractant sache qu’elles font partie du contrat et qu’il puisse en prendre connaissance. Il faut donc préciser dans le contrat qu’existent une ou plusieurs annexes (cf. art. 14 – Intégralité et limites du contrat). L’ORGANISME utilisera les sommes perçues pour la mise en place de la présente collaboration, et mettra tout en œuvre pour assurer son bon déroulement conformément à l’obligation de moyen qui lui incombe. Le contrat de recherche étant aléatoire par nature, l’obligation à la charge de l’établissement est une obligation de moyens, l’Organisme devant tout mettre en œuvre pour atteindre au mieux l’objectif du contrat sans s’engager sur un résultat déterminé. Ainsi, le responsable scientifique a l’obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du contrat et choisira pour son exécution les collaborateurs qu’il jugera utile de faire intervenir, quitte à sous- traiter dans les conditions prévues par le contrat (cf. art. 13 – Sous-traitance). En cas de CIFRE M. …………… bénéficie d’un contrat de travail établi dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) uploads/Science et Technologie/ contrat-collaboration-commente.pdf
Documents similaires









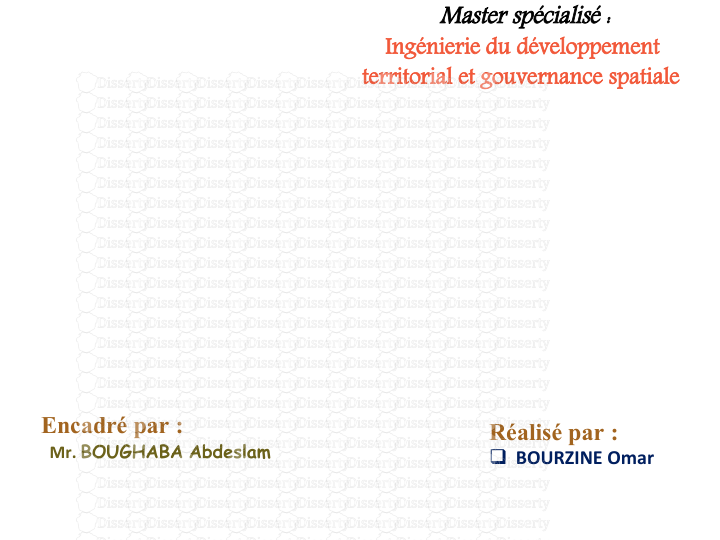
-
51
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 09, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1419MB


