Mention : Premier degré Parcours : Professeur des écoles monolingue Les bénéfic
Mention : Premier degré Parcours : Professeur des écoles monolingue Les bénéfices de la pratique de la musique et des percussions corporelles sur la dyslexie et la lecture. 2016-2017 Rédigé par Mélanie PERCHE Directeur de mémoire : Laurent Séjourné – E.S.P.E de Saint Brieuc Résumé Les résultats des tests effectués en 2015 durant la Journée Défense et Citoyenneté ont montré que 10% des jeunes français ont des difficultés pour lire et 4% sont illettrés. Cette même année, les nouveaux programmes ont placé la langue française et plus particulièrement la lecture au cœur des apprentissages. Comment aider des élèves ayant des difficultés en lecture et en particulier les élèves dyslexiques ? Des recherches en sciences humaines, en neurosciences et en musicologie ont montré que la musique améliore la conscience phonologique, compétence fragile chez les dyslexiques. Quel protocole serait-‐il intéressant de mettre en place en musique pour aider les élèves à progresser en lecture grâce à une meilleure maîtrise du rythme et des hauteurs ? Afin de vérifier la corrélation entre la pratique de la musique et les habilités en lecture, des élèves de CE2 ont suivi un protocole en percussions corporelles et leurs performances en lecture ont été vérifiées avant le protocole et après le protocole pour confirmer ou réfuter cette hypothèse. Abstract The French defense preparation and citizenship day aims to test the language level of young French aged of 17. In 2015, the results have shown that 10% of those young French people have strong difficulties in reading and that 4% of them suffer from illiteracy. As a consequence, the national curriculum has settled the study of the French language as the core of the apprenticeships with a specific focus on reading. How can we help students with reading difficulties and specifically those who suffer from dyslexia? Research in human sciences, neurosciences and in musicology have shown that music study increases the phonological awareness, competence that lack dyslexics. Which protocol in music teaching would be interesting to set up in order to help students improving in reading thanks to a better rhythm and heights perception skills? In order to control the correlation between music practice and reading abilities, students of 3rd grade (Year 4 in U.K.) have followed a body percussions protocol and their reading skills have been controlled before and after the training in order to confirm or refute this hypothesis. MOTS CLÉS: musique, percussions corporelles, Toumback, lecture, dyslexie, conscience phonologique, hauteur, rythme. KEYWORDS : music, body percussions, Toumback, reading, dyslexia, phonological awareness, pitch, rythm. SOMMAIRE I. INTRODUCTION ............................................................................................................... 1 II. PARTIE THEORIQUE .......................................................................................................... 2 A. CE QU’EN DISENT LES RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES ................................................. 2 1. La conscience phonologique .............................................................................. 2 B. CE QU’EN DISENT LES ETUDES EN NEUROSCIENCES ............................................................... 6 1. Qu’est-ce qui explique la dyslexie ? .................................................................... 7 2. Quelle rééducation proposer ? .......................................................................... 10 C. CE QU’EN DISENT LES CHERCHEURS EN MUSICOLOGIE ........................................................ 13 1. La pratique des percussions corporelles ........................................................... 13 D. CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE ............................................................................ 14 III. EXPERIMENTATION, RECHERCHE ................................................................................. 15 A. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES .................................................................................... 15 1. Problématiques de la recherche ....................................................................... 15 2. Hypothèses ............................................................................................................ 15 B. ANALYSE DES PROGRAMMES .......................................................................................... 15 1. La maîtrise de la langue française ..................................................................... 15 2. L’Education musicale .......................................................................................... 16 3. Les troubles DYS .................................................................................................... 16 C. SUJETS .......................................................................................................................... 17 1. Groupe test ........................................................................................................... 17 2. Groupe témoin ..................................................................................................... 17 3. Dispositif Fluence .................................................................................................. 18 D. PROTOCOLE ................................................................................................................. 24 1. Procédure ............................................................................................................. 24 2. Calendrier ............................................................................................................. 24 3. Description des séances ..................................................................................... 25 4. Action du professeur ............................................................................................ 26 5. Action des élèves ................................................................................................. 27 IV. RESULTATS .................................................................................................................. 28 A. LECTURE PRE – PROTOCOLE ............................................................................................ 28 B. PROTOCOLE DE PERCUSSIONS CORPORELLES .................................................................... 28 C. LECTURE POST – PROTOCOLE .......................................................................................... 29 D. RESULTATS ..................................................................................................................... 29 V. DISCUSSION .................................................................................................................. 30 1 A. LES RESULTATS DU PROTOCOLE PERMETTENT – ILS D’ETABLIR UN LIEN ENTRE PRATIQUE MUSIQUE ET PROGRES EN LECTURE ? .......................................................................................................... 30 1. Le choix du protocole ......................................................................................... 30 2. Le choix du texte .................................................................................................. 30 3. Les résultats ........................................................................................................... 30 B. LES ELEVES ONT – ILS APPRIS ? ......................................................................................... 30 C. PROLONGEMENTS .......................................................................................................... 31 1. Constituer deux groupes ..................................................................................... 31 2. Création de structures rythmiques ..................................................................... 31 3. Prestation à la fête de l’école ............................................................................ 31 VI. CONCLUSION ........................................................................................................... 32 VII. BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................... 33 VIII. ANNEXES ................................................................................................................... 35 1 Les bénéfices de la pratique de la musique et des percussions corporelles sur la dyslexie et la lecture. I. INTRODUCTION Ce travail de recherche a débuté lors de ma première année de formation à l’ESPE de Saint-‐ Brieuc lorsque j’ai été subjuguée par l’un des articles scientifiques proposées. Je découvrais alors que la musique pouvait avoir des effets sur la conscience phonologique. La lecture est fondamentale pour la scolarité de l’élève et les nouveaux programmes de 2015 ont bien montré leur intention de mettre la lecture au cœur des apprentissages. Ma poursuite de recherches à ce sujet m’a amenée à cette réflexion « Si la musique améliore la conscience phonologique, compétence fragile chez les dyslexiques, peut-‐elle atténuer les effets de la dyslexie ? » Quant à la musique, celle – ci suscite chez moi le regret de ne pas en avoir fait la découverte en tant qu’élève ainsi que dans mon parcours personnel. Aujourd’hui, l’écoute de celle – ci est très importante pour moi mais je pense avoir de fortes lacunes en pratique musicale. Convaincue par mes lectures scientifiques, j’ai souhaité dépasser mes difficultés pour découvrir avec mes élèves une autre façon de faire de la musique. Dans un premier temps, je me suis documentée à la fois sur des articles de recherche en sciences humaines (psychologie), en neurosciences et en musicologie. Ces deux premiers types d’articles défendent deux sciences différentes mais s’accordent à montrer les effets positifs de la musique sur l’apprentissage, et notamment sur les enfants dyslexiques. Au travers de mes lectures, je me suis positionnée en tant qu’enseignante et je me suis penchée sur ce que je pourrais mettre en place comme protocole dans ma classe pour montrer la corrélation entre pratique musicale et habilité en lecture. Avant d’être mis en place avec mes élèves, il m’a fallu beaucoup d’entraînement pour maîtriser ce protocole. Dans une première partie, j’exposerai les différentes théories et connaissances déjà̀ exploitées à ce jour. Puis, dans une seconde partie, j’expliquerai ma démarche expérimentale permettant de répondre à mon questionnement. Et enfin, dans une dernière partie, j’analyserai mes recherches. Cette analyse sera faite avec une certaine prise de distance, puisque je ne peux être certaine que c’est uniquement la musique qui aura eu des effets sur mon expérimentation. 2 II. PARTIE THEORIQUE A. Ce qu’en disent les recherches en sciences humaines 1. La conscience phonologique a. Définition La conscience phonologique est définie comme la capacité à percevoir, à découper et à manipuler les unités sonores du langage telles que la syllabe, la rime et le phonème. La prise de conscience d’unités phonologiques comme la syllabe et le phonème, ainsi que leur traitement explicite et l’apprentissage des correspondances entre unités orthographiques et phonologiques sont essentiels à l’acquisition de la lecture et de l’écriture. On distingue : -‐ La conscience lexicale (segmentation en mots) -‐ La conscience syllabique (segmentation en syllabes) -‐ La conscience intra-‐syllabique (segmentation de la syllabe en attaque et en rime) -‐ la conscience phonémique (segmentation en phonèmes) b. Les recherches Des études antérieures réalisées auprès d’enfants d’âge préscolaire (4-‐5 ans) de langue anglaise, turque et slovène ont mis en évidence une forte corrélation entre les habilités musicales perceptives et les habilités de conscience phonologique (Lathroum 2011; Peynircioglu et al. 2002; Bozic et al. 2007 ; et d’autres). Néanmoins, J. Bolduc, I. Montésinos-‐Gelet et S. Boisvert ont constaté qu'aucune d'entre elles n'avait été menée sur des enfants francophones. Les auteurs se sont donc penchés sur la problématique suivante : existence d'une corrélation entre habiletés musicales perceptives (discrimination de la hauteur et de la durée) et habiletés de conscience phonologique (identification de la syllabe, de la rime et du phonème) chez des enfants francophones en âge préscolaire. Leur étude a porté sur 61 élèves d’une école francophone en Ontario, Canada (34 filles et 27 garçons d’une moyenne d’âge de 47 mois) issus de familles où les activités littéraires et/ou musicales ne sont pas prédominantes. Les auteurs ont mis en place trois épreuves afin de tester leurs hypothèses. 3 Les habiletés de conscience phonologique ont été évaluées individuellement grâce à l'épreuve de métaphonologie d’Armand et Montesinos (2000), comportant trois volets : identification de la syllabe avec séquentialité, identification de la rime et identification du phonème initial. Dans un second temps, les habiletés musicales ont été évaluées en deux volets, discrimination de la hauteur et de la durée, grâce à l'épreuve Primary Measures of Music Audition (1979) de Gordon. Des séquences mélodiques et des séquences rythmiques sont respectivement utilisées, sur lesquelles il est demandé une comparaison aux élèves. Enfin, la mémoire spatiale des 61 enfants a été testée à l'aide d'un exercice développé par Kaufman & Kaufman (1993). Par ailleurs, les auteurs exposent certaines limites à leur étude : uploads/Science et Technologie/ los-beneficios-de-la-practica-musical-y-la-percusion-corporal-pdf.pdf
Documents similaires
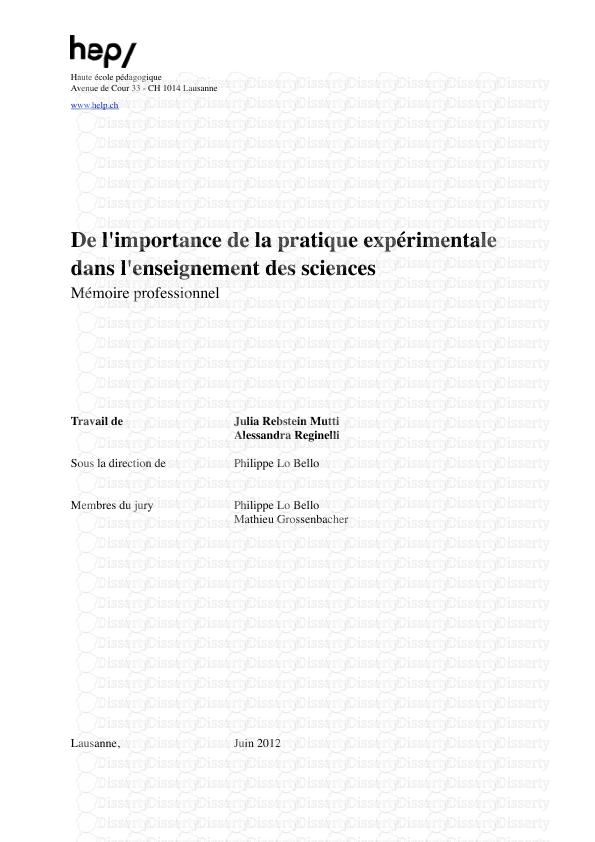









-
36
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 08, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.5391MB


