Aplasies médullaires constitutionnelles T Leblanc Y Reguerre R Rousseau MF Aucl
Aplasies médullaires constitutionnelles T Leblanc Y Reguerre R Rousseau MF Auclerc A Baruchel Résumé. – Les aplasies médullaires constitutionnelles représentent 20 à 30 % des aplasies médullaires de l’enfant. La plus fréquente est l’anémie de Fanconi. L’identification clinique de ces syndromes est d’importance clinique majeure, car les options thérapeutiques diffèrent de celles proposées dans les aplasies médullaires acquises. L’identification récente des gènes en cause peut permettre une meilleure compréhension de l’hématopoïèse. Quatre gènes mutés dans l’anémie de Fanconi ont été clonés (FANCA, FANCC, FANCG, FANCF) et deux autres localisés sur le génome (FANCD, FANCE). Le gène de la dyskératose liée à l’X (DKC1) a également été identifié. Ces progrès offrent de nouveaux outils de diagnostic, notamment prénatal, et la possibilité de mieux comprendre l’hétérogénéité clinique des syndromes. Enfin, l’identification des gènes peut déboucher sur de nouvelles approches thérapeutiques. © 2000 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés. Mots-clés : aplasies médullaires constitutionnelles, aplasies médullaires, anémie de Fanconi, dyskératose congénitale. Introduction Les aplasies médullaires (AM) constitutionnelles représentent 25 à 30 % des AM de l’enfant. Elles ont le plus souvent une transmission de type autosomique récessif. La plus fréquente d’entre elles est l’anémie de Fanconi (AF). Elles doivent être bien différenciées des AM idiopathiques de l’enfant qui relèvent d’autres approches thérapeutiques. L’AM est responsable d’une pancytopénie avec anémie normochrome, normocytaire ou macrocytaire, peu ou non régénérative, une neutropénie et une thrombopénie. Le myélogramme révèle une moelle pauvre mais c’est la biopsie ostéomédullaire qui affirme le diagnostic. Si le diagnostic clinique est relativement facile, le diagnostic étiologique est en revanche plus délicat. Chez l’adulte, les AM sont en grande majorité idiopathiques. Chez l’enfant, il faut exclure de principe les AM constitutionnelles qui représentent 25 à 30 % des cas et qui n’ont pas de particularité sur le plan hématologique. Les principaux éléments d’orientation vers une cause constitutionnelle sont l’étude des antécédents familiaux, l’existence d’une consanguinité parentale, et l’association au tableau hématologique d’un retard statural, d’anomalies cliniques extrahématologiques (peau, phanères, membres supérieurs…) ou de malformations congénitales. La reconnaissance précoce de l’origine constitutionnelle de l’AM évite la mise en œuvre de traitements inadaptés et permet un conseil génétique le plus précoce possible. Sur le plan étiologique, la plus fréquente des AM constitutionnelles est l’AF ; les autres causes sont exceptionnelles. Thierry Leblanc : Ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique-assistant, praticien hospitalier. Yves Reguerre : Ancien interne des hôpitaux de Paris, chef de clinique-assistant. Raphaël Rousseau : Interne des hôpitaux de Paris. Marie-Françoise Auclerc : Attachée. André Baruchel : Ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique-assistant, professeur des Universités, praticien hospitalier. Service de pédiatrie à orientation hématologique, hôpital Saint-Louis, 1, avenue Claude-Vellefaux, 75475 Paris cedex 10, France. Anémie de Fanconi L’AF a été décrite en 1927 par Fanconi, pédiatre suisse, rapportant chez trois frères l’association d’une anémie « pernicieuse » et d’anomalies morphologiques avec évolution vers une pancytopénie [23]. ÉPIDÉMIOLOGIE ET MODE DE TRANSMISSION C’est la plus fréquente des AM constitutionnelles. Elle est de transmission autosomique récessive et la fréquence des sujets hétérozygotes a été estimée à 1/300 aux États-Unis et en Europe [56]. Il n’y a pas de différence d’incidence selon le sexe et tous les groupes ethniques sont concernés. Au moins huit gènes sont impliqués et les premières corrélations entre gène en cause, type de mutation et origine ethnique commencent à être rapportées (cf infra). EXPRESSION CLINIQUE – L’expression clinique de l’AF est hétérogène et reflète l’hétérogénéité génétique de la maladie. Le tableau classique associe une petite taille, une dysmorphie faciale, des anomalies cutanées et des pouces, et une pancytopénie d’apparition secondaire s’aggravant avec l’âge. Les malformations associées sont inconstantes et très variables (tableau I). – Un diagnostic d’AF peut être porté chez un enfant ne présentant aucune anomalie ou malformation associée. Cette situation est néanmoins exceptionnelle. Si un tiers des patients ne présentent aucune malformation congénitale, il existe le plus souvent un visage particulier, un retard staturopondéral et des signes cutanés qui doivent être bien identifiés en tant qu’éléments du tableau d’AF. Ainsi, dans une étude récente de l’International Fanconi Anemia Registry (IFAR), 64 % des enfants atteints d’AF mais sans malformation présentent au moins une de ces anomalies dites « mineures » ; ce chiffre monte à 100 % pour une cohorte d’enfants examinés dans un centre de référence [28]. Encyclopédie Médico-Chirurgicale 13-008-C-10 – 4-081-A-10 13-008-C-10 4-081-A-10 Toute référence à cet article doit porter la mention : Leblanc T, Reguerre Y, Rousseau R, Auclerc MF et Baruchel A. Aplasies médullaires constitutionnelles. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Hématologie, 13-008-C-10, Pédiatrie, 4-081-A-10, 2000, 10 p. EMC [289] 150 507 – Le pronostic est dominé par l’atteinte hématologique, avec évolution vers un tableau d’insuffisance médullaire sévère et le risque de néoplasies (leucémies et cancers). Dans une autre étude de l’IFAR portant sur 388 sujets, l’âge médian des 135 patients décédés est de 13 ans, et le risque actuariel de décès 20 ans après la détection des premières manifestations hématologiques est de 80 % [10]. ¶ Atteintes extrahématologiques Ne sont détaillées que les plus fréquentes d’entre elles [27, 72]. – Retard staturopondéral : il est pratiquement constant et présent dès la naissance, secondaire à un retard de croissance intra-utérin. Dans plus de 50 % des cas, le retard staturopondéral est important, inférieur au 5e percentile. Il s’agit d’un retard de croissance harmonieux. Dans quelques cas, un authentique déficit en hormone de croissance est présent. – Dysmorphie faciale : elle est caractéristique et il est habituel de dire que les enfants atteints d’AF se ressemblent plus entre eux qu’ils ne ressemblent à leurs frères et sœurs indemnes. Les éléments les plus évocateurs sont un aspect triangulaire du visage avec micrognathie, une ensellure nasale marquée, une microphtalmie avec hypertélorisme et des traits fins. Une microcéphalie inférieure au 5e percentile est présente dans 30 à 40 % des cas [27, 28]. – Signes cutanés : l’atteinte cutanée est très fréquente, voire constante pour certains [28]. L’expression clinique est variée et évolutive dans le temps. On note une association de taches pigmentées (café au lait), de taches achromiques et d’une mélanodermie réalisant un aspect « sale » de la peau, s’accentuant avec l’âge, siégeant préférentiellement au tronc et au cou. L’aspect réalisé est le plus souvent très évocateur. – Anomalies de la colonne radiale : elles sont présentes chez environ la moitié des patients [27]. Il s’agit le plus souvent d’anomalies des pouces (tableau I). ¶ Associations cliniques L’association atrésie de l’œsophage et AF a été rapportée dans la cadre du syndrome VACTERL (V : anomalies vertébrales, A : atrésie anale, C : cardiopathie, TE : fistule trachéo-œsophagienne avec atrésie de l’œsophage, R : atteinte rénale, L [limb] : anomalies des membres) [36]. Plus récemment a été rapportée, chez deux patients du groupe C (cf infra), une association avec la maladie de moya-moya [53]. ¶ Atteinte hématologique Elle est pratiquement constante. Dans une étude de l’IFAR portant sur 388 sujets, 85 % présentent des anomalies de la numération. L’âge médian de l’apparition de ces anomalies est de 7 ans (0 à 36 ans). L’atteinte hématologique peut être présente dès la première année de vie. À 40 ans, le risque actuariel d’atteinte hématologique atteint 98 % [10]. Les anomalies de l’hémogramme associent anémie normocytaire ou macrocytaire, non ou peu régénérative, neutropénie et thrombocytopénie. La présentation peut être celle d’une cytopénie isolée initialement ou associée à une macrocytose. Il s’agit alors le plus souvent d’une thrombopénie. L’évolution se fait vers un tableau d’insuffisance médullaire sévère. Le myélogramme montre initialement une moelle pauvre, érythroblastique ou franchement hypoplasique. Il n’y a pas d’aspect spécifique sur le plan cytologique. Une élévation de l’hémoglobine (Hb)F est fréquente, comme dans beaucoup d’atteintes médullaires. Le caryotype médullaire peut révéler la présence d’anomalies clonales. Ce risque augmente avec l’âge : 15 % à 10 ans, 37 % à 20 ans, 67 % à 30 ans [10]. Les anomalies cytogénétiques décrites sont variées, touchant le plus souvent les chromosomes 1, 7 et 11. Leur présence est de mauvais pronostic et fait craindre une évolution leucémique, en particulier quand il s’agit d’une monosomie 7. Une étude récente confirme l’intérêt d’un suivi de la moelle de ces patients. Les anomalies cytogénétiques médullaires concernent 48 % des patients ; elles sont variables dans le temps avec possibilité de disparition d’un clone, d’apparition d’un nouveau clone ou de survenue d’une évolution clonale. L’estimation de la survie à 5 ans des patients avec clone cytogénétique est de 40 % versus 94 % en Tableau I. – Manifestations extrahématologiques de l’anémie de Fanconi. D’après [72]. Retard staturopondéral Pratiquement constant (cf texte). Peau Hyperpigmentation. Taches café au lait. Zones localisées d’hypopigmentation Tête et cou Dysmorphie faciale (cf texte). Microcéphalie, hydrocéphalie, cou court Membres supérieurs Pouces : absents, hypoplasiques, surnuméraires, bifides, rudimentaires, courts, bas ou mal implantés, rattachés par un filament, triphalangiques, luxés, hyperextensibles Radius : absents ou hypoplasiques, pouls radiaux absents ou faibles Cubitus : dysplasiques Rachis et côtes Spina bifida, scoliose, côtes anormales, sinus sacrococcygien, aplasie du coccyx, uploads/Sante/ aplasies-medullaires-constitutionnelles.pdf
Documents similaires







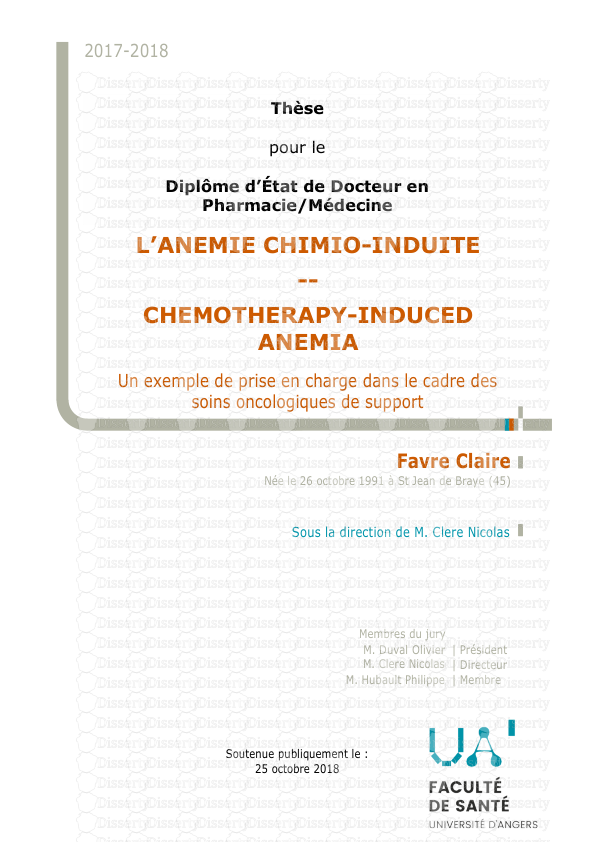


-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 30, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.5643MB


